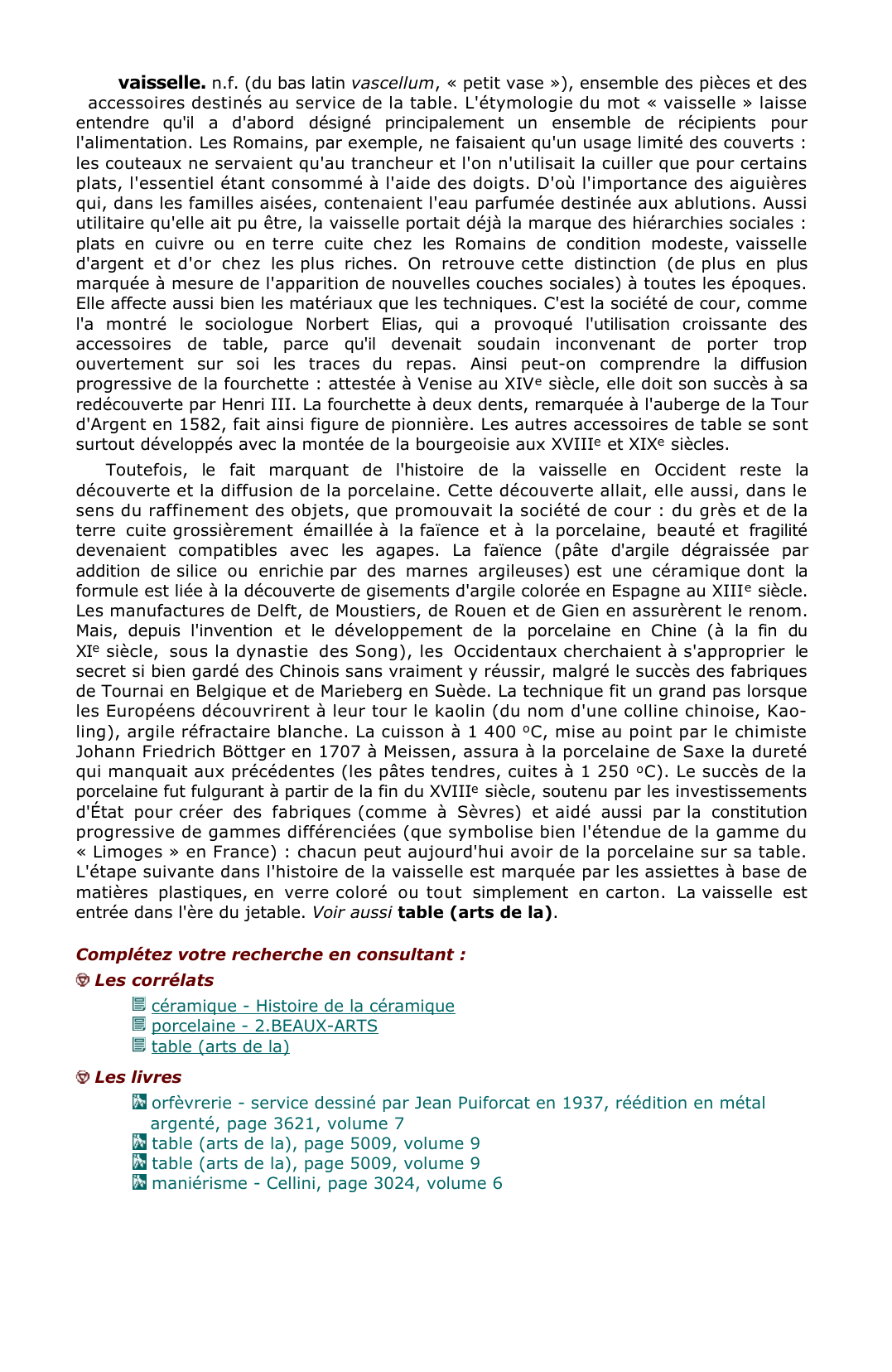vaisselle.
Publié le 08/12/2021
Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : vaisselle.. Ce document contient 638 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Encyclopédie
vaisselle. n.f. (du bas latin vascellum, « petit vase »), ensemble des pièces et des
accessoires destinés au service de la table. L'étymologie du mot « vaisselle » laisse
entendre qu'il a d'abord désigné principalement un ensemble de récipients pour
l'alimentation. Les Romains, par exemple, ne faisaient qu'un usage limité des couverts :
les couteaux ne servaient qu'au trancheur et l'on n'utilisait la cuiller que pour certains
plats, l'essentiel étant consommé à l'aide des doigts. D'où l'importance des aiguières
qui, dans les familles aisées, contenaient l'eau parfumée destinée aux ablutions. Aussi
utilitaire qu'elle ait pu être, la vaisselle portait déjà la marque des hiérarchies sociales :
plats en cuivre ou en terre cuite chez les Romains de condition modeste, vaisselle
d'argent et d'or chez les plus riches. On retrouve cette distinction (de plus en plus
marquée à mesure de l'apparition de nouvelles couches sociales) à toutes les époques.
Elle affecte aussi bien les matériaux que les techniques. C'est la société de cour, comme
l'a montré le sociologue Norbert Elias, qui a provoqué l'utilisation croissante des
accessoires de table, parce qu'il devenait soudain inconvenant de porter trop
ouvertement sur soi les traces du repas. Ainsi peut-on comprendre la diffusion
progressive de la fourchette : attestée à Venise au XIV e siècle, elle doit son succès à sa
redécouverte par Henri III. La fourchette à deux dents, remarquée à l'auberge de la Tour
d'Argent en 1582, fait ainsi figure de pionnière. Les autres accessoires de table se sont
surtout développés avec la montée de la bourgeoisie aux XVIIIe et XIXe siècles.
Toutefois, le fait marquant de l'histoire de la vaisselle en Occident reste la
découverte et la diffusion de la porcelaine. Cette découverte allait, elle aussi, dans le
sens du raffinement des objets, que promouvait la société de cour : du grès et de la
terre cuite grossièrement émaillée à la faïence et à la porcelaine, beauté et fragilité
devenaient compatibles avec les agapes. La faïence (pâte d'argile dégraissée par
addition de silice ou enrichie par des marnes argileuses) est une céramique dont la
formule est liée à la découverte de gisements d'argile colorée en Espagne au XIII e siècle.
Les manufactures de Delft, de Moustiers, de Rouen et de Gien en assurèrent le renom.
Mais, depuis l'invention et le développement de la porcelaine en Chine (à la fin du
XIe siècle, sous la dynastie des Song), les Occidentaux cherchaient à s'approprier le
secret si bien gardé des Chinois sans vraiment y réussir, malgré le succès des fabriques
de Tournai en Belgique et de Marieberg en Suède. La technique fit un grand pas lorsque
les Européens découvrirent à leur tour le kaolin (du nom d'une colline chinoise, Kaoling), argile réfractaire blanche. La cuisson à 1 400 o C, mise au point par le chimiste
Johann Friedrich Böttger en 1707 à Meissen, assura à la porcelaine de Saxe la dureté
qui manquait aux précédentes (les pâtes tendres, cuites à 1 250 o C). Le succès de la
porcelaine fut fulgurant à partir de la fin du XVIIIe siècle, soutenu par les investissements
d'État pour créer des fabriques (comme à Sèvres) et aidé aussi par la constitution
progressive de gammes différenciées (que symbolise bien l'étendue de la gamme du
« Limoges » en France) : chacun peut aujourd'hui avoir de la porcelaine sur sa table.
L'étape suivante dans l'histoire de la vaisselle est marquée par les assiettes à base de
matières plastiques, en verre coloré ou tout simplement en carton. La vaisselle est
entrée dans l'ère du jetable. Voir aussi table (arts de la).
Complétez votre recherche en consultant :
Les corrélats
céramique - Histoire de la céramique
porcelaine - 2.BEAUX-ARTS
table (arts de la)
Les livres
orfèvrerie - service dessiné par Jean Puiforcat en 1937, réédition en métal
argenté, page 3621, volume 7
table (arts de la), page 5009, volume 9
table (arts de la), page 5009, volume 9
maniérisme - Cellini, page 3024, volume 6
vaisselle. n.f. (du bas latin vascellum, « petit vase »), ensemble des pièces et des
accessoires destinés au service de la table. L'étymologie du mot « vaisselle » laisse
entendre qu'il a d'abord désigné principalement un ensemble de récipients pour
l'alimentation. Les Romains, par exemple, ne faisaient qu'un usage limité des couverts :
les couteaux ne servaient qu'au trancheur et l'on n'utilisait la cuiller que pour certains
plats, l'essentiel étant consommé à l'aide des doigts. D'où l'importance des aiguières
qui, dans les familles aisées, contenaient l'eau parfumée destinée aux ablutions. Aussi
utilitaire qu'elle ait pu être, la vaisselle portait déjà la marque des hiérarchies sociales :
plats en cuivre ou en terre cuite chez les Romains de condition modeste, vaisselle
d'argent et d'or chez les plus riches. On retrouve cette distinction (de plus en plus
marquée à mesure de l'apparition de nouvelles couches sociales) à toutes les époques.
Elle affecte aussi bien les matériaux que les techniques. C'est la société de cour, comme
l'a montré le sociologue Norbert Elias, qui a provoqué l'utilisation croissante des
accessoires de table, parce qu'il devenait soudain inconvenant de porter trop
ouvertement sur soi les traces du repas. Ainsi peut-on comprendre la diffusion
progressive de la fourchette : attestée à Venise au XIV e siècle, elle doit son succès à sa
redécouverte par Henri III. La fourchette à deux dents, remarquée à l'auberge de la Tour
d'Argent en 1582, fait ainsi figure de pionnière. Les autres accessoires de table se sont
surtout développés avec la montée de la bourgeoisie aux XVIIIe et XIXe siècles.
Toutefois, le fait marquant de l'histoire de la vaisselle en Occident reste la
découverte et la diffusion de la porcelaine. Cette découverte allait, elle aussi, dans le
sens du raffinement des objets, que promouvait la société de cour : du grès et de la
terre cuite grossièrement émaillée à la faïence et à la porcelaine, beauté et fragilité
devenaient compatibles avec les agapes. La faïence (pâte d'argile dégraissée par
addition de silice ou enrichie par des marnes argileuses) est une céramique dont la
formule est liée à la découverte de gisements d'argile colorée en Espagne au XIII e siècle.
Les manufactures de Delft, de Moustiers, de Rouen et de Gien en assurèrent le renom.
Mais, depuis l'invention et le développement de la porcelaine en Chine (à la fin du
XIe siècle, sous la dynastie des Song), les Occidentaux cherchaient à s'approprier le
secret si bien gardé des Chinois sans vraiment y réussir, malgré le succès des fabriques
de Tournai en Belgique et de Marieberg en Suède. La technique fit un grand pas lorsque
les Européens découvrirent à leur tour le kaolin (du nom d'une colline chinoise, Kaoling), argile réfractaire blanche. La cuisson à 1 400 o C, mise au point par le chimiste
Johann Friedrich Böttger en 1707 à Meissen, assura à la porcelaine de Saxe la dureté
qui manquait aux précédentes (les pâtes tendres, cuites à 1 250 o C). Le succès de la
porcelaine fut fulgurant à partir de la fin du XVIIIe siècle, soutenu par les investissements
d'État pour créer des fabriques (comme à Sèvres) et aidé aussi par la constitution
progressive de gammes différenciées (que symbolise bien l'étendue de la gamme du
« Limoges » en France) : chacun peut aujourd'hui avoir de la porcelaine sur sa table.
L'étape suivante dans l'histoire de la vaisselle est marquée par les assiettes à base de
matières plastiques, en verre coloré ou tout simplement en carton. La vaisselle est
entrée dans l'ère du jetable. Voir aussi table (arts de la).
Complétez votre recherche en consultant :
Les corrélats
céramique - Histoire de la céramique
porcelaine - 2.BEAUX-ARTS
table (arts de la)
Les livres
orfèvrerie - service dessiné par Jean Puiforcat en 1937, réédition en métal
argenté, page 3621, volume 7
table (arts de la), page 5009, volume 9
table (arts de la), page 5009, volume 9
maniérisme - Cellini, page 3024, volume 6
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- nature mortenature morte, en peinture, représentation d'objets inanimés (fruits, fleurs, gibier, vaisselle, livres ou instruments de musique).
- Le Marchand de vaisselleLe Marchand de vaisselle est certainement l'un des cartons les mieux réussisparmi les six que Goya livre le 5 janvier 1779 à la manufacture royale de SantaBarbara.