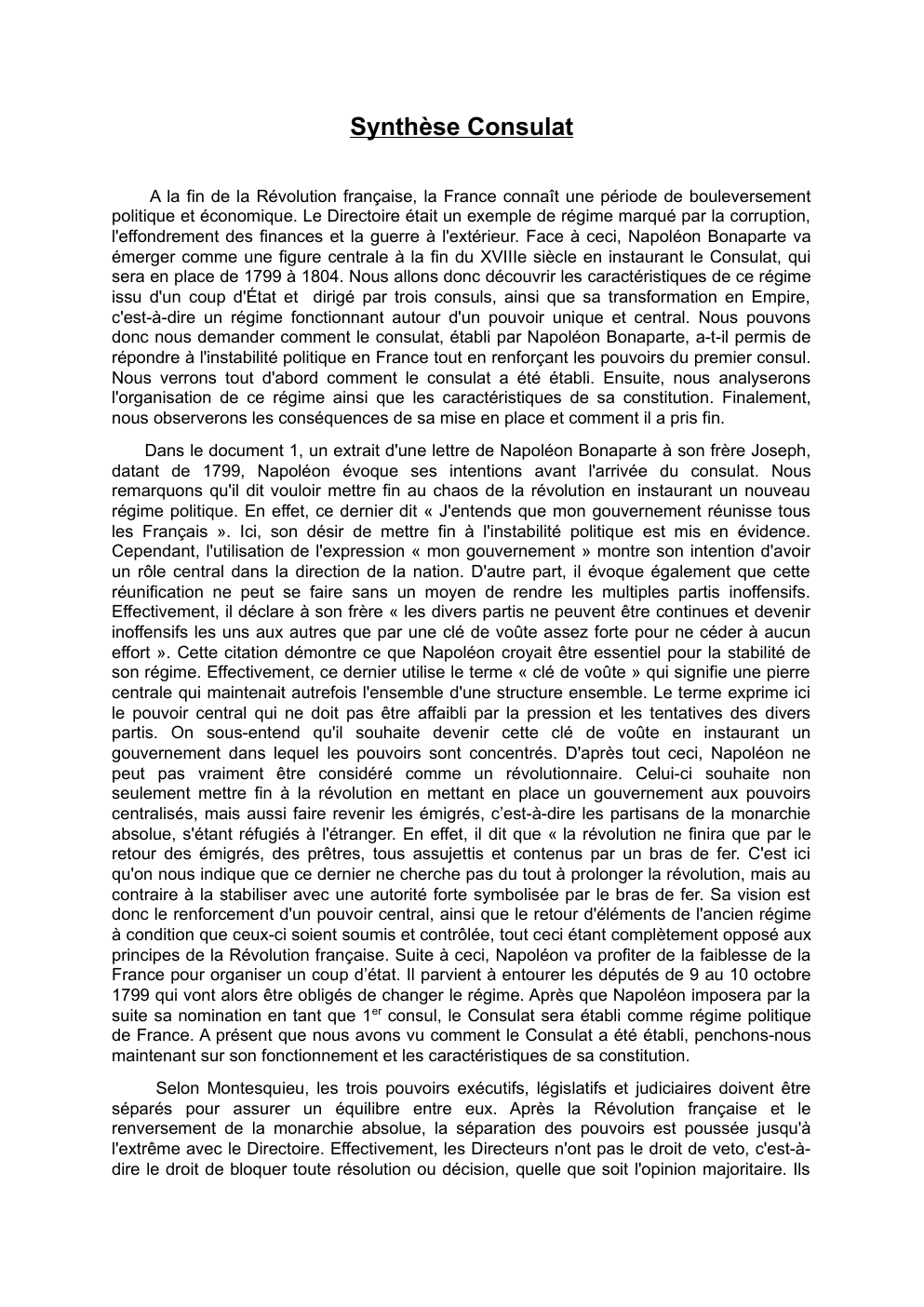Synthèse Consulat
Publié le 18/04/2025
Extrait du document
«
Synthèse Consulat
A la fin de la Révolution française, la France connaît une période de bouleversement
politique et économique.
Le Directoire était un exemple de régime marqué par la corruption,
l'effondrement des finances et la guerre à l'extérieur.
Face à ceci, Napoléon Bonaparte va
émerger comme une figure centrale à la fin du XVIIIe siècle en instaurant le Consulat, qui
sera en place de 1799 à 1804.
Nous allons donc découvrir les caractéristiques de ce régime
issu d'un coup d'État et dirigé par trois consuls, ainsi que sa transformation en Empire,
c'est-à-dire un régime fonctionnant autour d'un pouvoir unique et central.
Nous pouvons
donc nous demander comment le consulat, établi par Napoléon Bonaparte, a-t-il permis de
répondre à l'instabilité politique en France tout en renforçant les pouvoirs du premier consul.
Nous verrons tout d'abord comment le consulat a été établi.
Ensuite, nous analyserons
l'organisation de ce régime ainsi que les caractéristiques de sa constitution.
Finalement,
nous observerons les conséquences de sa mise en place et comment il a pris fin.
Dans le document 1, un extrait d'une lettre de Napoléon Bonaparte à son frère Joseph,
datant de 1799, Napoléon évoque ses intentions avant l'arrivée du consulat.
Nous
remarquons qu'il dit vouloir mettre fin au chaos de la révolution en instaurant un nouveau
régime politique.
En effet, ce dernier dit « J'entends que mon gouvernement réunisse tous
les Français ».
Ici, son désir de mettre fin à l'instabilité politique est mis en évidence.
Cependant, l'utilisation de l'expression « mon gouvernement » montre son intention d'avoir
un rôle central dans la direction de la nation.
D'autre part, il évoque également que cette
réunification ne peut se faire sans un moyen de rendre les multiples partis inoffensifs.
Effectivement, il déclare à son frère « les divers partis ne peuvent être continues et devenir
inoffensifs les uns aux autres que par une clé de voûte assez forte pour ne céder à aucun
effort ».
Cette citation démontre ce que Napoléon croyait être essentiel pour la stabilité de
son régime.
Effectivement, ce dernier utilise le terme « clé de voûte » qui signifie une pierre
centrale qui maintenait autrefois l'ensemble d'une structure ensemble.
Le terme exprime ici
le pouvoir central qui ne doit pas être affaibli par la pression et les tentatives des divers
partis.
On sous-entend qu'il souhaite devenir cette clé de voûte en instaurant un
gouvernement dans lequel les pouvoirs sont concentrés.
D'après tout ceci, Napoléon ne
peut pas vraiment être considéré comme un révolutionnaire.
Celui-ci souhaite non
seulement mettre fin à la révolution en mettant en place un gouvernement aux pouvoirs
centralisés, mais aussi faire revenir les émigrés, c’est-à-dire les partisans de la monarchie
absolue, s'étant réfugiés à l'étranger.
En effet, il dit que « la révolution ne finira que par le
retour des émigrés, des prêtres, tous assujettis et contenus par un bras de fer.
C'est ici
qu'on nous indique que ce dernier ne cherche pas du tout à prolonger la révolution, mais au
contraire à la stabiliser avec une autorité forte symbolisée par le bras de fer.
Sa vision est
donc le renforcement d'un pouvoir central, ainsi que le retour d'éléments de l'ancien régime
à condition que ceux-ci soient soumis et contrôlée, tout ceci étant complètement opposé aux
principes de la Révolution française.
Suite à ceci, Napoléon va profiter de la faiblesse de la
France pour organiser un coup d’état.
Il parvient à entourer les députés de 9 au 10 octobre
1799 qui vont alors être obligés de changer le régime.
Après que Napoléon imposera par la
suite sa nomination en tant que 1er consul, le Consulat sera établi comme régime politique
de France.
A présent que nous avons vu comment le Consulat a été établi, penchons-nous
maintenant sur son fonctionnement et les caractéristiques de sa constitution.
Selon Montesquieu, les trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires doivent être
séparés pour assurer un équilibre entre eux.
Après la Révolution française et le
renversement de la monarchie absolue, la séparation des pouvoirs est poussée jusqu'à
l'extrême avec le Directoire.
Effectivement, les Directeurs n'ont pas le droit de veto, c'est-àdire le droit de bloquer toute résolution ou décision, quelle que soit l'opinion majoritaire.
Ils
ne sont pas à l'initiative des lois et ne participent pas à leur promulgation.
Il serait donc
intéressant d'observer l'évolution de cette séparation des pouvoirs dans le Consulat après la
fin du Directoire.
Selon le document 2, qui est un schéma de la répartition des pouvoirs dans
la constitution de 1799, le premier consul, Napoléon Bonaparte, possède le pouvoir exécutif
avec la capacité de commander les armées, désigner les ministres et être à l'initiative des
lois.
Le pouvoir législatif, quant à lui, est réparti entre le Conseil d'État, le Sénat, le Tribunal
et le corps législatif qui vote, vérifie et discute des lois.
A première vue, on pourrait croire
qu'il y a bien une séparation des pouvoirs, cependant, on peut observer que le premier
consul nomme le Conseil d'État et le Sénat, qui vont alors nommer le Tribunal et le corps
législatif.
On obtient donc un premier consul ayant un pouvoir exécutif et contrôlant ceux
ayant le pouvoir législatif.
De plus, avec seulement les listes des candidats, déjà choisis par
le Sénat, pour lesquels le vote est possible au suffrage universel masculin, on peut dire que
le contre-pouvoir est quasi inexistant.
La séparation des pouvoirs n'étant pas respectée, le
consulat est essentiellement un régime autoritaire.
En outre, d’après le document 3, un
ensemble d'extraits de la Constitution du Consulat, daté du 13 décembre 1799, on nous
informe que le gouvernement est censé posséder trois consuls.
Comme nous l'indique
principalement l'article 39 « le gouvernement est confié à trois consuls, nommés pour dix
ans, et indéfiniment rééligibles ».
On nous dit donc....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- francais 6 synthèse épitre dédicatoire DDFC
- Synthèse XIXème siècle – 2ème partie.
- Synthèse sur le résumé du résumé concernant le bonheur
- Comment la synthèse de l’aldéhyde a-t-elle révolutionnée le monde du parfum?
- TP17 : Synthèse de l’odeur de banane CORRECTION