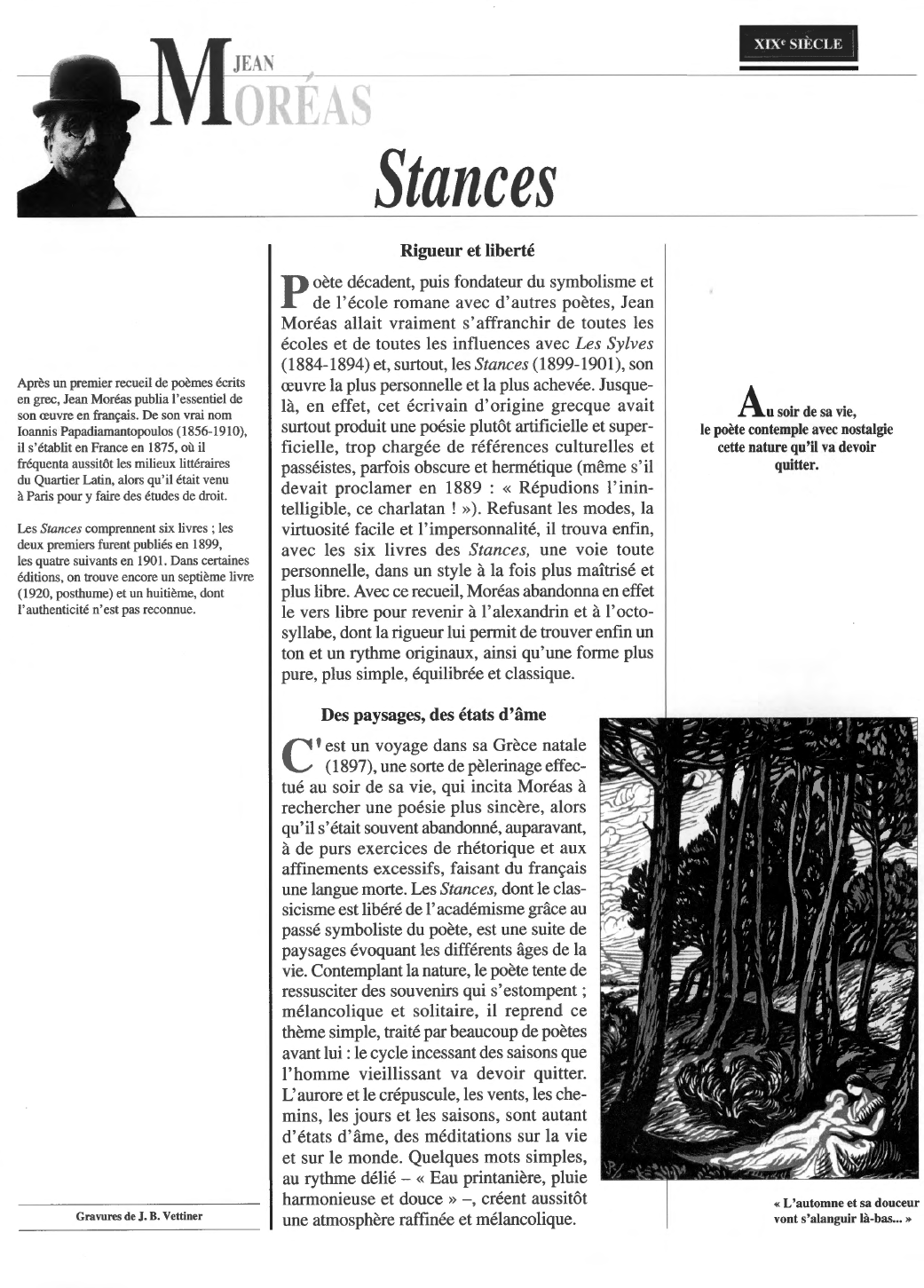Stances
Publié le 17/05/2020
Extrait du document
«
Après un premier recueil de poèmes écrits
en grec, Jean Moréas publia l'essentiel de
son œuvre
en français.
De son vrai nom
Ioannis Papadiamantopoulos ( 1856-1910),
il s'établit en France en 1875, où il
fréquenta aussitôt les milieux littéraires
du Quartier Latin, alors
qu'il était venu
à Paris pour
y faire des études de droit.
Les Stances comprennent six livres ; les
deux premiers furent publiés
en 1899,
les quatre suivants
en 1901.
Dans certaines
éditions, on trouve encore un septième livre
(1920, posthume) et un huitième, dont
l'authenticité n
'est pas reconnue.
Gravures de J.
B.
Vettiner
Stances
Rigueur et liberté
P
oète décadent, puis fondateur du symbolisme et
de
l'école romane avec d'autres poètes, Jean
Moréas allait vraiment s'affranchir de toutes les
écoles et de toutes les influences avec Les Sylves
(1884-1894) et, surtout, les Stances (1899-1901), son
œuvre la plus personnelle et la plus achevée.
Jusque
là, en effet, cet écrivain d'origine grecque avait
surtout produit une poésie plutôt artificielle et super
ficielle, trop chargée de références culturelles et
passéistes, parfois obscure et hermétique (même s'il
devait proclamer en 1889 :
« Répudions l' inin
telligible, ce charlatan
! » ).
Refusant les modes, la
virtuosité facile et l'impersonnalité, il trouva enfin,
avec les six livres des Stances, une voie toute
personnelle, dans un style à la fois plus maîtrisé et
plus libre.
Avec ce recueil, Moréas abandonna en effet
le vers libre pour revenir
à l'alexandrin et à l' octo
syllabe, dont la rigueur lui permit de trouver enfin un
ton et un rythme originaux, ainsi qu'une forme plus
pure, plus simple, équilibrée et classique.
Des paysages, des états
d'âme
C
t est un voyage dans sa Grèce natale
(1897), une sorte de pèlerinage effec
tué au soir de sa vie, qui incita Moréas à
rechercher une poésie plus sincère, alors
qu'il s'était souvent abandonné, auparavant,
à de purs exercices de rhétorique et aux
affinements excessifs, faisant du français
une langue morte.
Les Stances, dont le clas
sicisme est libéré de l'académisme grâce
au
passé symboliste du poète, est une suite de
paysages évoquant les différents âges de la
vie.
Contemplant la nature, le poète tente de
ressusciter des souvenirs qui s'estompent;
mélancolique et solitaire, il reprend ce
thème simple, traité par beaucoup de poètes
avant lui : le cycle incessant des saisons que
l'homme vieillissant va devoir quitter.
L'aurore et le crépuscule, les vents, les che
mins, les jours
et les saisons, sont autant
d'états
d'âme, des méditations sur la vie
et sur le monde.
Quelques mots simples,
au rythme délié -
« Eau printanière, pluie
harmonieuse et douce
» -, créent aussitôt
une atmosphère raffinée et mélancolique.
XIX' ' SIÈCLE
Au soir de sa vie,
le poète contemple avec nostalgie
cette nature qu'il va devoir
quitter.
«L'automne et sa douceur
vont s'alanguir là-bas .•.
,..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- COMMENTAIRE DE TEXTE : “Stances à Marquise”, Pierre Corneille (1658)
- Stances à marquise
- Estienne DURAND, Les Méditations, « Stances à l'inconstance »
- Pierre Corneille, « Stances à Marquise » (1658). Commentaire
- RACAN, Honorat de Bueil, seigneur de (1589-1670)Poète de l'Académie française, il est l'auteur de stances élégiaques et des Bergeries, pastorale dramatique qui trahit l'influence italienne.