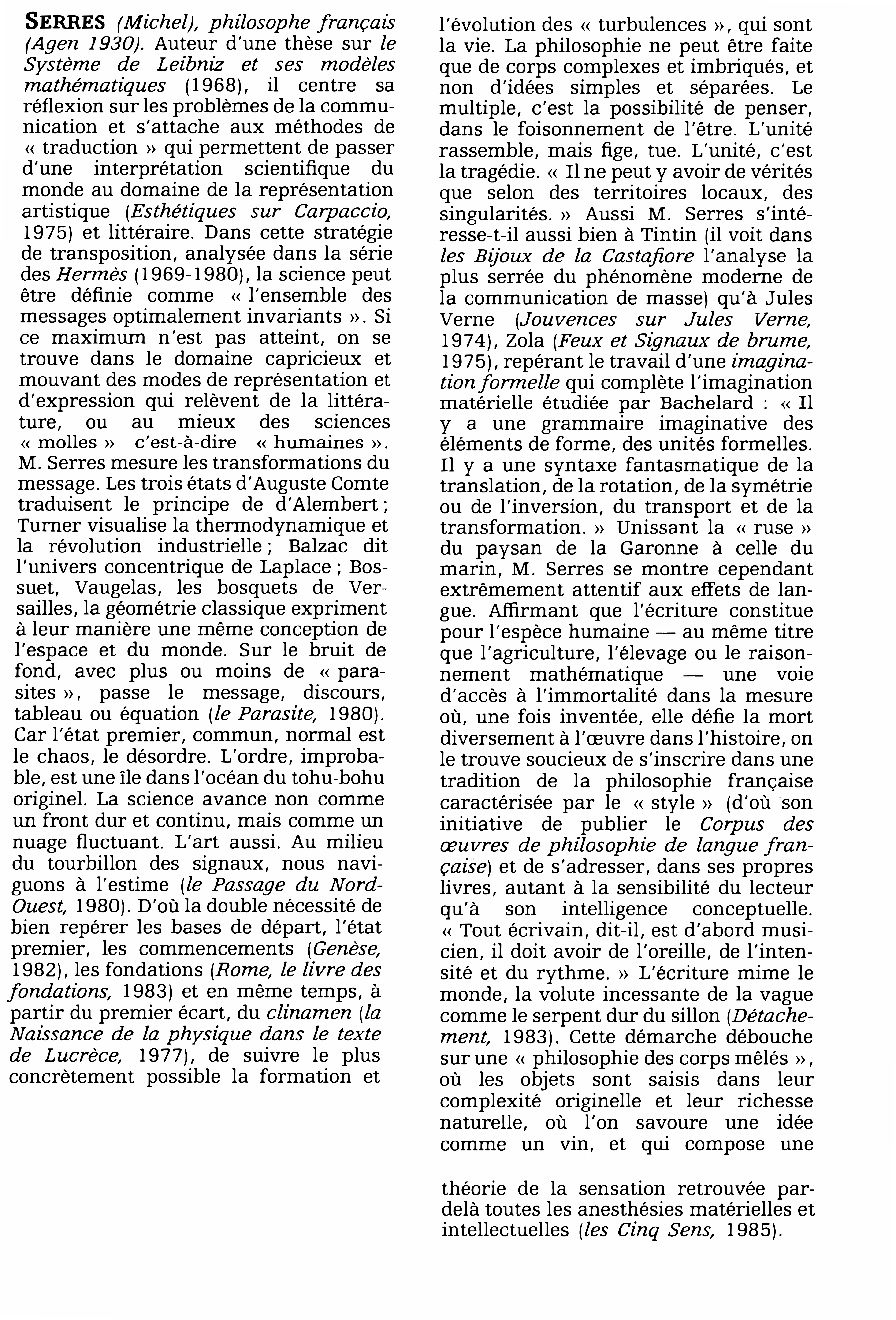SERRES (Michel)
Publié le 18/05/2020
Extrait du document
«
SERRES (Michel), philosophe français
(Agen 1930).
Auteur d'une thèse sur le
Système de Leibniz et ses modèles
mathématiques ( 1968), il centre sa
réflexion sur les problèmes de la commu
nication et s'attache aux méthodes de
« traduction » qui permettent de passer
d'une interprétation scientifique du
monde au domaine de la représentation
artistique (Esthétiques sur Carpaccio,
1975) et littéraire.
Dans cette stratégie
de transposition, analysée dans la série
des Hermès ( 1969-1980), la science peut
être définie comme « 1' ensemble des
messages optimalement invariants ».
Si
• 1 •
ce max1murn n est pas atteint, on se
trouve dans le domaine capricieux et
mouvant des modes de représentation et
d'expression qui relèvent de la littéra
ture, ou au mieux des sciences
« molles » c'est-à-dire
« hum aines ».
M.
Serres mesure les transformations du
message.
Les trois états d'Auguste Comte
traduisent le principe de d'Alembert;
Turner visualise la thennodynamique et
la révolution industrielle; Balzac dit
l'univers concentrique de Laplace; Bos
suet, Vaugelas, les bosquets de Ver
sailles, la géométrie classique expriment
à leur manière une même conception de
l'espace et du monde.
Sur le bruit de
fond, avec plus ou moins de « para
sites », passe le message, discours,
tableau ou équation (le Parasite, 1980).
Car l'état premier, commun, nonnal est
le chaos, le désordre.
L'ordre, improba
ble, est une île dans l'océan du tohu-bohu
originel.
La science avance non comme
un front dur et continu, mais comme un
nuage fluctuant.
L'art aussi.
Au milieu
du tourbillon des signaux, nous navi
guons à l'estime (le Passage du Nord
Ouest, 1980).
D'où la double nécessité de
bien repérer les bases de départ, l'état
premier, les commencements (Genèse,
1982), les fondations (Rome, le livre des
fondations, 1983) et en même temps, à
partir du premier écart, du clinamen (la
Naissance de la physique dans le texte
de Lucrèce, 1977), de suivre le plus
concrètement possible la formation et l'évolution
des « turbulences », qui sont
la vie.
La philosophie ne peut être faite
que de corps corn plexes et imbriqués, et
non d'idées simples et séparées.
Le
multiple, c'est la possibilité de penser,
dans le foisonnement de l'être.
L'unité
rassemble, mais fige, tue.
L'unité, c'est
la tragédie.
« Il ne peut y avoir de vérités
que selon des territoires locaux, des
singularités.
» Aussi M.
Serres s'inté
resse-t-il aussi bien à Tintin (il voit dans
les Bijoux de la Castafiore l'analyse la
plus serrée du phénomène moderne de
la communication de masse) qu'à Jules
Verne (Jouvences sur Jules Verne,
1974), Zola (Feux et Signaux de brume,
1975), repérant le travail d'une imagina
tion formelle qui complète l'imagination
matérielle étudiée par Bachelard : « Il
y a une grammaire imaginative des
éléments de forme, des unités formelles.
Il y a une syntaxe fantasmatique de la
translation, de la rotation, de la symétrie
ou de l'inversion, du transport et de la
transformation.
» Unissant la « ruse »
du paysan de la Garonne à celle du
marin, M.
Serres se montre cependant
extrêmement attentif aux effets de lan
gue.
Affirmant que l'écriture constitue
pour l'espèce humaine
au même titre
que l'agriculture, l'élevage ou le raison
nement mathématique une
voie
d'accès à l'immortalité dans la mesure
où, une fois inventée, elle défie la mort
diversement à l'œuvre dans l'histoire, on
le trouve soucieux de s'inscrire dans une
tradition de la philosophie française
caractérisée par le « style » (d'où son
initiative de publier le Corpus des
œuvres de philosophie de langue fran
çaise) et de s'adresser, dans ses propres
livres, autant à la sensibilité du lecteur
qu'à son intelligence conceptuelle.
« Tout écrivain, dit-il, est d'abord musi
cien, il doit avoir de l'oreille, de l'inten
sité et du rythme.
» L'écriture mime le
monde, la volute incessante de la vague
comme le serpent dur du sillon (Détache
ment, 1983).
Cette démarche débouche
sur une « philosophie des corps mêlés » ,
où les objets sont saisis dans leur
complexité originelle et leur richesse
naturelle, où l'on savoure une idée
comme un vin, et qui compose une
théorie de la sensation retrouvée par
delà toutes les anesthésies matérielles et
intellectuelles (les Cinq Sens, 19 8 5) ..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Michel Serres
- Michel Serres (Vie, ¼uvre, Apports, Concepts, Commentaires).
- Michel Serres
- Le Tiers-Instruit de Michel SERRES (fiche de lecture)
- GO ses: Comment est née l’idée du projet de Michel et Augustin ?