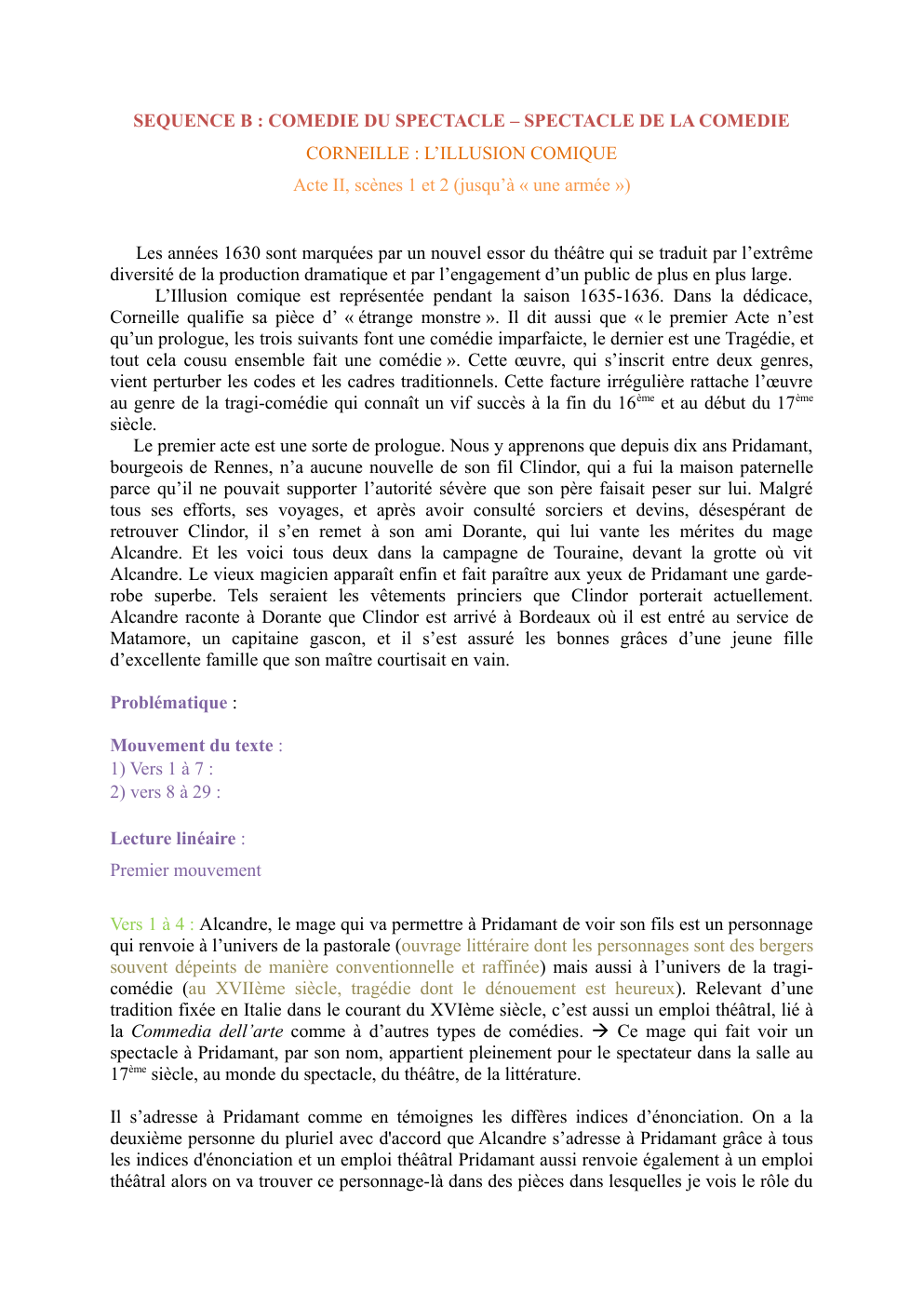SEQUENCE B : COMEDIE DU SPECTACLE – SPECTACLE DE LA COMEDIE CORNEILLE : L’ILLUSION COMIQUE Acte II, scènes 1 et 2 (jusqu’à « une armée »)
Publié le 21/06/2024
Extrait du document
«
SEQUENCE B : COMEDIE DU SPECTACLE – SPECTACLE DE LA COMEDIE
CORNEILLE : L’ILLUSION COMIQUE
Acte II, scènes 1 et 2 (jusqu’à « une armée »)
Les années 1630 sont marquées par un nouvel essor du théâtre qui se traduit par l’extrême
diversité de la production dramatique et par l’engagement d’un public de plus en plus large.
L’Illusion comique est représentée pendant la saison 1635-1636.
Dans la dédicace,
Corneille qualifie sa pièce d’ « étrange monstre ».
Il dit aussi que « le premier Acte n’est
qu’un prologue, les trois suivants font une comédie imparfaicte, le dernier est une Tragédie, et
tout cela cousu ensemble fait une comédie ».
Cette œuvre, qui s’inscrit entre deux genres,
vient perturber les codes et les cadres traditionnels.
Cette facture irrégulière rattache l’œuvre
au genre de la tragi-comédie qui connaît un vif succès à la fin du 16 ème et au début du 17ème
siècle.
Le premier acte est une sorte de prologue.
Nous y apprenons que depuis dix ans Pridamant,
bourgeois de Rennes, n’a aucune nouvelle de son fil Clindor, qui a fui la maison paternelle
parce qu’il ne pouvait supporter l’autorité sévère que son père faisait peser sur lui.
Malgré
tous ses efforts, ses voyages, et après avoir consulté sorciers et devins, désespérant de
retrouver Clindor, il s’en remet à son ami Dorante, qui lui vante les mérites du mage
Alcandre.
Et les voici tous deux dans la campagne de Touraine, devant la grotte où vit
Alcandre.
Le vieux magicien apparaît enfin et fait paraître aux yeux de Pridamant une garderobe superbe.
Tels seraient les vêtements princiers que Clindor porterait actuellement.
Alcandre raconte à Dorante que Clindor est arrivé à Bordeaux où il est entré au service de
Matamore, un capitaine gascon, et il s’est assuré les bonnes grâces d’une jeune fille
d’excellente famille que son maître courtisait en vain.
Problématique :
Mouvement du texte :
1) Vers 1 à 7 :
2) vers 8 à 29 :
Lecture linéaire :
Premier mouvement
Vers 1 à 4 : Alcandre, le mage qui va permettre à Pridamant de voir son fils est un personnage
qui renvoie à l’univers de la pastorale (ouvrage littéraire dont les personnages sont des bergers
souvent dépeints de manière conventionnelle et raffinée) mais aussi à l’univers de la tragicomédie (au XVIIème siècle, tragédie dont le dénouement est heureux).
Relevant d’une
tradition fixée en Italie dans le courant du XVIème siècle, c’est aussi un emploi théâtral, lié à
la Commedia dell’arte comme à d’autres types de comédies.
Ce mage qui fait voir un
spectacle à Pridamant, par son nom, appartient pleinement pour le spectateur dans la salle au
17ème siècle, au monde du spectacle, du théâtre, de la littérature.
Il s’adresse à Pridamant comme en témoignes les diffères indices d’énonciation.
On a la
deuxième personne du pluriel avec d'accord que Alcandre s’adresse à Pridamant grâce à tous
les indices d'énonciation et un emploi théâtral Pridamant aussi renvoie également à un emploi
théâtral alors on va trouver ce personnage-là dans des pièces dans lesquelles je vois le rôle du
père de comédie Pridamant c'est le cœur de comédie par excellence.
Il veut renouer avec son
fils.
Ce qui renvoie au théâtre : Champ lexical de la vue qui annonce une représentation visuel
(s’offre a vos yeux/ voyez / paraitre), relation Maitre/Valets couple courant aux théâtre comme
dans Le Malade Imaginaire et dans la comédie de Plaute (on le trouve aussi depuis le 15 ème
siècle dans le comédie del arte), adjectif « vains » signifie sans consistance et sans réalité le
groupe nominal « fantômes vains » suggère l’idée d’illusion prouve que le théâtre est fait pour
être vu et entendu .
Alcandre et Pridamant se trouvent devant une grotte.
C’est un espace, un lieu courant des
scénographies de théâtre au quattrocento, c’est-à-dire dans les années 1400 en Italie
(Renaissance italienne).
On la retrouve dans les pastorales de l’Antiquité (dans Daphnis et
Chloé de Longus, pastorale en prose du 3ème siècle après JC), au XVème et au XVIème siècle,
chez Jacques Sannazar par exemple, poète italien de la Renaissance (1458-1530).
Les
paysages sauvages comme la grotte placent l’homme face aux forces de la nature et exaltent le
sentiment du sacré.
Dans la deuxième moitié du XVIème siècle, c’est à la pastorale, qui vient
tout juste de s’affirmer comme genre dramatique, qu’elle est désormais associée.
Alcandre se préoccupe de Pridamant, il le guide/le rassure.
Il le met en garde.
C’est un
spectacle singulier auquel il va assister.
C’est un spectacle qui demande des rituels de la part
du spectateur.
Vers 5 : Pridamant est très émue « O Dieux », exprime son désir ardant de retrouver son fils.
L’illusion comique apparait ici comme une œuvre de désir (désir du père de retrouver son fils)
schéma typique des comédies.
L’illusions tendu vers cette réconciliation finale entre le père
est le fils qui est le schéma type de la comédie depuis toujours.
L’illusion est bien comique en
ce sens mais aussi comique en ce sens qu’elle concerne le théâtre (séduit le spectateur par la
magie de l’illusions)
Les conditions de la représentation étaient bien différentes au XVIIème siècle par rapport à
aujourd’hui.
Le principal étonnement qu’éprouverait un spectateur d’aujourd’hui serait de
voir, au moins après le lever du rideau, un certain nombre de spectateurs installés assis sur des
chaises de paille sur la scène elle-même.
Cet usage ne semble pas général mais cette pratique
est source de confusion car certains spectateurs rejoignaient la scène alors que la pièce avait
commencé et cherchaient des places.
« Combien de fois sur des morceaux de vers : ‘ mais la
voici ‘, ‘mais je le vois’ a-t-on des pris des spectateurs pour un personnage qu’on attendait »
s’insurge l’abbé de Pure.
Si nous nous mêlons au public du parterre, qui restait debout, nous
retrouvons des désoeuvrés, valets, pages, mousquetaires, artisans, étudiants et commis de
boutique dont beaucoup se faufilaient, profitant de l’affluence à l’entrée pour pénétrer dans la
salle sans payer.
A ces oisifs se mêlaient des coupe-bourses (voleurs qui dérobent les bourses
en coupant les cordons qui les retiennent), des filles de petite vertu qui venait chercher
l’aventure ou l’occasion d’un coup heureux.
Ce public populaire, effervescent, plus intéressé
par la farce que par la noble tragédie, s’interpellait, criblait les autres spectateurs de quolibets
et créait parfois de véritables bagarres exigeant l’intervention des hommes de guet.
Souvent, il
entreprenait des parties de cartes ou de dés.
Dès que le rideau se levait, c’est au parterre que
naissait le brouhaha, applaudissements déchaînés ou sifflets.
Ceux qui étaient au fond de la
salle voyaient mal le spectacle et avaient peine à entendre les comédiens.
Les rumeurs
emplissaient la salle et les spectateurs des hauts gradins de l’amphithéâtre participaient aussi à
cette agitation et à ses cris.
Les conditions de la représentation étaient donc très éprouvantes
pour les acteurs.
Vers 6 : C’est une phrase injonctive pour que le comédien se fasse entendre.
Alcandre précise
qu’elle doit être l’attitude du spectateur lors une représentation théâtrale (respectueuse,
silencieuse).
C’est une didascalie, Alcandre et Pridamant se mettent sur le côté et vont
regarder le spectacle et nous laissent.
Va s’offrir à la vue de Pridamant le projection animée et
vivante de celle de la vie de Clindor.
Le spectateur dans la salle va assister à ce même
spectacle doubler de celui des 2 hommes.
On quitte la pièce cadre pour entrer dans la pièce
enchâssée Procédé courant au 17eme siècle (spectateur réel qui contemple un autre
spectacle).
Corneille va le pousser très loin (surtout dans l’acte 5).
Ce procédé, issu de la tragédie antique où le chœur commente l’action sur scène, s’est
particulièrement développé à l’âge baroque, époque de Corneille, pour traduire une vision du
monde.
Le thème du théâtre dans le théâtre est proche de celui du miroir.
L’homme contemple
dans le miroir une image de lui-même dont il ne sait si elle est plus vraie que la réalité.
C’est
une façon de mettre l’accent sur les illusions du réel où les apparences trompeuses dominent.
Le théâtre dans le théâtre est alors lié au thème du theatrum mundi qui remonte à l’Antiquité.
Le monde est un théâtre sur lequel s’agitent les hommes, acteurs d’un jeu absurde qui n’est
dénoué que par la mort.
L’illusion comique peut donc être considérée à ce titre comme une
tragi-comédie baroque.
Vers 8 à 11 Deuxième mouvement :
Clindor qui formule la première réplique.
La réplique commence par 2 exclamations
traduisant l’étonnement de Clindor et on retrouve un procédé très courant on entre tout de
suite au cœur des choses (in medias res).
Clindor s’intéresse à son maitre « monsieur » et le
vouvoiement.
Des questions et exclamation qui vont permettre de découvrir le personnage de
Matamore.
Avec le thème de la guerre, les thèmes de la victoire et de la gloire.
Matamore se
caractériserait par un personnage de gloire et héroïque Cette thématique nous renvoie dans un
autre genre théâtral la tragédie.
Il nous introduit dans le monde de l’épopée.
Et nous....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'illusion comique de Corneille Acte V, Scène 5
- Illusion comique, Corneille Texte 1 / Acte II, 2 « Quoi Monsieur, vous rêvez …vous refuser son coeur »
- Commentaire Texte : Pierre Corneille, L’Illusion comique, Acte III, scène IX, 1635
- Corneille, L'Illusion comique, Acte I, scène 1. Commentaire
- Commentaire, L'Illusion Comique, Acte III, Scène 7, Corneille