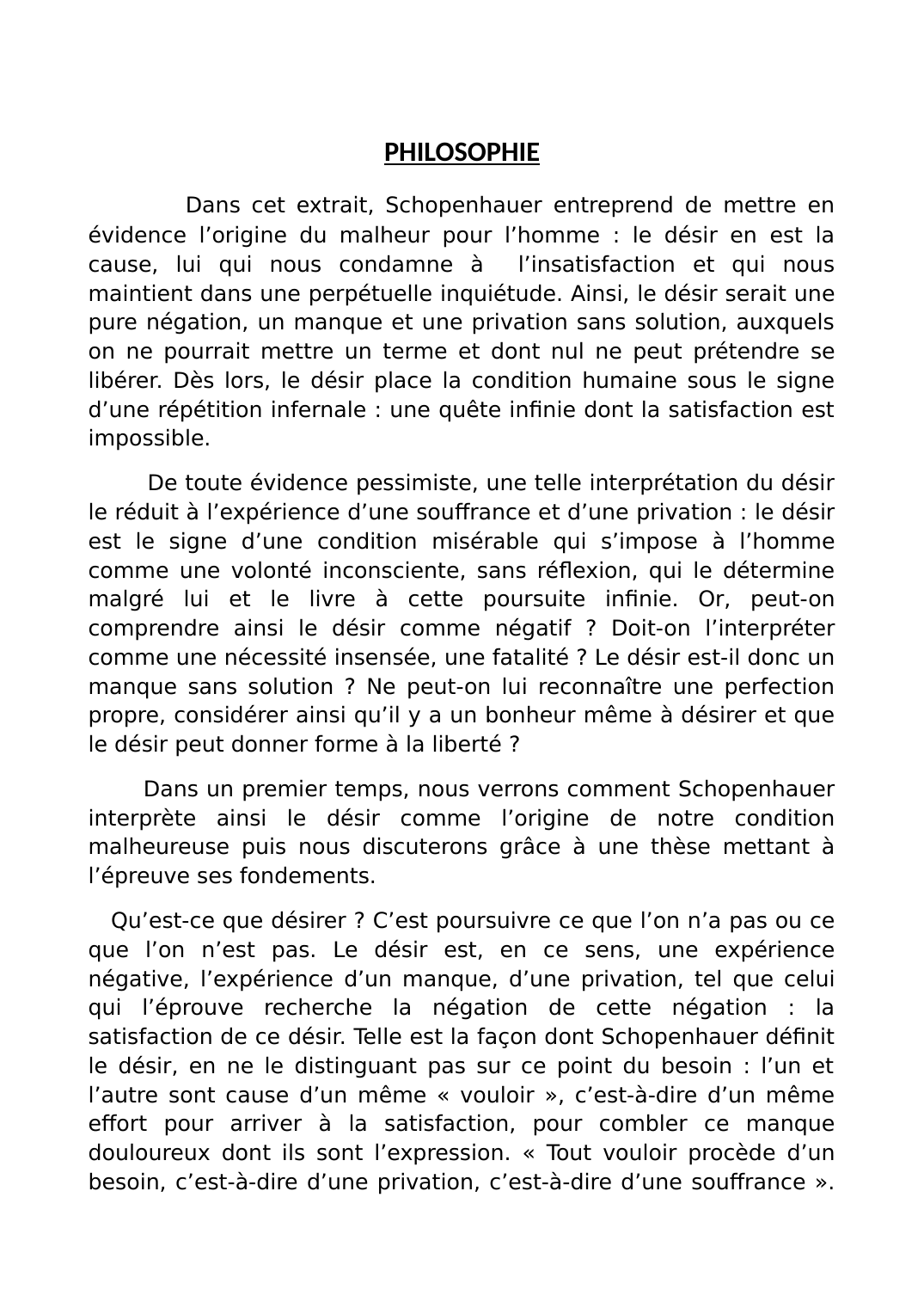Schopenhauer commentaire
Publié le 08/05/2021
Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Schopenhauer commentaire: origine du désir. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Philosophie.
« Tout vouloir procède d’un besoin, c’est-à-dire d’une privation, c’est-à-dire d’une souffrance. La satisfaction y met fin ; mais pour un désir satisfait, dix au moins sont contrariés ; de plus le désir est long, et ses exigences tendent à l’infini ; la satisfaction est courte, et elle est parcimonieusement mesurée. Mais ce contentement suprême n’est lui-même qu’apparent : le désir satisfait fait place aussitôt à un nouveau désir ; le premier est une déception reconnue, le second est une déception non encore reconnue. La satisfaction d’aucun souhait ne peut procurer de contentement durable et inaltérable. C’est comme l’aumône qu’on jette à un mendiant : elle lui sauve aujourd’hui la vie pour prolonger sa misère jusqu’à demain – Tant que notre conscience est remplie par notre volonté, tant que nous sommes asservis à l’impulsion du désir, aux espérances et aux craintes continuelles qu’il fait naître, tant que nous sommes sujets du vouloir, il n’y a pour nous ni bonheur durable, ni repos. Poursuivre ou fuir, craindre le malheur ou chercher la jouissance, c’est en réalité tout un : l’inquiétude d’une volonté toujours exigeante, sous quelque forme qu’elle se manifeste, emplit et trouble sans cesse la conscience ; or, sans repos le véritable bonheur est impossible. Ainsi le sujet du vouloir ressemble à Ixion attaché sur une roue qui ne cesse de tourner ; aux Danaïdes qui puisent toujours pour emplir leur tonneau, à Tantale éternellement altéré »
«
PHILOSOPHIE
Dans cet extrait, Schopenhauer entreprend de mettre en
évidence l’origine du malheur pour l’homme : le désir en est la
cause, lui qui nous condamne à l’insatisfaction et qui nous
maintient dans une perpétuelle inquiétude.
Ainsi, le désir serait une
pure négation, un manque et une privation sans solution, auxquels
on ne pourrait mettre un terme et dont nul ne peut prétendre se
libérer.
Dès lors, le désir place la condition humaine sous le signe
d’une répétition infernale : une quête infinie dont la satisfaction est
impossible.
De toute évidence pessimiste, une telle interprétation du désir
le réduit à l’expérience d’une souffrance et d’une privation : le désir
est le signe d’une condition misérable qui s’impose à l’homme
comme une volonté inconsciente, sans réflexion, qui le détermine
malgré lui et le livre à cette poursuite infinie.
Or, peut-on
comprendre ainsi le désir comme négatif ? Doit-on l’interpréter
comme une nécessité insensée, une fatalité ? Le désir est-il donc un
manque sans solution ? Ne peut-on lui reconnaître une perfection
propre, considérer ainsi qu’il y a un bonheur même à désirer et que
le désir peut donner forme à la liberté ?
Dans un premier temps, nous verrons comment Schopenhauer
interprète ainsi le désir comme l’origine de notre condition
malheureuse puis nous discuterons grâce à une thèse mettant à
l’épreuve ses fondements.
Qu’est-ce que désirer ? C’est poursuivre ce que l’on n’a pas ou ce
que l’on n’est pas.
Le désir est, en ce sens, une expérience
négative, l’expérience d’un manque, d’une privation, tel que celui
qui l’éprouve recherche la négation de cette négation : la
satisfaction de ce désir.
Telle est la façon dont Schopenhauer définit
le désir, en ne le distinguant pas sur ce point du besoin : l’un et
l’autre sont cause d’un même « vouloir », c’est-à-dire d’un même
effort pour arriver à la satisfaction, pour combler ce manque
douloureux dont ils sont l’expression.
« Tout vouloir procède d’un
besoin, c’est-à-dire d’une privation, c’est-à-dire d’une souffrance »..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Arthur Schopenhauer, Essai sur le libre-arbitre - commentaire
- Commentaire d'Histoire de l'art sur le Galate mourant
- COMMENTAIRE DE TEXTE : “Stances à Marquise”, Pierre Corneille (1658)
- commentaire regrets sur ma vieille robe de chambre diderot
- Commentaire de texte Olympe de Gouges - A partir de « Homme, es tu capable d’être juste ? »