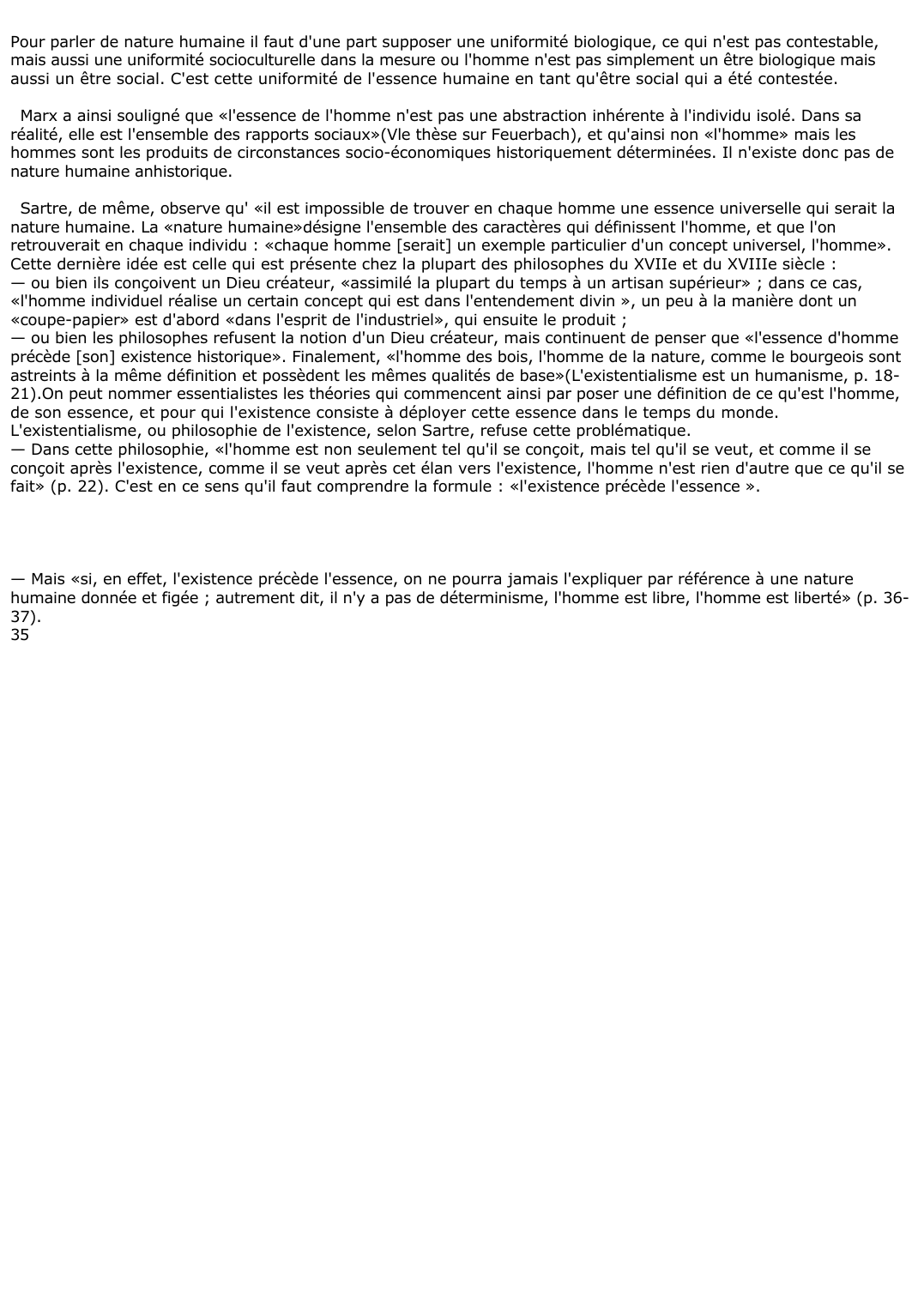Quelle uniformité parmi les hommes faut-il supposer pour parler de nature humaine ?
Publié le 16/05/2020
Extrait du document
«
Pour parler de nature humaine il faut d'une part supposer une uniformité biologique, ce qui n'est pas contestable,mais aussi une uniformité socioculturelle dans la mesure ou l'homme n'est pas simplement un être biologique maisaussi un être social.
C'est cette uniformité de l'essence humaine en tant qu'être social qui a été contestée.
Marx a ainsi souligné que «l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé.
Dans saréalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux»(Vle thèse sur Feuerbach), et qu'ainsi non «l'homme» mais leshommes sont les produits de circonstances socio-économiques historiquement déterminées.
Il n'existe donc pas denature humaine anhistorique.
Sartre, de même, observe qu' «il est impossible de trouver en chaque homme une essence universelle qui serait lanature humaine.
La «nature humaine»désigne l'ensemble des caractères qui définissent l'homme, et que l'onretrouverait en chaque individu : «chaque homme [serait] un exemple particulier d'un concept universel, l'homme».Cette dernière idée est celle qui est présente chez la plupart des philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle :— ou bien ils conçoivent un Dieu créateur, «assimilé la plupart du temps à un artisan supérieur» ; dans ce cas,«l'homme individuel réalise un certain concept qui est dans l'entendement divin », un peu à la manière dont un«coupe-papier» est d'abord «dans l'esprit de l'industriel», qui ensuite le produit ;— ou bien les philosophes refusent la notion d'un Dieu créateur, mais continuent de penser que «l'essence d'hommeprécède [son] existence historique».
Finalement, «l'homme des bois, l'homme de la nature, comme le bourgeois sontastreints à la même définition et possèdent les mêmes qualités de base»(L'existentialisme est un humanisme, p.
18-21).On peut nommer essentialistes les théories qui commencent ainsi par poser une définition de ce qu'est l'homme,de son essence, et pour qui l'existence consiste à déployer cette essence dans le temps du monde.L'existentialisme, ou philosophie de l'existence, selon Sartre, refuse cette problématique.— Dans cette philosophie, «l'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut, et comme il seconçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il sefait» (p.
22).
C'est en ce sens qu'il faut comprendre la formule : «l'existence précède l'essence ».
— Mais «si, en effet, l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais l'expliquer par référence à une naturehumaine donnée et figée ; autrement dit, il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme est liberté» (p.
36-37).35.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans les pensées, Pascal affirme que le moi est haissable et juge sévèrement Montaigne : Le sot projet qu'il a eu de se peindre. En revanche, Voltaire parle du charmant projet que Montaigne a eu de se peindre naïvement comme il l'a fait, car il a peint la nature humaine. Comment faut-il donc considérer l'écriture de soi en général et les diverses entreprises autobiographiques ?
- La littérature vous semble être plutôt un moyen de se divertir c'est à dire de se détourner du monde réel ou un moyen particulier privilégié de rendre compte du monde réel, de la vie des hommes, de la nature humaine ?
- Traité de la nature humaine (extrait)David HumeC'est seulement par la coutume que nous somme déterminés à supposer le futur enconformité avec le passé.
- Étudiez ces réflexions d'Alfred de Vigny sur la vérité dans l'art : « L'ART ne doit jamais être considéré que dans ses rapports avec sa BEAUTÉ IDÉALE. Il faut le dire, ce qu'il y a de VRAI n'est que secondaire; c'est seulement une illusion de plus dont il s'embellit, un de nos penchants qu'il caresse. Il pourrait s'en passer, car la VÉRITÉ dont il doit se nourrir est la vérité d'observation sur la nature humaine, et non l'authenticité du fait. Les noms des personnages ne font rien à la
- Voltaire écrit dans ses Lettres philosophiques : « Il me paraît qu'en général l'esprit dans lequel M. Pascal écrivit ces Pensées était de montrer l'homme sous un jour odieux. Il s'acharne à nous peindre tous méchants et malheureux. Il écrit contre la nature humaine à peu près comme il écrit contre les jésuites. Il impute à l'essence de notre nature ce qui n'appartient qu'à certains hommes. Il dit éloquemment des injures au genre humain. » Expliquer et discuter ce jugement.