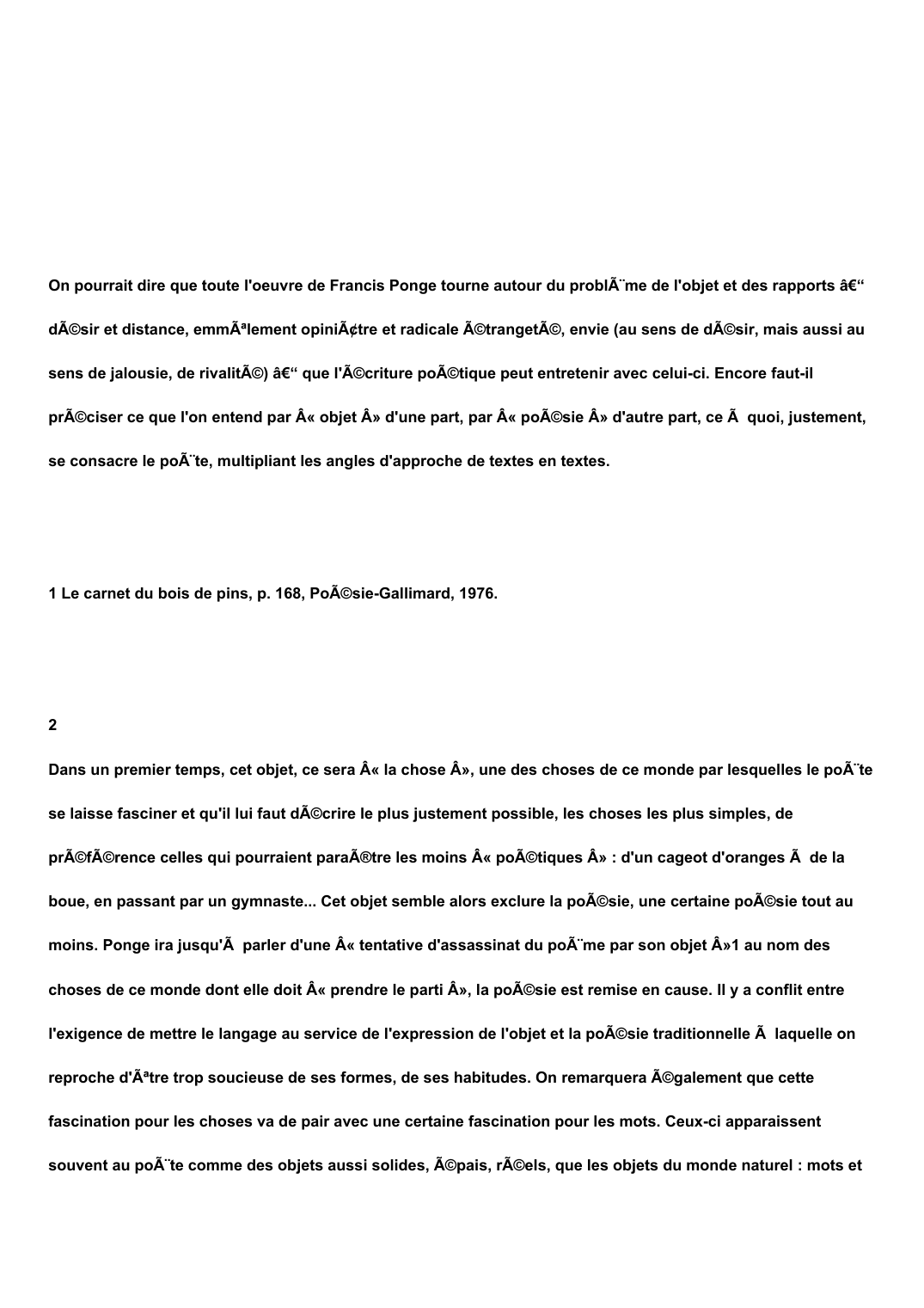ponge
Publié le 08/12/2021
Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : ponge. Ce document contient 7428 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Echange
On pourrait dire que toute l’œuvre de Francis Ponge tourne autour du problème de l’objet et des rapports – désir et distance, emmêlement opiniâtre et radicale étrangeté, envie (au sens de désir, mais aussi au sens de jalousie, de rivalité) – que l’écriture poétique peut entretenir avec celui-ci. Encore faut-il préciser ce que l’on entend par « objet » d’une part, par « poésie » d’autre part, ce à quoi, justement, se consacre le poète, multipliant les angles d’approche de textes en textes.
1 Le carnet du bois de pins, p. 168, Poésie-Gallimard, 1976.
2
Dans un premier temps, cet objet, ce sera « la chose », une des choses de ce monde par lesquelles le poète se laisse fasciner et qu’il lui faut décrire le plus justement possible, les choses les plus simples, de préférence celles qui pourraient paraître les moins « poétiques » : d’un cageot d’oranges à de la boue, en passant par un gymnaste... Cet objet semble alors exclure la poésie, une certaine poésie tout au moins. Ponge ira jusqu’à parler d’une « tentative d’assassinat du poème par son objet »1 au nom des choses de ce monde dont elle doit « prendre le parti », la poésie est remise en cause. Il y a conflit entre l’exigence de mettre le langage au service de l’expression de l’objet et la poésie traditionnelle à laquelle on reproche d’être trop soucieuse de ses formes, de ses habitudes. On remarquera également que cette fascination pour les choses va de pair avec une certaine fascination pour les mots. Ceux-ci apparaissent souvent au poète comme des objets aussi solides, épais, réels, que les objets du monde naturel : mots et choses s’imposent avec la même force en tant qu’objets de prédilection de l’expérience poétique, et notamment en tant qu’« objets naturels » pour ainsi dire. On comprendra alors la dimension essentiellement transitive de l’écriture de Ponge dont tout l’effort consiste à saisir les uns, à manipuler les autres, le plus justement possible. Or cette écriture, en d’autres textes, se retourne sur elle-même, et se prend comme objet.
3
« Le parti-pris des choses » exige une véritable « rage de l’expression ». L’écriture doit se travailler sans cesse, certes afin de mieux coller aux choses, mais aussi en les reléguant dans une certaine mesure à l’arrière-plan : nous verrons dans un deuxième temps comment Francis Ponge se donne comme objet le langage lui-même qu’il s’agit de « réparer » et de porter à son plus haut niveau de fonctionnement. Le poète se plaît alors à faire jouer la langue ainsi qu’un athlète fait jouer ses muscles : c’est cela « l’objeu », une jubilation du langage, un foisonnement en boucle(s), auxquels on aboutit grâce à un objet (au sens premier dont nous parlions), voire au détriment de cet objet...
4
Cependant le retournement jouissif de l’écriture sur elle-même aboutit dans un troisième temps, à un troisième type d’objet (un objet du « troisième type » ?) : ce que j’appellerai « un objet textuel », un texte parfait, sur lequel il n’y a plus à revenir. « L’objeu » ne se contente plus de faire saillir les forces du langage face aux « choses » : il se pétrifie (aux sens neutre et péjoratif du verbe) en un objet autre. Tout se passe comme si l’envie de l’objet débouchait... sur son remplacement. Le poète ne travaille plus seulement à partir d’objets donnés (ou qu’il se donne), choses, mots, et même langage, mais fabrique des objets nouveaux, autonomes en quelque sorte, entrant en concurrence avec les objets du monde extérieur par leur caractère irréductible, tenant par eux-mêmes, sans l’aide de l’auteur et peut-être même sans celle... des lecteurs. Nous verrons en effet comment Francis Ponge conçoit (dans les deux sens du terme) ces « objets textuels » et comment il semble vouloir mettre au point une surprenante stratégie pour faire en sorte que ses textes échappent à toute emprise. Le rêve est alors celui d’un texte absolu, un objet qui, à force d’accomplissement, de plénitude, à force d’être voulu indépendant de toute action de la part d’un sujet, auteur ou lecteur, n’est peut-être plus vraiment, en fin de compte... un objet.
I : L’OBJET, C’EST « LA CHOSE »... ET LE MOT
A : « Le parti-pris des choses »
2 Voir dans Méthodes : « Le murmure », « Le monde muet est notre seule patrie », et « Pratique de la (...)
5
« Donner la parole aux choses », les faire advenir dans le monde humain, celui de l’esprit, du langage : le projet déclaré de Francis Ponge ne manque pas d’ambition. Selon lui2 la littérature (occidentale) s’est toujours beaucoup trop intéressée aux seules idées, aux seuls sentiments, et cela sans satisfaire une dimension essentielle de l’homme, celle qui le lie au monde le plus matériel, aux choses les plus concrètes :
3 « Le murmure », in Méthodes, p. 199, Idées-Gallimard, 1961.
« Supposons en effet que l’homme, las d’être considéré comme un esprit (à convaincre) ou comme un cœur (à troubler), se conçoive un beau jour comme ce qu’il est : quelque chose après tout de plus matériel et de plus opaque, de plus complexe, de plus dense, de mieux lié au monde et de plus lourd à déplacer (de plus difficile à mobiliser) (...)... Il n’en faudrait pas plus pour que tout change, et que la réconciliation de l’homme avec le monde naisse de cette nouvelle prétention. »3
4 « La véritable poésie n’a rien à voir avec ce que l’on trouve actuellement dans les collections poé (...)
5 « Quand je dis que nous devons utiliser ce monde des mots, pour exprimer notre sensibilité au momie (...)
6 « Boue si méprisée, je t’aime ! » (« Ode inachevée à la boue, Pièces, p.61, Poésie-Gallimard).
6
Dans cette optique, le rôle des poètes n’est plus tant d’écrire de beaux vers ou de beaux textes, que de s’efforcer de saisir la réalité dans toutes ses dimensions. La poésie devient essentiellement une quête du réel, le poète un « chercheur » dont l’objet est le monde. Francis Ponge se réclame des « maniaques de la nouvelle étreinte »4 : c’est le monde extérieur aux mots qu’il prétend embrasser. La gageure est d’agir à la frontière de la langue et du monde naturel, cette frontière que Ponge est le premier à déclarer infranchissable5. Qu’importe : la priorité est accordée aux choses naturelles, n’importe lesquelles, même les plus communes6, surtout les plus communes parce que celles-ci sont trop souvent négligées et ainsi refusées à l’esprit humain. Or la fonction primordiale de la poésie :
7 « Le monde muet est notre seule patrie », Méthodes, p. 205.
« C’est de nourrir l’esprit de l’homme en l’abouchant au cosmos. Il suffit d’abaisser notre prétention à dominer la nature et d’élever notre prétention à en faire physiquement partie, pour que la réconciliation ait lieu. (...) L’espoir est donc dans une poésie par laquelle le monde envahisse à ce point l’esprit de l’homme qu’il en perde à peu près la parole, puis réinvente un jargon. »7
7
Selon Ponge, les poètes sont « les ambassadeurs du monde muet ». On comprend à quel point le titre de l’un de ses premiers recueils est significatif : envers et contre tout maniérisme littéraire, à l’encontre de ce que le poète présente par endroits comme une véritable conspiration culturelle, il entend se distinguer par son Parti-pris des choses :
« Que rien désormais ne me fasse revenir de ma détermination : ne sacrifier jamais l’objet de mon étude à la mise en valeur de quelque trouvaille verbale que j’aurai faite à son propos, ni à l’arrangement en poème de plusieurs de ces trouvailles.
8 « Berges de la Loire », La rage de l’expression, p. 9, Poésie-Gallimard, 1957 : les italiques sont (...)
En revenir toujours à l’objet lui-même, à ce qu’il a de brut, de différent : différent en particulier de ce que j’ai déjà (à ce moment) écrit de lui. »8
8
Ainsi quand les mots paraissent l’emporter, l’auteur parle de la « formation d’un abcès poétique » ! Et il faut alors résister au penchant des mots à suivre certaines habitudes d’organisation, de composition, de musicalité, issues d’une longue tradition formelle. Dans « Le carnet du bois de pins », Ponge met en scène cette résistance, montrant comment il est amené à crever un tel « abcès », l’emballement narcissique du langage en quelque sorte, une paradoxale exhibition... de l’emballage. Lorsque les mots se mettent à tourner à vide, lorsque le souci de leur arrangement devient un problème qui prime sur le souci de la chose, lorsque que, durant des pages et des pages, on hésite à propos de telle ou telle disposition des vers, et que les mots détachés de la chose tournoient dans un vertige de virtualités, il faut donner « le coup de reins » nécessaire pour « sortir du manège » et échapper au « ronron poétique ». D’où l’humour libérateur de ce passage du « carnet du bois de pins » où Ponge propose à ses lecteurs de se débrouiller avec une sorte de poésie « en kit », chaque numéro correspondant à un ensemble de vers :
9
« On pourra dès lors disposer ces éléments ad libitum comme suit :
9 La rage de l’expression, p. 141.
12345
14235
12435
14325
12354
14352
13245
13542
23451
(...)
13452
etc. »9
10
La leçon est claire : la poursuite de la forme pour elle-même conduit à l’absurde ! Il faudra donc revenir au bois de pins...
11
Et pourtant un paradoxe est à souligner dont Francis Ponge est tout à fait conscient : le souci de la chose, le parti-pris d’en faire l’objet essentiel de la pratique poétique, amène au premier plan le médium de cette pratique. En quelque sorte : « chassez le souci de la forme, il reviendra au galop ! ». Si le monde envahit vraiment l’esprit de l’homme, celui-ci en perd la parole, nous dit Ponge... Puis il faut réinventer un jargon. C’est dire que la fidélité aux choses implique un travail rigoureux sur la langue. Pas de Parti-pris des choses sans Rage de l’expression : les deux titres déploient deux volets fondamentaux de l’entreprise pongienne. L’auteur du « carnet du bois de pins » semblait se heurter à la tendance du langage à se constituer en objet au détriment de « la chose », mais il lui faut bien, dans le même temps, faire lui-même de ce langage son objet privilégié.
B : Les mots comme objets
10 Méthodes, p. 277.
12
A maintes reprises, Francis Ponge est revenu sur cette idée : pour un poète, les mots sont de véritables objets. Il s’étend assez clairement sur cette question dans un texte très important de Méthodes, « La pratique de la littérature », où il décrit en effet la sensibilité de certains « à un autre monde [que le monde extérieur], entièrement concret également, bizarrement concret, mais concret, qui est le langage, les mots »10. Selon lui, l’artiste est celui qui est sensible aux deux mondes, au « naturel » et à celui de son moyen d’expression :
11 Méthodes, p. 278-279.
« Les mots sont un monde concret, aussi dense, aussi existant que le monde extérieur. Il est là. Pourquoi ? Parce que tous les mots de toutes les langues, et surtout des langues qui ont une littérature (...) et qui ont aussi-comment dirais-je ? qui viennent d’autres langues qui ont déjà eu des monuments, comme le latin, ces mots, chaque mot, c’est une colonne de dictionnaire, c’est une chose qui a une extension, même dans l’espace, dans le dictionnaire, mais c’est aussi une chose qui a une histoire, qui a changé de sens, qui a une, deux, trois, quatre, cinq, six significations. Qui est une chose épaisse, contradictoire souvent, avec une beauté du point de vue phonétique, cette beauté des voyelles, des syllabes, des diphtongues, cette musique... (...) Les mots, c’est bizarrement concret, parce que, si vous pensez... en même temps ils ont, mettons, deux dimensions, pour l’œil et pour l’oreille, et peut-être la troisième c’est quelque chose comme leur signification. »11
12 « Fables logiques », Méthodes, p. 177.
13 « My creative method », Méthodes, pp. 41-42.
13
Le poète est quelqu’un d’étrange, « un vicieux »12 pour qui les mots sont « des matériaux fort difficiles à œuvrer, tous différents, plus vivants encore que les pierres de l’architecte ou les sons du musicien, des êtres d’une espèce monstrueuse, avec un corps susceptible de plusieurs expressions opposées », bref quelqu’un que seul un autre artiste comme Picasso pouvait comprendre : « Vos mots sont comme des statuettes », aurait-il dit à Francis Ponge13... Bref, les mots sont l’objet de toute l’attention de celui-ci, au moment-même où il proclame que la primauté doit être accordée aux choses extérieures au langage. Aussi, à partir du constat de cette double sensibilité à deux objets différents, voire opposés, Ponge en vient à souligner la nécessité de trouver un équilibre entre le « parti-pris des choses » et le « compte-tenu des mots » :
« En somme voici le point important : parti pris des choses égale compte tenu des mots.
14 « My Creative method », Méthodes, p. 20.
Certains textes auront plus de ppc à l’alliage, d’autres plus de ctm... Peu importe. Il faut qu’il y ait en tout cas de l’un et de l’autre. Sinon, rien de fait. »14
14
Il faut garder cette double perpective, ces deux objets autour desquels fonctionne toute entreprise poétique digne de ce nom. Néanmoins, on peut se demander si ces deux objets ont bien le même statut...
C : PPC = CTM ?
15 « La pratique de la littérature », Méthodes, p. 283.
15
Après une période pendant laquelle Francis Ponge a proclamé haut et fort son parti-pris pour les choses, un certain recul paraît s’être opéré à l’égard de ces dernières. Il ne s’agit pas de l’intérêt que le poète leur accorde, et qu’il leur accordera jusqu’à la fin de son œuvre comme si elles en constituaient l’horizon ultime. Mais qui dit horizon, justement, dit éloignement. S’estompe alors le projet de rejoindre les choses du monde extérieur au langage, « d’aboucher l’esprit de l’homme au cosmos ». Reste, au premier plan, le texte. Certes, la frontière entre le monde des mots et le monde naturel a souvent été soulignée par le poète. Dès le départ, il n’était pas question de croire qu’on pouvait par exemple « entrer dans une pomme ». Il s’agissait seulement (!) d’essayer de « faire un texte qui ressembl(ât) à une pomme, c’est-à-dire qui aur(ait) autant de réalité qu’une pomme. Mais dans son genre ». Il s’agissait de faire « un texte qui ait une réalité dans le monde des textes, un peu égale à celle de la pomme dans le monde des objets »15. Cependant ce travail sur le langage passe au premier plan et même si les textes de Ponge continuent de vibrer d’une réelle sensibilité aux choses (« La chèvre », « Le pré »...), ce qui saute aux yeux, de plus en plus, c’est le retournement de ces textes sur eux-mêmes, leur fonctionnement en boucle(s), le foisonnement de la langue plus que la minutieuse fidélité aux choses...
16 Le rapprochement de Francis Ponge avec un poète comme Philippe Jaccottet le montre bien, ce dernier (...)
17 Comment une figue de paroles et pourquoi, Flammarion, 1977 ; ha fabrique du pré, Skira, « Les senti (...)
16
« La rage de l’expression » semble reléguer à l’arrière-plan ces choses au nom desquelles elle survient pourtant. Tout se passe comme si ce processus qui fait du langage un objet de premier plan prenait de plus en plus de place au cours de l’évolution du travail de Francis Ponge, ou plus exactement, comme si le travail du langage, le spectacle de la langue en action, – ce qui va bien au-delà d’un simple compte-tenu de l’opacité et de l’épaisseur des mots16 – devenait l’essentiel. Dès La rage de l’expression l’accumulation des traces de l’écriture dans sa progression laborieuse – redites, conquêtes, stagnations –, paraît encombrer une scène censée être consacrée à l’émergence de la chose. Mais le fait se renforce encore avec la décision du poète de publier ses brouillons17, ce qu’il présente comme un acte très significatif de désacralisation de l’art, comme une démonstration que son œuvre est avant tout une recherche, que son aspect formel – on y revient – importe beaucoup moins que l’effort pour saisir une chose donnée. Pourtant cet effort précisément, ce spectacle de l’écriture en plein travail et se regardant travailler, prend plus de relief que la présence de la chose elle-même...
17
Bref, partant du parti-pris affiché par Ponge de faire des « choses » l’objet essentiel de son entreprise poétique, il semblerait bien que nous soyons parvenus, à force de tellement « tenir compte des mots », à la constitution d’un nouvel objet privilégié : la langue, autrement dit les mots encore, mais non plus comme des « statuettes », comme des objets donnés qu’il convient de modeler ; plutôt les mots en marche, en pleine action, – et se constituant en tant que tels en spectacle, à partir et au-delà des choses. En d’autres termes, la langue est pour Francis Ponge non seulement un objet, mais encore un projet, une tension vers soi-même et une attention à soi-même, bref, un objet qui se prend comme objet.
II : L’OBJET, C’EST LE LANGAGE
A : « Réparer » la parole
18 « La pratique de la littérature », Méthodes, pp. 281-282.
19 Méthodes. p. 80.
18
L’expression n’a certes rien de très élégant, mais elle traduit l’approche très artisanale que Francis Ponge a de son moyen d’expression, de ce qu’il considère comme son matériau de base : le langage, on l’a vu, est quelque chose de très concret, de quasiment matériel, que le poète manie (un peu) comme le sculpteur sculpte du bois pour en faire des statuettes ; comme un bricoleur de génie parvient à faire fonctionner un engin à partir de pièces usagées. Car il s’agirait bien plutôt de réactiver la langue. Celle-ci en effet n’est pas seulement l’objet d’un travail « négatif » : certes, il faut l’asservir à la description des choses, il faut l’empêcher de fonctionner trop librement, trop gratuitement ; mais en même temps, il s’agit aussi de lui donner, ou de lui rendre, une plus grande puissance. La langue n’est pas un objet donné mais un objet à conquérir, à reconquérir. Le poète, selon Francis Ponge, est dans la situation d’un peintre qui aurait à employer un pot de peinture « où tous les peintres depuis l’Antiquité (...) et non seulement tous les peintres, mais tous les concierges, tous les employés de chantiers, tous les paysans ont trempé leur pinceau et puis ont peint avec cela »18. Dès lors, il y a un énorme travail, extrêmement précis, à faire pour trouver le bon mot, le seul possible, en redonnant à ce mot une nouvelle fraîcheur, en réactivant tout le pouvoir de signification qu’il a acquis au cours des siècles. Ponge se sert très souvent pour cela de l’étymologie, retournant puiser dans un outil aussi nécessaire pour lui que le papier et l’encre : le dictionnaire Littré. De cette manière, il peut renouer avec les racines des mots, jouer non seulement avec les différents sens présents de ces derniers mais aussi avec leur histoire, leurs origines, essayant de faire sentir tout leur poids, de les développer dans toutes leurs dimensions. C’est ce qu’il fait par exemple avec l’étymologie du mot « pré », avec le mot « sacripant » qu’il associe de façon surprenante à la couleur rose dans ses « Pochades en prose »19. L’érudition dans ces cas-là ne manque d’ailleurs pas d’être associée à l’humour, et la précision à une certaine désinvolture : que certaines étymologies du Littré soient controversées, Ponge n’en a cure, n’hésitant pas au besoin à en créer lui-même des fantaisistes. Toute entorse à l’exactitude scientifique est légitime dès lors qu’elle se fait au nom d’une plus grande... précision, d’une plus grande fidélité à la chose. Ainsi à propos de l’abricot :
20 « La pratique de la littérature », Méthodes, p. 285.
« Authentiquement j’ai été d’abord sensible à la couleur de l’abricot. C’est une couleur très éclatante, une belle couleur, et c’est ce qui frappe d’abord. Je commence par la couleur abricot qui d’abord nous contacte. « Contacter » c’est prendre contact, fournir le contact. Ce qui est amusant (...), c’est que, il y a quelques semaines, l’Académie française a élu un nouvel académicien. (...) Cet académicien est un ambassadeur de France au Vatican, un homme du monde, très cultivé, très bien. Mais il a dit : « (...) il y a mot qu’il faut absolument supprimer, c’est « contacter » ». J’avais écrit ça, j’étais ennuyé. Puis je me dis : « Très bien, je veux le mettre ». Je suis sûr que je... d’autant plus que la raison certaine de l’impossibilité d’enlever « contacter », c’est parce que la sonorité contacte m’est utile pour l’abricot. »20
19
Au-delà du ton assez humoristique, il faut prendre garde à l’ambition de l’entreprise : elle rejoint à bien des égards, celle de Mallarmé tentant de « rémunérer le défaut des langues ». Ponge se réfère d’ailleurs quelquefois à ce poète. Cependant, le grand modèle qu’il se choisit, qu’il se construit, c’est Malherbe. Réparer la langue ne suffit pas : il faut la porter à son niveau de fonctionnement le plus intense.
B : Pour un Malherbe, ou porter la langue au plus haut
20
Ce n’est pas un hasard, bien sûr, si Ponge choisit un poète qui a participé à une phase fondatrice de la poésie et de la langue françaises, juste après « le laisser-aller » des poètes de la Pléiade, coupables selon notre auteur de ne pas s’être donné assez de règles, et juste avant la rechute de leurs successeurs, coupables d’être restés prisonniers des règles... Pour un Malherbe est un éloge pour le moins enthousiaste, et ce à un point tel qu’il dépasse manifestement le personnage de Malherbe (« chose », si j’ose dire, qui sert donc de prétexte à un autre objet : le texte...). Ponge y élabore en vérité un « art poétique » :
« Cette confusion ou coordination sublime entre Raison et Réson résulte de (ou s’obtient par) la tension maximum de la lyre. Le style concerté. Le concert de vocables.
Malherbe a ôté plusieurs cordes à sa lyre, et d’autant plus tendu celle qu’il conserva.
(...)
Cette vibration de la corde la plus tendue, c’est exactement ce tremblement passionné, ce tremblement de certitude que P. jugeait odieux chez moi, lorsque je venais de lui apporter mes « Proêmes ».
21 Pour un Malherbe, pp. 215-216, Gallimard.
C’est le ton affirmatif du Verbe, tout à fait nécessaire pour qu’il « porte ». C’est le OUI de Racine, le OUI de Mallarmé ; c’est le ton résolu, celui de ce que j’ai appelé la « résolution humaine », celui de la résolution stoïque : « à tout prix la santé, la réjouissance et la joie. » C’est enfin la seule justification de la Parole (prose ou poésie), une fois franchies toutes les raisons de se taire. C’est la décision de parler. »21
22 Ce qui ne correspond nullement à un retour au narcissisme de la forme combattu dans La rage de l’ex (...)
21
On le voit : nous sommes loin du « parti-pris des choses ». La « résolution humaine » dont parle l’auteur ici, c’est ce que nous pourrions appeler le « parti-pris de la parole »22. On voit aussi de quel objet il est maintenant question : la parole, le langage qui s’affirme lui-même. Et ce langage doit se réaliser, réaliser, à l’occasion d’un sujet – autrefois, Ponge disait « chose » –, toutes ses virtualités. Il doit être « tendu » au point que le moindre mot soit porteur du maximum de ses possibilités, contienne, retienne, ce qu’il a pu acquérir, au cours de son histoire, de significations diverses, voire contradictoires. Ce mot devra être placé de telle sorte que ses qualités sonores, visuelles, soient utilisées de la meilleure façon possible. Bref, le langage devra être porté à un état idéal, un état de foisonnement, de jubilation, que Ponge, dans d’autres textes, appellera « l’objoie ». Cependant, cette tension de la parole devenant l’objectif essentiel, l’effacement de la chose paraît consommé. Place à « l’objeu », au jeu (activité ludique et mouvements) de la langue à partir et autour de la « chose » précisément : la dépassant, la débordant de son allégresse.
C : « L’objoie »
22
C’est à propos du « Soleil placé en abîme » (Pièces) que Philippe Sobers, dans les Entretiens qu’il a eus avec Francis Ponge, souligne ce recul de la chose que nous essayons de déterminer :
23 Entretiens de Francis Ponge avec Philippe Sollers, p. 137, Gallimard/Seuil, 1970.
« Tout se passe comme si vous entriez dans un mouvement qui consisterait à exclure l’objet, et en même temps à vous placer, comme scripteur, dans ce que l’on pourrait appeler une disparition du sujet. »23
23
Nous reviendrons sur « la disparition du sujet ». En attendant ce qui nous intéresse maintenant, c’est « l’exclusion de l’objet ». Ponge n’a besoin, pour abonder dans le sens de son interlocuteur, que de citer l’un de ses textes, « Le soleil placé en abîme », dans lequel il définit un genre nouveau :
24 « Le soleil placé en abîme », Pièces, Poésie-Gallimard, p. 137.
« C’est celui où l’objet de notre émotion, placé d’abord en abîme, l’épaisseur vertigineuse et l’absurdité du langage, considérées seules, sont manipulées de telle façon que, par la multiplication intérieure des rapports, les baisons formées au niveau des racines et les significations bouclées à double tour, soit créé ce fonctionnement qui, seul, peut rendre compte de la profondeur substantielle, de la variété, et de la rigoureuse harmonie du monde. »24
24
Notons encore une fois qu’il n’est pas question d’oublier la sensibilité aux choses dont nous parlions précédemment. On pourrait même interpréter ce passage comme un retour relatif au désir « d’aboucher l’esprit humain au cosmos ». Mais ce qui passe néanmoins au premier plan, c’est l’opération sur le langage, le fonctionnement de la parole qui devient à elle-même son propre objet. « La chose » qui provoque toujours l’émotion, qui reste donc essentielle puisqu’elle donne son élan à l’écriture, n’est pas considérée pour elle-même et en elle-même. Elle doit servir désormais à la jubilation de la parole, à cette « floculation » que Ponge décrit d’ailleurs très tôt, dès Méthodes, dans l’article « Tentative orale » (p. 264). Certes, l’auteur parle alors d’une « jubilation de l’objet », lorsque celui-ci « sort de lui-même ses qualités » ; mais ce « bonheur d’expression » est surtout bonheur de l’expression : « un moment où les mots et les idées sont dans une espèce d’état d’indifférence, tout vient à la fois comme symbole, comme vérité, cela veut dire tout ce que l’on veut ». C’est le bonheur de la parole avant tout, qui annonce déjà Le savon :
« Saturée de savon, l’eau mousse au moindre geste.
(...)
25 Le savon, pp. 103-104, Gallimard, 1967.
... Nous en sommes à peu près à ce point. Saturés de notre sujet, pas un mot qui ne se développe en allusions diverses. Nous sommes devenus susceptibles d’une succession indéfinie de bulles, que nous lâchons comme elles nous viennent, isolées ou par groupes et sans trop y toucher (...). »25
26 Ibidem, p. 67.
25
Et « le savon n’est alors qu’un prétexte »26. Le texte lui est au premier plan, devient spectacle et s’enivre de son propre pouvoir, de sa vie portée au plus haut degré d’intensité.
26
Francis Ponge se comporte, si je puis dire, en poète volage : des choses au mots, eux-mêmes considérés à peu près comme des choses et des mots au langage, c’est-à-dire les mots toujours, mais en marche, agencés selon la logique (plus ou moins raisonnable) de « l’objeu » et la perspective de « l’objoie ». Pour schématiser, le poète prend pour objet les choses, et les mots, puis les choses et la parole, afin que celles-là démultiplient celle-ci. Mais ce faisant, il aboutit à un nouvel objet, mimots, mi-chose, et ni seulement mots ni seulement chose, leur produit en quelque sorte qui n’est pas que jubilation du langage, mais sa mutation en un « objet textuel » autonome, aussi consistant, présent, posé, qu’un mot ou qu’une chose.
III : LA FABRICATION D « OBJETS TEXTUELS »
A : Les « objets textuels » au même rang que les « objets naturels »
27 « La pratique de la littérature », Méthodes, p. 282.
27
Au-delà du compte-tenu des choses et du parti-pris des mots (et non l’inverse) auxquels nous sommes arrivés, Ponge en effet entend créer des « objets poétiques » qui, s’ils sont réussis, pourraient compenser le manque qu’éprouve l’esprit humain confronté à l’étrangeté radicale des choses. Puisque la frontière entre le monde de ces dernières et le monde du langage est reconnue infranchissable27, il faut travailler à la production d’objets composés de mots au moins aussi « solides » que les objets du « monde extérieur », et qui eux présentent l’énorme avantage d’être accessibles, assimilables :
28 Ibidem, p. 282-283.
« Il faut que les compositions que vous ne pouvez faire qu’à l’aide de ces sons significatifs, de ces mots, de ces verbes, soient arrangées de telle façon qu’elles imitent la vie des objets du monde extérieur. Imitent, c’est-à-dire qu’elles aient au moins une complexité et une présence égales. Une épaisseur égale. »28
28
Et Pour un Malherbe enfonce le clou :
29 Pour un Malherbe, p. 186.
« A tort ou à raison, et je ne sais pourquoi, j’ai toujours considéré, depuis mon enfance, que les seuls textes valables étaient ceux qui pourraient être inscrits dans la pierre ; (...) ceux qui tiendraient encore comme des objets, placés parmi les objets de la nature : en plein air, au soleil, sous la pluie, dans le vent. »29
29
Des textes ayant la même « tenue », le même poids que les objets du monde extérieur : l’idéal est assez clair. Il s’agit de produire une œuvre pouvant tout simplement rivaliser avec le monde, et dans une certaine mesure, le remplacer. Car au-delà de la volonté de mimer le monde par les moyens de la langue française, il y a aussi l’ambition de compenser l’inaccessibilité de ce monde. Il s’agit de rien moins que de créer un autre monde en quelque sorte, comme le montrait déjà de façon exemplaire un texte de Méthodes :
« C’est de plain-pied que je voudrais qu’on entre dans ce que j’écris. Qu’on s’y trouve à l’aise. Qu’on y trouve tout simple. Qu’on y circule aisément, comme dans une révélation, soit, mais aussi simple que d’habitude. Qu’on y bénéficie du climat de l’évidence : de sa lumière, température, de son harmonie.
30 « Pochades en prose », Méthodes, pp. 67-68.
... Et cependant que tout y soit neuf, inouï : uniment éclairé, un nouveau matin. »30
30
D’une part, il s’agit de « révéler » le monde tel qu’il est, mais que les artistes seuls savent voir et montrer ; d’autre part, Francis Ponge propose à ses lecteurs d’évoluer dans ses textes comme ils pourraient évoluer dans le monde ordinaire. Au bout du compte, il faudrait que « Le carnet du bois de pins » soient aussi présent et réel que le véritable bois dont il est inspiré. C’est dire, encore une fois, que les « objets textuels » acquièrent une existence égale à celle des objets naturels. Reste à savoir comment Ponge entend les « fabriquer ».
B : La fabrication d’« objets textuels » parfaits
« Chaque mot a beaucoup d’habitudes et de puissances ; il faudrait chaque fois les ménager, les employer toutes. Ce serait le comble de la « propriété dans les termes ».
Mais tout mot est obscur s’il voile un coin du texte, s’il fascine comme une étoile, s’il est trop radieux.
31 Pratiques d’écriture, ou l’inachèvement perpétuel, p. 40, Hermann, 1984.
Il faudrait dans la phrase les mots composés à de telles places que la phrase ait un sens pour chacun des sens de chacun de ses termes. Ce serait le comble de « la profondeur logique de la phrase » et vraiment « la vie » par la multiplicité infinie et la nécessité des rapports. »31
31
Il faudrait que le texte fonctionne dans tous les sens, qu’aucun manque ne l’affaiblisse, que, pour un objet donné, il ait tout le poids et la plénitude possibles. « Le comble de la profondeur logique de la phrase », c’est la réalisation de toutes les virtualités du langage à propos d’une « chose » donnée, la réalisation d’un « objet textuel » ayant une telle perfection qu’il ne puisse manquer de s’imposer avec l’évidence d’un objet du monde extérieur. Car les choses sont là, « se tiennent là » (« stabat un volet », reconnaît l’auteur du « Volet, suivi de sa scholie », dans Pièces), irréductibles, indéniables, et tout l’élan, tout le travail du texte pongien est une réaction à ce caractère d’évidence. L’idéal du poète serait de fabriquer un objet fait de mots aussi indépassable. Dans cette optique, le texte devra donc être indépendant de son auteur et indépendant de ses lecteurs dans la mesure où toute lecture est une reprise du texte, une reconstruction. Ce texte devra par conséquent résister à des lectures diverses, contradictoires, les confondre, afin de durer. Il lui faudra dépasser son propre auteur, la « chose » dont il s’est inspiré, et le lecteur. D’où la thématique de la « mort de l’auteur » d’une part, soulignée par Philippe Sollers dans ses Entretiens, et surtout mise en scène dans « Le volet, suivi de sa scholie » par Ponge lui-même :
32 Pièces, p. 105, « Poésie-Gallimard ».
« VOLET PLEIN NE SE PEUT ECRIRE
VOLET PLEIN NAIT ECRIT STRIE
SUR LE LIT DE SON AUTEUR MORT
OU CHACUN VEILLANT A LE LIRE
ENTRE SES LIGNES VOIT LE JOUR. »32
32
D’autre part, nous avons vu ce qu’il en était du recul de la chose. Il nous reste donc à examiner les rapports de Francis Ponge avec ses lecteurs, critiques ou pas. Dans cette perspective, fabriquer un « objet textuel », autrement dit un texte « plein », permet notamment de se mettre à l’abri :
33 Pratique de l’écriture, p. 92.
« Ne pas « avoir de retard », donner au lecteur l’impression qu’on s’est déjà posé toutes les questions qu’il se pose, qu’on s’est placé de tous les points de vue critiques possibles. »33
34 Ibidem, p. 95.
33
On ne peut être plus explicite. Etrange façon de permettre au lecteur de « voir le jour ». Il s’agit ne plus ni moins que de « ne laisser prise à aucune critique en les prévenant toutes dans l’œuvre »34 ! « Dans l’œuvre » : la précision est importante puisqu’elle indique bien que c’est l’objet textuel lui-même qui est chargé de se défendre, par sa plénitude, son caractère évident d’objet « naturel ». Il y a chez Francis Ponge le désir de rendre ses textes en quelque sorte péremptoires, comme s’il s’agissait pour lui de compenser la « violence » des objets du monde extérieurs, ces choses qui échappent à toute emprise, qui s’imposent à lui avec une force irréductible, insurpassable. Or les lectures d’un texte ignorent certains aspects, en privilégient certains autres, un peu comme la perception d’un objet naturel ne nous en permet qu’une approche partielle, ne fait que l’entamer en quelque sorte. Le raisonnement du poète est alors le suivant : si un texte présente assez de complexité, il accède à une épaisseur digne d’une chose. Plus un « objet textuel » sera « plein », plus il aura de chances de résister à l’usure de lectures successives, et donc de durer comme durent les inscriptions dans la pierre, et la pierre elle-même...
34
Cependant, en se dirigeant vers un tel idéal, Francis Ponge pourrait bien en arriver à dépasser (ou à rendre « dépassée ») la notion « d’objet ». En voulant protéger ses textes de toute « érosion » ultérieure, il en vient en effet à mettre au point une stratégie visant à rendre ces textes si présents, au sens spatial comme au sens temporel du terme, qu’une approche englobante de lecture ne soit plus permise. Dès lors, ces textes tendent à l’absolu, et échappent en fin de compte à leur statut d’objet !
C : Du rejet par le texte de son statut « d’objet »
35
La lecture pose problème à l’écrivain dans la mesure où, intervenant après son travail, elle peut le remettre en cause. Et même lorsque cet écrivain a fait en sorte que son texte soit si plein qu’il ne laisse aucune faille dans laquelle pourrait s’engouffrer le lecteur,... on n’est jamais sûr ! Il s’agit par conséquent, tout simplement (!) et radicalement, d’éviter que ce texte ne devienne l’objet d’une emprise trop englobante du lecteur. C’est dans cette perspective que l’on peut lire Le savon et L’écrit Beaubourg.
36
Pour ce qui est de la première œuvre, Ponge a mis au point un procédé original de « neutralisation » de la lecture : un « speaker » allemand est censé dire le texte à des auditeurs, mais il s’efface très vite, n’étant apparu que le temps d’obtenir pour le poète un effet de simultanéité entre lecture et écriture :
« Mesdames et Messieurs,
(...) Vous entendez en ce moment les premières lignes d’un texte,...la lecture de la traduction en allemand d’un texte, originellement écrit en français...
Ecrit donc, non par moi, speaker allemand, dont vous entendez la voix... mais par l’auteur français, qui vous parle par ma voix.
Lui a écrit ceci.
Ou plutôt - s’il parlait lui-même - et, en réalité, par ma voix, il vous parle lui-même - il vous dirait, il vous dit : Non, je n’ai pas écrit ceci, je l’écris, je suis en train de l’écrire, auditeurs allemands, à votre intention.
35 Le savon, pp. 9-10 : les italiques sont de l’auteur.
Je suis en train d’écrire ces premières lignes. Je n’en suis pas plus loin que vous. Je ne suis pas plus avancé que vous. Nous allons avancer, nous avançons déjà, ensemble ; vous écoutant, moi parlant ; embarqués dans la même voiture, ou sur le même bateau. »35
37
Dès lors, la situation de lecture n’est plus celle d’un lecteur qui se penche sur cet objet, un texte « fini », Le savon, mais celle d’un auditeur qui est suspendu aux lèvres d’un locuteur, et même mieux, puisque ce locuteur s’estompe bien vite derrière l’écrivain en train d’écrire, suspendu à la plume de Francis Ponge ! Le poète prétend renoncer à son avance sur le lecteur, avancer de pair avec lui, partageant l’expérience de la création. Et effectivement, dans une certaine mesure, la lecture est bien un recréation de l’œuvre, une réactivation. Cependant, ne pas être « plus loin » que le lecteur, c’est ne pas être loin de lui, c’est ne pas le laisser seul avec le texte, après « la mort de l’auteur » si spectaculairement mise en scène dans « Le volet, suivi de sa scholie ». Ne pas être « en avance » peut-être, mais ne pas être dépassé non plus. En vérité, lorsqu’un auteur livre son... livre aux lecteurs, il est non pas « en avance », mais « en arrière », pire : « à la remorque » de ceux-ci. La fiction d’une simultanéité entre lecture et écriture permet de remédier astucieusement à cette situation angoissante pour l’écrivain : son texte n’est plus un objet livré au lecteur, mais un cheminement sans cesse renouvelé, et renouvelé comme une opération dont il garde le contrôle. Ce contrôle est accentué dans L’écrit-Beaubourg où la position surplombante du lecteur est encore plus radicalement contrée.
38
Dans ce texte en effet, Ponge ne s’efforce pas, comme dans Le savon, de donner dès le début l’impression qu’il est en train d’écrire ce que le lecteur est en train de lire. Il se permet même de parler de ce texte au passé : cela ne lui est pas insupportable dans la mesure où il se situe au-delà de sa situation d’écriture ! Car il fait plus que d’accompagner le lecteur : il le surplombe à son tour :
« Tels ont été les premiers mots venus sur mon écritoire (...) lorsque (...) – je me fus par contrat engagé à écrire, pour être publié à l’occasion de son inauguration [celle du Centre Pompidou], le texte présentement sous vos yeux.
(...)
Oui, tels et en tel lieu, au haut de cette page, venons-nous en effet, de les lire.
(...)
Dès le second paragraphe, pourquoi ce réfrènement tout à coup (...), Pourquoi ce changement d’optique, cette brusque accommodation au plus près ?
36 Premières pages de L’écrit-Beaubourg, éd. Centre Georges-Pompidou, 1977 : c’est nous qui soulignons
Pour nous ramener, bien entendu, à l’urgence, à la seule réalité du moment : à cette piste, cette page même, dont nous continuons, ne me dites pas le contraire, à parcourir présentement les lignes selon lesquelles nous allons, d’un instant à l’autre, être amenés à lire – nous y voici – que, nous référant sans nul doute au Centre Pompidou, nous n’en constituons pourtant (...) rien de plus qu’une sorte d’inauguration textuelle (...). »36
39
On voit que, par une progression très complexe, le texte finit par prendre la lecture à revers en quelque sorte, en se décrivant lui-même non plus comme écriture en train de se faire (Le savon), mais comme lecture. Dans le troisième paragraphe, l’auteur qui jusque là semblait relire seul son propre texte, rejoint d’autres lecteurs, employant au pluriel et non plus au singulier la première personne. L’écrivain non seulement accompagne la lecture, mais en outre l’englobe en la décrivant au présent. La perspective de la description, en effet, s’est progressivement élargie, comprenant d’abord seulement les premiers mots du texte, puis les suivants, puis la lecture de ce texte elle-même. En d’autres termes, ce n’est plus le texte qui est l’objet de la lecture, mais le contraire ! Ce texte est devenu indépassable. Bien plus qu’il n’est l’objet de quelque emprise, en devenant « conscient » de lui-même pour ainsi dire et en rejoignant ses propres lecteurs sur leur terrain, il accède au statut de sujet !
Conclusion
40
L’objet hante toute l’œuvre de Francis Ponge : il en est le point de départ, l’impulsion constante, et l’horizon ultime. Mais cette permanence ne va pas sans mobilité et sans mutations. Les choses, les mots, la langue, et leur produit, sont autant de métamorphoses de cet objet décidément difficile à saisir et difficile à réaliser, et, en fin de compte, à créer. Et c’est peut-être là le nœud de la difficulté : l’écriture pongienne oscille entre re-présentation de l’objet (« la chose » qu’il s’agit de mimer dans le monde du langage) ; re-création (qui est aussi récréation) d’un autre objet, la langue, qui s’accomplit à travers un texte, y réalisant la totalité de ses virtualités à propos d’un sujet donné ; et création d’un objet autre, cet « objet textuel » qui est une condensation de mots à partir d’un motif, une prise du langage, un objet parfait et mieux que cela, un faire qui jamais ne s’interrompt... et finit par remettre en cause la notion d’objet. L’envie de l’objet dans la poésie de Francis Ponge est tantôt soif exigeante, tantôt rivalité impossible et hautaine, tantôt compensation sophistiquée. L’objet confronte l’écriture aux limites de la langue, mais la pousse du même coup à s’y installer, transformant ses limitations en délimitation : elle devient, elle se veut, précisément un objet de langage. L’objet dès lors n’est plus « la chose », cet objet décentré au-delà de l’écriture, mais au contraire un « objeu » recentrant l’écriture qui devient à elle-même son propre objet, et finit par accéder, d’une certaine manière, à la dignité de sujet.
41
Et en même temps, « la chose » dont nous sommes partis demeure une perspective primordiale, un repère, le point alpha et oméga de l’écriture, le cœur lointain et inaccessible de la poésie. Ne pouvant rejoindre le monde « extérieur », celle-ci ne s’en détourne pas pour autant, tourne au contraire autour de lui, « décolle » grâce à lui, faute de décoller vers lui :
37 Pour un Malherbe, p. 62.
« Le Temps (LE Temps : je veux dire la ténacité, le travail) débouchant dans l’intemporel. Une minute de plus à vivre, à peiner encore, et c’est l’éternité. La fusée dans la stratosphère, qui finit, à force de relancer son désir [le texte à force de relancer son envie...], par échapper à l’attraction, et entrer dans l’harmonie des sphères, dans l’horlogerie universelle. »37
On pourrait dire que toute l’œuvre de Francis Ponge tourne autour du problème de l’objet et des rapports – désir et distance, emmêlement opiniâtre et radicale étrangeté, envie (au sens de désir, mais aussi au sens de jalousie, de rivalité) – que l’écriture poétique peut entretenir avec celui-ci. Encore faut-il préciser ce que l’on entend par « objet » d’une part, par « poésie » d’autre part, ce à quoi, justement, se consacre le poète, multipliant les angles d’approche de textes en textes.
1 Le carnet du bois de pins, p. 168, Poésie-Gallimard, 1976.
2
Dans un premier temps, cet objet, ce sera « la chose », une des choses de ce monde par lesquelles le poète se laisse fasciner et qu’il lui faut décrire le plus justement possible, les choses les plus simples, de préférence celles qui pourraient paraître les moins « poétiques » : d’un cageot d’oranges à de la boue, en passant par un gymnaste... Cet objet semble alors exclure la poésie, une certaine poésie tout au moins. Ponge ira jusqu’à parler d’une « tentative d’assassinat du poème par son objet »1 au nom des choses de ce monde dont elle doit « prendre le parti », la poésie est remise en cause. Il y a conflit entre l’exigence de mettre le langage au service de l’expression de l’objet et la poésie traditionnelle à laquelle on reproche d’être trop soucieuse de ses formes, de ses habitudes. On remarquera également que cette fascination pour les choses va de pair avec une certaine fascination pour les mots. Ceux-ci apparaissent souvent au poète comme des objets aussi solides, épais, réels, que les objets du monde naturel : mots et choses s’imposent avec la même force en tant qu’objets de prédilection de l’expérience poétique, et notamment en tant qu’« objets naturels » pour ainsi dire. On comprendra alors la dimension essentiellement transitive de l’écriture de Ponge dont tout l’effort consiste à saisir les uns, à manipuler les autres, le plus justement possible. Or cette écriture, en d’autres textes, se retourne sur elle-même, et se prend comme objet.
3
« Le parti-pris des choses » exige une véritable « rage de l’expression ». L’écriture doit se travailler sans cesse, certes afin de mieux coller aux choses, mais aussi en les reléguant dans une certaine mesure à l’arrière-plan : nous verrons dans un deuxième temps comment Francis Ponge se donne comme objet le langage lui-même qu’il s’agit de « réparer » et de porter à son plus haut niveau de fonctionnement. Le poète se plaît alors à faire jouer la langue ainsi qu’un athlète fait jouer ses muscles : c’est cela « l’objeu », une jubilation du langage, un foisonnement en boucle(s), auxquels on aboutit grâce à un objet (au sens premier dont nous parlions), voire au détriment de cet objet...
4
Cependant le retournement jouissif de l’écriture sur elle-même aboutit dans un troisième temps, à un troisième type d’objet (un objet du « troisième type » ?) : ce que j’appellerai « un objet textuel », un texte parfait, sur lequel il n’y a plus à revenir. « L’objeu » ne se contente plus de faire saillir les forces du langage face aux « choses » : il se pétrifie (aux sens neutre et péjoratif du verbe) en un objet autre. Tout se passe comme si l’envie de l’objet débouchait... sur son remplacement. Le poète ne travaille plus seulement à partir d’objets donnés (ou qu’il se donne), choses, mots, et même langage, mais fabrique des objets nouveaux, autonomes en quelque sorte, entrant en concurrence avec les objets du monde extérieur par leur caractère irréductible, tenant par eux-mêmes, sans l’aide de l’auteur et peut-être même sans celle... des lecteurs. Nous verrons en effet comment Francis Ponge conçoit (dans les deux sens du terme) ces « objets textuels » et comment il semble vouloir mettre au point une surprenante stratégie pour faire en sorte que ses textes échappent à toute emprise. Le rêve est alors celui d’un texte absolu, un objet qui, à force d’accomplissement, de plénitude, à force d’être voulu indépendant de toute action de la part d’un sujet, auteur ou lecteur, n’est peut-être plus vraiment, en fin de compte... un objet.
I : L’OBJET, C’EST « LA CHOSE »... ET LE MOT
A : « Le parti-pris des choses »
2 Voir dans Méthodes : « Le murmure », « Le monde muet est notre seule patrie », et « Pratique de la (...)
5
« Donner la parole aux choses », les faire advenir dans le monde humain, celui de l’esprit, du langage : le projet déclaré de Francis Ponge ne manque pas d’ambition. Selon lui2 la littérature (occidentale) s’est toujours beaucoup trop intéressée aux seules idées, aux seuls sentiments, et cela sans satisfaire une dimension essentielle de l’homme, celle qui le lie au monde le plus matériel, aux choses les plus concrètes :
3 « Le murmure », in Méthodes, p. 199, Idées-Gallimard, 1961.
« Supposons en effet que l’homme, las d’être considéré comme un esprit (à convaincre) ou comme un cœur (à troubler), se conçoive un beau jour comme ce qu’il est : quelque chose après tout de plus matériel et de plus opaque, de plus complexe, de plus dense, de mieux lié au monde et de plus lourd à déplacer (de plus difficile à mobiliser) (...)... Il n’en faudrait pas plus pour que tout change, et que la réconciliation de l’homme avec le monde naisse de cette nouvelle prétention. »3
4 « La véritable poésie n’a rien à voir avec ce que l’on trouve actuellement dans les collections poé (...)
5 « Quand je dis que nous devons utiliser ce monde des mots, pour exprimer notre sensibilité au momie (...)
6 « Boue si méprisée, je t’aime ! » (« Ode inachevée à la boue, Pièces, p.61, Poésie-Gallimard).
6
Dans cette optique, le rôle des poètes n’est plus tant d’écrire de beaux vers ou de beaux textes, que de s’efforcer de saisir la réalité dans toutes ses dimensions. La poésie devient essentiellement une quête du réel, le poète un « chercheur » dont l’objet est le monde. Francis Ponge se réclame des « maniaques de la nouvelle étreinte »4 : c’est le monde extérieur aux mots qu’il prétend embrasser. La gageure est d’agir à la frontière de la langue et du monde naturel, cette frontière que Ponge est le premier à déclarer infranchissable5. Qu’importe : la priorité est accordée aux choses naturelles, n’importe lesquelles, même les plus communes6, surtout les plus communes parce que celles-ci sont trop souvent négligées et ainsi refusées à l’esprit humain. Or la fonction primordiale de la poésie :
7 « Le monde muet est notre seule patrie », Méthodes, p. 205.
« C’est de nourrir l’esprit de l’homme en l’abouchant au cosmos. Il suffit d’abaisser notre prétention à dominer la nature et d’élever notre prétention à en faire physiquement partie, pour que la réconciliation ait lieu. (...) L’espoir est donc dans une poésie par laquelle le monde envahisse à ce point l’esprit de l’homme qu’il en perde à peu près la parole, puis réinvente un jargon. »7
7
Selon Ponge, les poètes sont « les ambassadeurs du monde muet ». On comprend à quel point le titre de l’un de ses premiers recueils est significatif : envers et contre tout maniérisme littéraire, à l’encontre de ce que le poète présente par endroits comme une véritable conspiration culturelle, il entend se distinguer par son Parti-pris des choses :
« Que rien désormais ne me fasse revenir de ma détermination : ne sacrifier jamais l’objet de mon étude à la mise en valeur de quelque trouvaille verbale que j’aurai faite à son propos, ni à l’arrangement en poème de plusieurs de ces trouvailles.
8 « Berges de la Loire », La rage de l’expression, p. 9, Poésie-Gallimard, 1957 : les italiques sont (...)
En revenir toujours à l’objet lui-même, à ce qu’il a de brut, de différent : différent en particulier de ce que j’ai déjà (à ce moment) écrit de lui. »8
8
Ainsi quand les mots paraissent l’emporter, l’auteur parle de la « formation d’un abcès poétique » ! Et il faut alors résister au penchant des mots à suivre certaines habitudes d’organisation, de composition, de musicalité, issues d’une longue tradition formelle. Dans « Le carnet du bois de pins », Ponge met en scène cette résistance, montrant comment il est amené à crever un tel « abcès », l’emballement narcissique du langage en quelque sorte, une paradoxale exhibition... de l’emballage. Lorsque les mots se mettent à tourner à vide, lorsque le souci de leur arrangement devient un problème qui prime sur le souci de la chose, lorsque que, durant des pages et des pages, on hésite à propos de telle ou telle disposition des vers, et que les mots détachés de la chose tournoient dans un vertige de virtualités, il faut donner « le coup de reins » nécessaire pour « sortir du manège » et échapper au « ronron poétique ». D’où l’humour libérateur de ce passage du « carnet du bois de pins » où Ponge propose à ses lecteurs de se débrouiller avec une sorte de poésie « en kit », chaque numéro correspondant à un ensemble de vers :
9
« On pourra dès lors disposer ces éléments ad libitum comme suit :
9 La rage de l’expression, p. 141.
12345
14235
12435
14325
12354
14352
13245
13542
23451
(...)
13452
etc. »9
10
La leçon est claire : la poursuite de la forme pour elle-même conduit à l’absurde ! Il faudra donc revenir au bois de pins...
11
Et pourtant un paradoxe est à souligner dont Francis Ponge est tout à fait conscient : le souci de la chose, le parti-pris d’en faire l’objet essentiel de la pratique poétique, amène au premier plan le médium de cette pratique. En quelque sorte : « chassez le souci de la forme, il reviendra au galop ! ». Si le monde envahit vraiment l’esprit de l’homme, celui-ci en perd la parole, nous dit Ponge... Puis il faut réinventer un jargon. C’est dire que la fidélité aux choses implique un travail rigoureux sur la langue. Pas de Parti-pris des choses sans Rage de l’expression : les deux titres déploient deux volets fondamentaux de l’entreprise pongienne. L’auteur du « carnet du bois de pins » semblait se heurter à la tendance du langage à se constituer en objet au détriment de « la chose », mais il lui faut bien, dans le même temps, faire lui-même de ce langage son objet privilégié.
B : Les mots comme objets
10 Méthodes, p. 277.
12
A maintes reprises, Francis Ponge est revenu sur cette idée : pour un poète, les mots sont de véritables objets. Il s’étend assez clairement sur cette question dans un texte très important de Méthodes, « La pratique de la littérature », où il décrit en effet la sensibilité de certains « à un autre monde [que le monde extérieur], entièrement concret également, bizarrement concret, mais concret, qui est le langage, les mots »10. Selon lui, l’artiste est celui qui est sensible aux deux mondes, au « naturel » et à celui de son moyen d’expression :
11 Méthodes, p. 278-279.
« Les mots sont un monde concret, aussi dense, aussi existant que le monde extérieur. Il est là. Pourquoi ? Parce que tous les mots de toutes les langues, et surtout des langues qui ont une littérature (...) et qui ont aussi-comment dirais-je ? qui viennent d’autres langues qui ont déjà eu des monuments, comme le latin, ces mots, chaque mot, c’est une colonne de dictionnaire, c’est une chose qui a une extension, même dans l’espace, dans le dictionnaire, mais c’est aussi une chose qui a une histoire, qui a changé de sens, qui a une, deux, trois, quatre, cinq, six significations. Qui est une chose épaisse, contradictoire souvent, avec une beauté du point de vue phonétique, cette beauté des voyelles, des syllabes, des diphtongues, cette musique... (...) Les mots, c’est bizarrement concret, parce que, si vous pensez... en même temps ils ont, mettons, deux dimensions, pour l’œil et pour l’oreille, et peut-être la troisième c’est quelque chose comme leur signification. »11
12 « Fables logiques », Méthodes, p. 177.
13 « My creative method », Méthodes, pp. 41-42.
13
Le poète est quelqu’un d’étrange, « un vicieux »12 pour qui les mots sont « des matériaux fort difficiles à œuvrer, tous différents, plus vivants encore que les pierres de l’architecte ou les sons du musicien, des êtres d’une espèce monstrueuse, avec un corps susceptible de plusieurs expressions opposées », bref quelqu’un que seul un autre artiste comme Picasso pouvait comprendre : « Vos mots sont comme des statuettes », aurait-il dit à Francis Ponge13... Bref, les mots sont l’objet de toute l’attention de celui-ci, au moment-même où il proclame que la primauté doit être accordée aux choses extérieures au langage. Aussi, à partir du constat de cette double sensibilité à deux objets différents, voire opposés, Ponge en vient à souligner la nécessité de trouver un équilibre entre le « parti-pris des choses » et le « compte-tenu des mots » :
« En somme voici le point important : parti pris des choses égale compte tenu des mots.
14 « My Creative method », Méthodes, p. 20.
Certains textes auront plus de ppc à l’alliage, d’autres plus de ctm... Peu importe. Il faut qu’il y ait en tout cas de l’un et de l’autre. Sinon, rien de fait. »14
14
Il faut garder cette double perpective, ces deux objets autour desquels fonctionne toute entreprise poétique digne de ce nom. Néanmoins, on peut se demander si ces deux objets ont bien le même statut...
C : PPC = CTM ?
15 « La pratique de la littérature », Méthodes, p. 283.
15
Après une période pendant laquelle Francis Ponge a proclamé haut et fort son parti-pris pour les choses, un certain recul paraît s’être opéré à l’égard de ces dernières. Il ne s’agit pas de l’intérêt que le poète leur accorde, et qu’il leur accordera jusqu’à la fin de son œuvre comme si elles en constituaient l’horizon ultime. Mais qui dit horizon, justement, dit éloignement. S’estompe alors le projet de rejoindre les choses du monde extérieur au langage, « d’aboucher l’esprit de l’homme au cosmos ». Reste, au premier plan, le texte. Certes, la frontière entre le monde des mots et le monde naturel a souvent été soulignée par le poète. Dès le départ, il n’était pas question de croire qu’on pouvait par exemple « entrer dans une pomme ». Il s’agissait seulement (!) d’essayer de « faire un texte qui ressembl(ât) à une pomme, c’est-à-dire qui aur(ait) autant de réalité qu’une pomme. Mais dans son genre ». Il s’agissait de faire « un texte qui ait une réalité dans le monde des textes, un peu égale à celle de la pomme dans le monde des objets »15. Cependant ce travail sur le langage passe au premier plan et même si les textes de Ponge continuent de vibrer d’une réelle sensibilité aux choses (« La chèvre », « Le pré »...), ce qui saute aux yeux, de plus en plus, c’est le retournement de ces textes sur eux-mêmes, leur fonctionnement en boucle(s), le foisonnement de la langue plus que la minutieuse fidélité aux choses...
16 Le rapprochement de Francis Ponge avec un poète comme Philippe Jaccottet le montre bien, ce dernier (...)
17 Comment une figue de paroles et pourquoi, Flammarion, 1977 ; ha fabrique du pré, Skira, « Les senti (...)
16
« La rage de l’expression » semble reléguer à l’arrière-plan ces choses au nom desquelles elle survient pourtant. Tout se passe comme si ce processus qui fait du langage un objet de premier plan prenait de plus en plus de place au cours de l’évolution du travail de Francis Ponge, ou plus exactement, comme si le travail du langage, le spectacle de la langue en action, – ce qui va bien au-delà d’un simple compte-tenu de l’opacité et de l’épaisseur des mots16 – devenait l’essentiel. Dès La rage de l’expression l’accumulation des traces de l’écriture dans sa progression laborieuse – redites, conquêtes, stagnations –, paraît encombrer une scène censée être consacrée à l’émergence de la chose. Mais le fait se renforce encore avec la décision du poète de publier ses brouillons17, ce qu’il présente comme un acte très significatif de désacralisation de l’art, comme une démonstration que son œuvre est avant tout une recherche, que son aspect formel – on y revient – importe beaucoup moins que l’effort pour saisir une chose donnée. Pourtant cet effort précisément, ce spectacle de l’écriture en plein travail et se regardant travailler, prend plus de relief que la présence de la chose elle-même...
17
Bref, partant du parti-pris affiché par Ponge de faire des « choses » l’objet essentiel de son entreprise poétique, il semblerait bien que nous soyons parvenus, à force de tellement « tenir compte des mots », à la constitution d’un nouvel objet privilégié : la langue, autrement dit les mots encore, mais non plus comme des « statuettes », comme des objets donnés qu’il convient de modeler ; plutôt les mots en marche, en pleine action, – et se constituant en tant que tels en spectacle, à partir et au-delà des choses. En d’autres termes, la langue est pour Francis Ponge non seulement un objet, mais encore un projet, une tension vers soi-même et une attention à soi-même, bref, un objet qui se prend comme objet.
II : L’OBJET, C’EST LE LANGAGE
A : « Réparer » la parole
18 « La pratique de la littérature », Méthodes, pp. 281-282.
19 Méthodes. p. 80.
18
L’expression n’a certes rien de très élégant, mais elle traduit l’approche très artisanale que Francis Ponge a de son moyen d’expression, de ce qu’il considère comme son matériau de base : le langage, on l’a vu, est quelque chose de très concret, de quasiment matériel, que le poète manie (un peu) comme le sculpteur sculpte du bois pour en faire des statuettes ; comme un bricoleur de génie parvient à faire fonctionner un engin à partir de pièces usagées. Car il s’agirait bien plutôt de réactiver la langue. Celle-ci en effet n’est pas seulement l’objet d’un travail « négatif » : certes, il faut l’asservir à la description des choses, il faut l’empêcher de fonctionner trop librement, trop gratuitement ; mais en même temps, il s’agit aussi de lui donner, ou de lui rendre, une plus grande puissance. La langue n’est pas un objet donné mais un objet à conquérir, à reconquérir. Le poète, selon Francis Ponge, est dans la situation d’un peintre qui aurait à employer un pot de peinture « où tous les peintres depuis l’Antiquité (...) et non seulement tous les peintres, mais tous les concierges, tous les employés de chantiers, tous les paysans ont trempé leur pinceau et puis ont peint avec cela »18. Dès lors, il y a un énorme travail, extrêmement précis, à faire pour trouver le bon mot, le seul possible, en redonnant à ce mot une nouvelle fraîcheur, en réactivant tout le pouvoir de signification qu’il a acquis au cours des siècles. Ponge se sert très souvent pour cela de l’étymologie, retournant puiser dans un outil aussi nécessaire pour lui que le papier et l’encre : le dictionnaire Littré. De cette manière, il peut renouer avec les racines des mots, jouer non seulement avec les différents sens présents de ces derniers mais aussi avec leur histoire, leurs origines, essayant de faire sentir tout leur poids, de les développer dans toutes leurs dimensions. C’est ce qu’il fait par exemple avec l’étymologie du mot « pré », avec le mot « sacripant » qu’il associe de façon surprenante à la couleur rose dans ses « Pochades en prose »19. L’érudition dans ces cas-là ne manque d’ailleurs pas d’être associée à l’humour, et la précision à une certaine désinvolture : que certaines étymologies du Littré soient controversées, Ponge n’en a cure, n’hésitant pas au besoin à en créer lui-même des fantaisistes. Toute entorse à l’exactitude scientifique est légitime dès lors qu’elle se fait au nom d’une plus grande... précision, d’une plus grande fidélité à la chose. Ainsi à propos de l’abricot :
20 « La pratique de la littérature », Méthodes, p. 285.
« Authentiquement j’ai été d’abord sensible à la couleur de l’abricot. C’est une couleur très éclatante, une belle couleur, et c’est ce qui frappe d’abord. Je commence par la couleur abricot qui d’abord nous contacte. « Contacter » c’est prendre contact, fournir le contact. Ce qui est amusant (...), c’est que, il y a quelques semaines, l’Académie française a élu un nouvel académicien. (...) Cet académicien est un ambassadeur de France au Vatican, un homme du monde, très cultivé, très bien. Mais il a dit : « (...) il y a mot qu’il faut absolument supprimer, c’est « contacter » ». J’avais écrit ça, j’étais ennuyé. Puis je me dis : « Très bien, je veux le mettre ». Je suis sûr que je... d’autant plus que la raison certaine de l’impossibilité d’enlever « contacter », c’est parce que la sonorité contacte m’est utile pour l’abricot. »20
19
Au-delà du ton assez humoristique, il faut prendre garde à l’ambition de l’entreprise : elle rejoint à bien des égards, celle de Mallarmé tentant de « rémunérer le défaut des langues ». Ponge se réfère d’ailleurs quelquefois à ce poète. Cependant, le grand modèle qu’il se choisit, qu’il se construit, c’est Malherbe. Réparer la langue ne suffit pas : il faut la porter à son niveau de fonctionnement le plus intense.
B : Pour un Malherbe, ou porter la langue au plus haut
20
Ce n’est pas un hasard, bien sûr, si Ponge choisit un poète qui a participé à une phase fondatrice de la poésie et de la langue françaises, juste après « le laisser-aller » des poètes de la Pléiade, coupables selon notre auteur de ne pas s’être donné assez de règles, et juste avant la rechute de leurs successeurs, coupables d’être restés prisonniers des règles... Pour un Malherbe est un éloge pour le moins enthousiaste, et ce à un point tel qu’il dépasse manifestement le personnage de Malherbe (« chose », si j’ose dire, qui sert donc de prétexte à un autre objet : le texte...). Ponge y élabore en vérité un « art poétique » :
« Cette confusion ou coordination sublime entre Raison et Réson résulte de (ou s’obtient par) la tension maximum de la lyre. Le style concerté. Le concert de vocables.
Malherbe a ôté plusieurs cordes à sa lyre, et d’autant plus tendu celle qu’il conserva.
(...)
Cette vibration de la corde la plus tendue, c’est exactement ce tremblement passionné, ce tremblement de certitude que P. jugeait odieux chez moi, lorsque je venais de lui apporter mes « Proêmes ».
21 Pour un Malherbe, pp. 215-216, Gallimard.
C’est le ton affirmatif du Verbe, tout à fait nécessaire pour qu’il « porte ». C’est le OUI de Racine, le OUI de Mallarmé ; c’est le ton résolu, celui de ce que j’ai appelé la « résolution humaine », celui de la résolution stoïque : « à tout prix la santé, la réjouissance et la joie. » C’est enfin la seule justification de la Parole (prose ou poésie), une fois franchies toutes les raisons de se taire. C’est la décision de parler. »21
22 Ce qui ne correspond nullement à un retour au narcissisme de la forme combattu dans La rage de l’ex (...)
21
On le voit : nous sommes loin du « parti-pris des choses ». La « résolution humaine » dont parle l’auteur ici, c’est ce que nous pourrions appeler le « parti-pris de la parole »22. On voit aussi de quel objet il est maintenant question : la parole, le langage qui s’affirme lui-même. Et ce langage doit se réaliser, réaliser, à l’occasion d’un sujet – autrefois, Ponge disait « chose » –, toutes ses virtualités. Il doit être « tendu » au point que le moindre mot soit porteur du maximum de ses possibilités, contienne, retienne, ce qu’il a pu acquérir, au cours de son histoire, de significations diverses, voire contradictoires. Ce mot devra être placé de telle sorte que ses qualités sonores, visuelles, soient utilisées de la meilleure façon possible. Bref, le langage devra être porté à un état idéal, un état de foisonnement, de jubilation, que Ponge, dans d’autres textes, appellera « l’objoie ». Cependant, cette tension de la parole devenant l’objectif essentiel, l’effacement de la chose paraît consommé. Place à « l’objeu », au jeu (activité ludique et mouvements) de la langue à partir et autour de la « chose » précisément : la dépassant, la débordant de son allégresse.
C : « L’objoie »
22
C’est à propos du « Soleil placé en abîme » (Pièces) que Philippe Sobers, dans les Entretiens qu’il a eus avec Francis Ponge, souligne ce recul de la chose que nous essayons de déterminer :
23 Entretiens de Francis Ponge avec Philippe Sollers, p. 137, Gallimard/Seuil, 1970.
« Tout se passe comme si vous entriez dans un mouvement qui consisterait à exclure l’objet, et en même temps à vous placer, comme scripteur, dans ce que l’on pourrait appeler une disparition du sujet. »23
23
Nous reviendrons sur « la disparition du sujet ». En attendant ce qui nous intéresse maintenant, c’est « l’exclusion de l’objet ». Ponge n’a besoin, pour abonder dans le sens de son interlocuteur, que de citer l’un de ses textes, « Le soleil placé en abîme », dans lequel il définit un genre nouveau :
24 « Le soleil placé en abîme », Pièces, Poésie-Gallimard, p. 137.
« C’est celui où l’objet de notre émotion, placé d’abord en abîme, l’épaisseur vertigineuse et l’absurdité du langage, considérées seules, sont manipulées de telle façon que, par la multiplication intérieure des rapports, les baisons formées au niveau des racines et les significations bouclées à double tour, soit créé ce fonctionnement qui, seul, peut rendre compte de la profondeur substantielle, de la variété, et de la rigoureuse harmonie du monde. »24
24
Notons encore une fois qu’il n’est pas question d’oublier la sensibilité aux choses dont nous parlions précédemment. On pourrait même interpréter ce passage comme un retour relatif au désir « d’aboucher l’esprit humain au cosmos ». Mais ce qui passe néanmoins au premier plan, c’est l’opération sur le langage, le fonctionnement de la parole qui devient à elle-même son propre objet. « La chose » qui provoque toujours l’émotion, qui reste donc essentielle puisqu’elle donne son élan à l’écriture, n’est pas considérée pour elle-même et en elle-même. Elle doit servir désormais à la jubilation de la parole, à cette « floculation » que Ponge décrit d’ailleurs très tôt, dès Méthodes, dans l’article « Tentative orale » (p. 264). Certes, l’auteur parle alors d’une « jubilation de l’objet », lorsque celui-ci « sort de lui-même ses qualités » ; mais ce « bonheur d’expression » est surtout bonheur de l’expression : « un moment où les mots et les idées sont dans une espèce d’état d’indifférence, tout vient à la fois comme symbole, comme vérité, cela veut dire tout ce que l’on veut ». C’est le bonheur de la parole avant tout, qui annonce déjà Le savon :
« Saturée de savon, l’eau mousse au moindre geste.
(...)
25 Le savon, pp. 103-104, Gallimard, 1967.
... Nous en sommes à peu près à ce point. Saturés de notre sujet, pas un mot qui ne se développe en allusions diverses. Nous sommes devenus susceptibles d’une succession indéfinie de bulles, que nous lâchons comme elles nous viennent, isolées ou par groupes et sans trop y toucher (...). »25
26 Ibidem, p. 67.
25
Et « le savon n’est alors qu’un prétexte »26. Le texte lui est au premier plan, devient spectacle et s’enivre de son propre pouvoir, de sa vie portée au plus haut degré d’intensité.
26
Francis Ponge se comporte, si je puis dire, en poète volage : des choses au mots, eux-mêmes considérés à peu près comme des choses et des mots au langage, c’est-à-dire les mots toujours, mais en marche, agencés selon la logique (plus ou moins raisonnable) de « l’objeu » et la perspective de « l’objoie ». Pour schématiser, le poète prend pour objet les choses, et les mots, puis les choses et la parole, afin que celles-là démultiplient celle-ci. Mais ce faisant, il aboutit à un nouvel objet, mimots, mi-chose, et ni seulement mots ni seulement chose, leur produit en quelque sorte qui n’est pas que jubilation du langage, mais sa mutation en un « objet textuel » autonome, aussi consistant, présent, posé, qu’un mot ou qu’une chose.
III : LA FABRICATION D « OBJETS TEXTUELS »
A : Les « objets textuels » au même rang que les « objets naturels »
27 « La pratique de la littérature », Méthodes, p. 282.
27
Au-delà du compte-tenu des choses et du parti-pris des mots (et non l’inverse) auxquels nous sommes arrivés, Ponge en effet entend créer des « objets poétiques » qui, s’ils sont réussis, pourraient compenser le manque qu’éprouve l’esprit humain confronté à l’étrangeté radicale des choses. Puisque la frontière entre le monde de ces dernières et le monde du langage est reconnue infranchissable27, il faut travailler à la production d’objets composés de mots au moins aussi « solides » que les objets du « monde extérieur », et qui eux présentent l’énorme avantage d’être accessibles, assimilables :
28 Ibidem, p. 282-283.
« Il faut que les compositions que vous ne pouvez faire qu’à l’aide de ces sons significatifs, de ces mots, de ces verbes, soient arrangées de telle façon qu’elles imitent la vie des objets du monde extérieur. Imitent, c’est-à-dire qu’elles aient au moins une complexité et une présence égales. Une épaisseur égale. »28
28
Et Pour un Malherbe enfonce le clou :
29 Pour un Malherbe, p. 186.
« A tort ou à raison, et je ne sais pourquoi, j’ai toujours considéré, depuis mon enfance, que les seuls textes valables étaient ceux qui pourraient être inscrits dans la pierre ; (...) ceux qui tiendraient encore comme des objets, placés parmi les objets de la nature : en plein air, au soleil, sous la pluie, dans le vent. »29
29
Des textes ayant la même « tenue », le même poids que les objets du monde extérieur : l’idéal est assez clair. Il s’agit de produire une œuvre pouvant tout simplement rivaliser avec le monde, et dans une certaine mesure, le remplacer. Car au-delà de la volonté de mimer le monde par les moyens de la langue française, il y a aussi l’ambition de compenser l’inaccessibilité de ce monde. Il s’agit de rien moins que de créer un autre monde en quelque sorte, comme le montrait déjà de façon exemplaire un texte de Méthodes :
« C’est de plain-pied que je voudrais qu’on entre dans ce que j’écris. Qu’on s’y trouve à l’aise. Qu’on y trouve tout simple. Qu’on y circule aisément, comme dans une révélation, soit, mais aussi simple que d’habitude. Qu’on y bénéficie du climat de l’évidence : de sa lumière, température, de son harmonie.
30 « Pochades en prose », Méthodes, pp. 67-68.
... Et cependant que tout y soit neuf, inouï : uniment éclairé, un nouveau matin. »30
30
D’une part, il s’agit de « révéler » le monde tel qu’il est, mais que les artistes seuls savent voir et montrer ; d’autre part, Francis Ponge propose à ses lecteurs d’évoluer dans ses textes comme ils pourraient évoluer dans le monde ordinaire. Au bout du compte, il faudrait que « Le carnet du bois de pins » soient aussi présent et réel que le véritable bois dont il est inspiré. C’est dire, encore une fois, que les « objets textuels » acquièrent une existence égale à celle des objets naturels. Reste à savoir comment Ponge entend les « fabriquer ».
B : La fabrication d’« objets textuels » parfaits
« Chaque mot a beaucoup d’habitudes et de puissances ; il faudrait chaque fois les ménager, les employer toutes. Ce serait le comble de la « propriété dans les termes ».
Mais tout mot est obscur s’il voile un coin du texte, s’il fascine comme une étoile, s’il est trop radieux.
31 Pratiques d’écriture, ou l’inachèvement perpétuel, p. 40, Hermann, 1984.
Il faudrait dans la phrase les mots composés à de telles places que la phrase ait un sens pour chacun des sens de chacun de ses termes. Ce serait le comble de « la profondeur logique de la phrase » et vraiment « la vie » par la multiplicité infinie et la nécessité des rapports. »31
31
Il faudrait que le texte fonctionne dans tous les sens, qu’aucun manque ne l’affaiblisse, que, pour un objet donné, il ait tout le poids et la plénitude possibles. « Le comble de la profondeur logique de la phrase », c’est la réalisation de toutes les virtualités du langage à propos d’une « chose » donnée, la réalisation d’un « objet textuel » ayant une telle perfection qu’il ne puisse manquer de s’imposer avec l’évidence d’un objet du monde extérieur. Car les choses sont là, « se tiennent là » (« stabat un volet », reconnaît l’auteur du « Volet, suivi de sa scholie », dans Pièces), irréductibles, indéniables, et tout l’élan, tout le travail du texte pongien est une réaction à ce caractère d’évidence. L’idéal du poète serait de fabriquer un objet fait de mots aussi indépassable. Dans cette optique, le texte devra donc être indépendant de son auteur et indépendant de ses lecteurs dans la mesure où toute lecture est une reprise du texte, une reconstruction. Ce texte devra par conséquent résister à des lectures diverses, contradictoires, les confondre, afin de durer. Il lui faudra dépasser son propre auteur, la « chose » dont il s’est inspiré, et le lecteur. D’où la thématique de la « mort de l’auteur » d’une part, soulignée par Philippe Sollers dans ses Entretiens, et surtout mise en scène dans « Le volet, suivi de sa scholie » par Ponge lui-même :
32 Pièces, p. 105, « Poésie-Gallimard ».
« VOLET PLEIN NE SE PEUT ECRIRE
VOLET PLEIN NAIT ECRIT STRIE
SUR LE LIT DE SON AUTEUR MORT
OU CHACUN VEILLANT A LE LIRE
ENTRE SES LIGNES VOIT LE JOUR. »32
32
D’autre part, nous avons vu ce qu’il en était du recul de la chose. Il nous reste donc à examiner les rapports de Francis Ponge avec ses lecteurs, critiques ou pas. Dans cette perspective, fabriquer un « objet textuel », autrement dit un texte « plein », permet notamment de se mettre à l’abri :
33 Pratique de l’écriture, p. 92.
« Ne pas « avoir de retard », donner au lecteur l’impression qu’on s’est déjà posé toutes les questions qu’il se pose, qu’on s’est placé de tous les points de vue critiques possibles. »33
34 Ibidem, p. 95.
33
On ne peut être plus explicite. Etrange façon de permettre au lecteur de « voir le jour ». Il s’agit ne plus ni moins que de « ne laisser prise à aucune critique en les prévenant toutes dans l’œuvre »34 ! « Dans l’œuvre » : la précision est importante puisqu’elle indique bien que c’est l’objet textuel lui-même qui est chargé de se défendre, par sa plénitude, son caractère évident d’objet « naturel ». Il y a chez Francis Ponge le désir de rendre ses textes en quelque sorte péremptoires, comme s’il s’agissait pour lui de compenser la « violence » des objets du monde extérieurs, ces choses qui échappent à toute emprise, qui s’imposent à lui avec une force irréductible, insurpassable. Or les lectures d’un texte ignorent certains aspects, en privilégient certains autres, un peu comme la perception d’un objet naturel ne nous en permet qu’une approche partielle, ne fait que l’entamer en quelque sorte. Le raisonnement du poète est alors le suivant : si un texte présente assez de complexité, il accède à une épaisseur digne d’une chose. Plus un « objet textuel » sera « plein », plus il aura de chances de résister à l’usure de lectures successives, et donc de durer comme durent les inscriptions dans la pierre, et la pierre elle-même...
34
Cependant, en se dirigeant vers un tel idéal, Francis Ponge pourrait bien en arriver à dépasser (ou à rendre « dépassée ») la notion « d’objet ». En voulant protéger ses textes de toute « érosion » ultérieure, il en vient en effet à mettre au point une stratégie visant à rendre ces textes si présents, au sens spatial comme au sens temporel du terme, qu’une approche englobante de lecture ne soit plus permise. Dès lors, ces textes tendent à l’absolu, et échappent en fin de compte à leur statut d’objet !
C : Du rejet par le texte de son statut « d’objet »
35
La lecture pose problème à l’écrivain dans la mesure où, intervenant après son travail, elle peut le remettre en cause. Et même lorsque cet écrivain a fait en sorte que son texte soit si plein qu’il ne laisse aucune faille dans laquelle pourrait s’engouffrer le lecteur,... on n’est jamais sûr ! Il s’agit par conséquent, tout simplement (!) et radicalement, d’éviter que ce texte ne devienne l’objet d’une emprise trop englobante du lecteur. C’est dans cette perspective que l’on peut lire Le savon et L’écrit Beaubourg.
36
Pour ce qui est de la première œuvre, Ponge a mis au point un procédé original de « neutralisation » de la lecture : un « speaker » allemand est censé dire le texte à des auditeurs, mais il s’efface très vite, n’étant apparu que le temps d’obtenir pour le poète un effet de simultanéité entre lecture et écriture :
« Mesdames et Messieurs,
(...) Vous entendez en ce moment les premières lignes d’un texte,...la lecture de la traduction en allemand d’un texte, originellement écrit en français...
Ecrit donc, non par moi, speaker allemand, dont vous entendez la voix... mais par l’auteur français, qui vous parle par ma voix.
Lui a écrit ceci.
Ou plutôt - s’il parlait lui-même - et, en réalité, par ma voix, il vous parle lui-même - il vous dirait, il vous dit : Non, je n’ai pas écrit ceci, je l’écris, je suis en train de l’écrire, auditeurs allemands, à votre intention.
35 Le savon, pp. 9-10 : les italiques sont de l’auteur.
Je suis en train d’écrire ces premières lignes. Je n’en suis pas plus loin que vous. Je ne suis pas plus avancé que vous. Nous allons avancer, nous avançons déjà, ensemble ; vous écoutant, moi parlant ; embarqués dans la même voiture, ou sur le même bateau. »35
37
Dès lors, la situation de lecture n’est plus celle d’un lecteur qui se penche sur cet objet, un texte « fini », Le savon, mais celle d’un auditeur qui est suspendu aux lèvres d’un locuteur, et même mieux, puisque ce locuteur s’estompe bien vite derrière l’écrivain en train d’écrire, suspendu à la plume de Francis Ponge ! Le poète prétend renoncer à son avance sur le lecteur, avancer de pair avec lui, partageant l’expérience de la création. Et effectivement, dans une certaine mesure, la lecture est bien un recréation de l’œuvre, une réactivation. Cependant, ne pas être « plus loin » que le lecteur, c’est ne pas être loin de lui, c’est ne pas le laisser seul avec le texte, après « la mort de l’auteur » si spectaculairement mise en scène dans « Le volet, suivi de sa scholie ». Ne pas être « en avance » peut-être, mais ne pas être dépassé non plus. En vérité, lorsqu’un auteur livre son... livre aux lecteurs, il est non pas « en avance », mais « en arrière », pire : « à la remorque » de ceux-ci. La fiction d’une simultanéité entre lecture et écriture permet de remédier astucieusement à cette situation angoissante pour l’écrivain : son texte n’est plus un objet livré au lecteur, mais un cheminement sans cesse renouvelé, et renouvelé comme une opération dont il garde le contrôle. Ce contrôle est accentué dans L’écrit-Beaubourg où la position surplombante du lecteur est encore plus radicalement contrée.
38
Dans ce texte en effet, Ponge ne s’efforce pas, comme dans Le savon, de donner dès le début l’impression qu’il est en train d’écrire ce que le lecteur est en train de lire. Il se permet même de parler de ce texte au passé : cela ne lui est pas insupportable dans la mesure où il se situe au-delà de sa situation d’écriture ! Car il fait plus que d’accompagner le lecteur : il le surplombe à son tour :
« Tels ont été les premiers mots venus sur mon écritoire (...) lorsque (...) – je me fus par contrat engagé à écrire, pour être publié à l’occasion de son inauguration [celle du Centre Pompidou], le texte présentement sous vos yeux.
(...)
Oui, tels et en tel lieu, au haut de cette page, venons-nous en effet, de les lire.
(...)
Dès le second paragraphe, pourquoi ce réfrènement tout à coup (...), Pourquoi ce changement d’optique, cette brusque accommodation au plus près ?
36 Premières pages de L’écrit-Beaubourg, éd. Centre Georges-Pompidou, 1977 : c’est nous qui soulignons
Pour nous ramener, bien entendu, à l’urgence, à la seule réalité du moment : à cette piste, cette page même, dont nous continuons, ne me dites pas le contraire, à parcourir présentement les lignes selon lesquelles nous allons, d’un instant à l’autre, être amenés à lire – nous y voici – que, nous référant sans nul doute au Centre Pompidou, nous n’en constituons pourtant (...) rien de plus qu’une sorte d’inauguration textuelle (...). »36
39
On voit que, par une progression très complexe, le texte finit par prendre la lecture à revers en quelque sorte, en se décrivant lui-même non plus comme écriture en train de se faire (Le savon), mais comme lecture. Dans le troisième paragraphe, l’auteur qui jusque là semblait relire seul son propre texte, rejoint d’autres lecteurs, employant au pluriel et non plus au singulier la première personne. L’écrivain non seulement accompagne la lecture, mais en outre l’englobe en la décrivant au présent. La perspective de la description, en effet, s’est progressivement élargie, comprenant d’abord seulement les premiers mots du texte, puis les suivants, puis la lecture de ce texte elle-même. En d’autres termes, ce n’est plus le texte qui est l’objet de la lecture, mais le contraire ! Ce texte est devenu indépassable. Bien plus qu’il n’est l’objet de quelque emprise, en devenant « conscient » de lui-même pour ainsi dire et en rejoignant ses propres lecteurs sur leur terrain, il accède au statut de sujet !
Conclusion
40
L’objet hante toute l’œuvre de Francis Ponge : il en est le point de départ, l’impulsion constante, et l’horizon ultime. Mais cette permanence ne va pas sans mobilité et sans mutations. Les choses, les mots, la langue, et leur produit, sont autant de métamorphoses de cet objet décidément difficile à saisir et difficile à réaliser, et, en fin de compte, à créer. Et c’est peut-être là le nœud de la difficulté : l’écriture pongienne oscille entre re-présentation de l’objet (« la chose » qu’il s’agit de mimer dans le monde du langage) ; re-création (qui est aussi récréation) d’un autre objet, la langue, qui s’accomplit à travers un texte, y réalisant la totalité de ses virtualités à propos d’un sujet donné ; et création d’un objet autre, cet « objet textuel » qui est une condensation de mots à partir d’un motif, une prise du langage, un objet parfait et mieux que cela, un faire qui jamais ne s’interrompt... et finit par remettre en cause la notion d’objet. L’envie de l’objet dans la poésie de Francis Ponge est tantôt soif exigeante, tantôt rivalité impossible et hautaine, tantôt compensation sophistiquée. L’objet confronte l’écriture aux limites de la langue, mais la pousse du même coup à s’y installer, transformant ses limitations en délimitation : elle devient, elle se veut, précisément un objet de langage. L’objet dès lors n’est plus « la chose », cet objet décentré au-delà de l’écriture, mais au contraire un « objeu » recentrant l’écriture qui devient à elle-même son propre objet, et finit par accéder, d’une certaine manière, à la dignité de sujet.
41
Et en même temps, « la chose » dont nous sommes partis demeure une perspective primordiale, un repère, le point alpha et oméga de l’écriture, le cœur lointain et inaccessible de la poésie. Ne pouvant rejoindre le monde « extérieur », celle-ci ne s’en détourne pas pour autant, tourne au contraire autour de lui, « décolle » grâce à lui, faute de décoller vers lui :
37 Pour un Malherbe, p. 62.
« Le Temps (LE Temps : je veux dire la ténacité, le travail) débouchant dans l’intemporel. Une minute de plus à vivre, à peiner encore, et c’est l’éternité. La fusée dans la stratosphère, qui finit, à force de relancer son désir [le texte à force de relancer son envie...], par échapper à l’attraction, et entrer dans l’harmonie des sphères, dans l’horlogerie universelle. »37
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Objet d'étude : La poésie du XIX et du XX siècle. Parcours complémentaire : Alchimie poétique : réinventer le monde. Analyse linéaire 2/2 « Le Pain », Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942
- Lecture linéaire - L'Huitre de Francis Ponge
- L'huitre de Ponge
- Explication: « Le cageot » Ponge, Le Parti pris des choses, 1942
- Ponge- Le morceau de viande