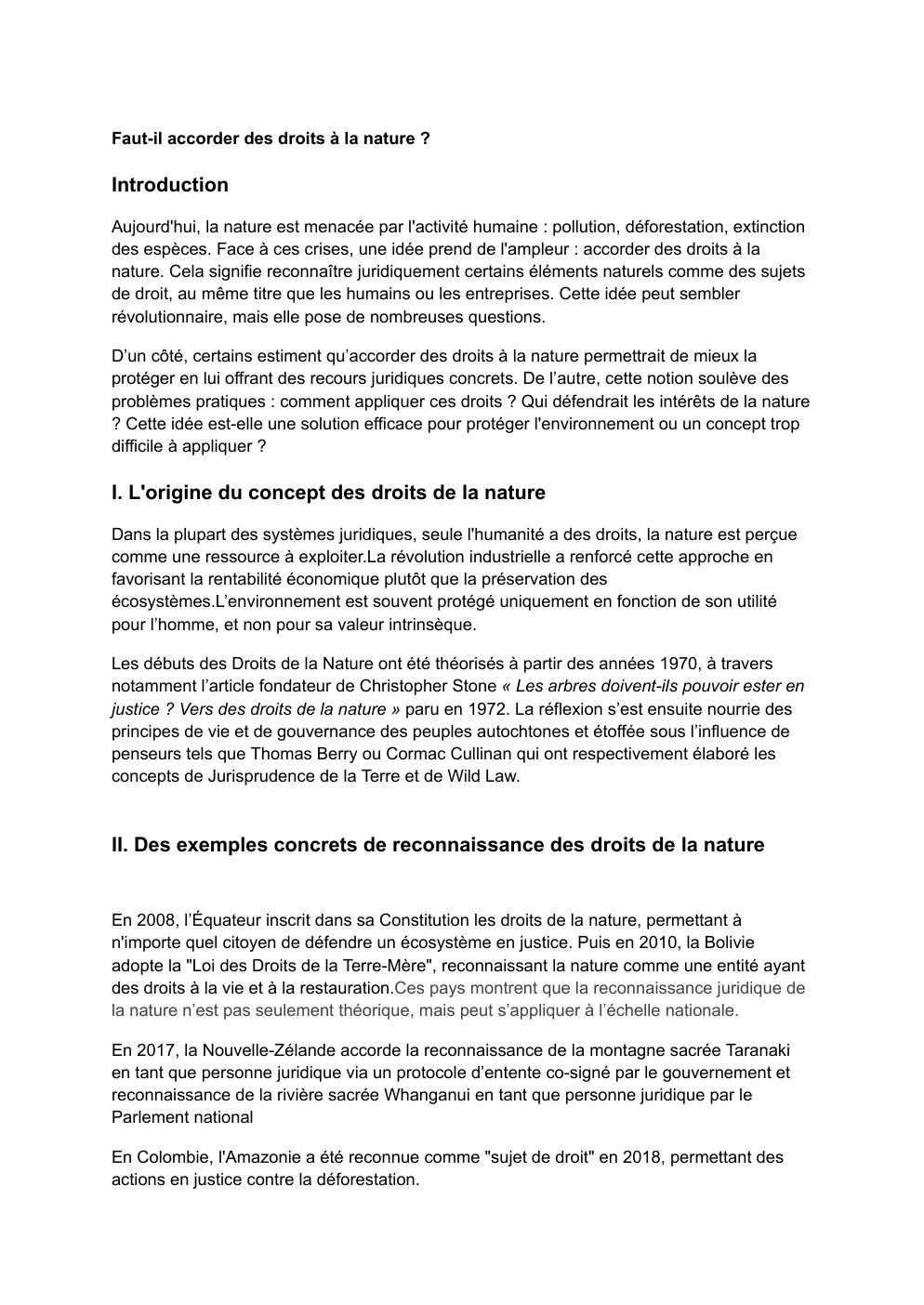Philo: Faut-il accorder des droits à la nature ?
Publié le 01/04/2025
Extrait du document
«
Faut-il accorder des droits à la nature ?
Introduction
Aujourd'hui, la nature est menacée par l'activité humaine : pollution, déforestation, extinction
des espèces.
Face à ces crises, une idée prend de l'ampleur : accorder des droits à la
nature.
Cela signifie reconnaître juridiquement certains éléments naturels comme des sujets
de droit, au même titre que les humains ou les entreprises.
Cette idée peut sembler
révolutionnaire, mais elle pose de nombreuses questions.
D’un côté, certains estiment qu’accorder des droits à la nature permettrait de mieux la
protéger en lui offrant des recours juridiques concrets.
De l’autre, cette notion soulève des
problèmes pratiques : comment appliquer ces droits ? Qui défendrait les intérêts de la nature
? Cette idée est-elle une solution efficace pour protéger l'environnement ou un concept trop
difficile à appliquer ?
I.
L'origine du concept des droits de la nature
Dans la plupart des systèmes juridiques, seule l'humanité a des droits, la nature est perçue
comme une ressource à exploiter.La révolution industrielle a renforcé cette approche en
favorisant la rentabilité économique plutôt que la préservation des
écosystèmes.L’environnement est souvent protégé uniquement en fonction de son utilité
pour l’homme, et non pour sa valeur intrinsèque.
Les débuts des Droits de la Nature ont été théorisés à partir des années 1970, à travers
notamment l’article fondateur de Christopher Stone « Les arbres doivent-ils pouvoir ester en
justice ? Vers des droits de la nature » paru en 1972.
La réflexion s’est ensuite nourrie des
principes de vie et de gouvernance des peuples autochtones et étoffée sous l’influence de
penseurs tels que Thomas Berry ou Cormac Cullinan qui ont respectivement élaboré les
concepts de Jurisprudence de la Terre et de Wild Law.
II.
Des exemples concrets de reconnaissance des droits de la nature
En 2008, l’Équateur inscrit dans sa Constitution les droits de la nature, permettant à
n'importe quel citoyen de défendre un écosystème en justice.
Puis en 2010, la Bolivie
adopte la "Loi des Droits de la Terre-Mère", reconnaissant la nature comme une entité ayant
des droits à la vie et à la restauration.Ces pays montrent que la reconnaissance juridique de
la nature n’est pas seulement théorique, mais peut s’appliquer à l’échelle nationale.
En 2017, la Nouvelle-Zélande accorde la reconnaissance de la montagne sacrée Taranaki
en tant que personne juridique via un protocole d’entente co-signé par le gouvernement et
reconnaissance de la rivière sacrée Whanganui en tant que personne juridique par le
Parlement national
En Colombie, l'Amazonie a été reconnue comme "sujet de droit" en 2018, permettant des
actions en justice contre la déforestation.
En France en 2023, certains éléments du vivant des Iles Loyautés en Nouvelle
Calédonie ont été reconnues comme entités naturelles sujets de droits.
III.
Les arguments en faveur des droits de la nature
Donner des droits à la nature serait un moyen efficace de protection de cette dernière.
En
effet, les lois environnementales actuelles sont souvent insuffisantes et contournées par les
acteurs économiques.
En reconnaissant des droits à la nature, il deviendrait plus facile pour
les citoyens et les associations d’agir en justice pour empêcher des destructions
écologiques.
Des exemples concrets montrent l’intérêt de cette approche.
En Nouvelle-Zélande, le fleuve
Whanganui a obtenu un statut juridique lui permettant d’être défendu par des représentants
légaux.
En Colombie, la forêt amazonienne a été reconnue comme “sujet de droits”,
obligeant l’État à renforcer sa protection.
Ces avancées montrent que donner une
personnalité juridique à....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DISSERTATION NATURE PHILO: Dissertation : Faut-il respecter la nature ?
- cours philo: la nature
- Dans les pensées, Pascal affirme que le moi est haissable et juge sévèrement Montaigne : Le sot projet qu'il a eu de se peindre. En revanche, Voltaire parle du charmant projet que Montaigne a eu de se peindre naïvement comme il l'a fait, car il a peint la nature humaine. Comment faut-il donc considérer l'écriture de soi en général et les diverses entreprises autobiographiques ?
- De quelle nature est le bonheur ? Faut-il le concevoir comme un état de repos, ou au contraire comme un état dynamique ?
- Faut-il accorder un place à l'inconscient ?