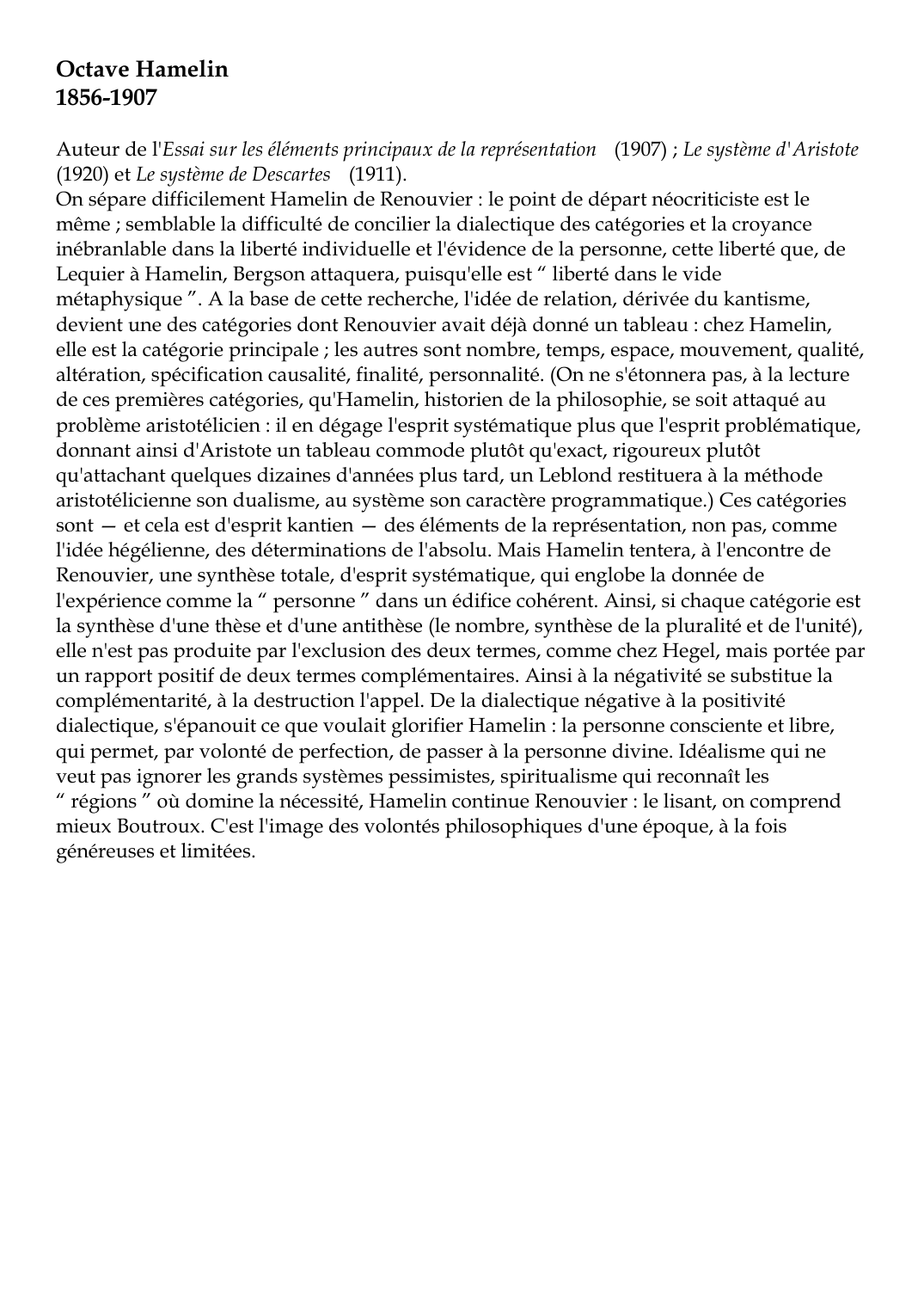Octave Hamelin1856-1907Auteur de l'Essai sur les éléments principaux de la représentation (1907) ; Le système d'Aristote(1920) et Le système de Descartes (1911).
Publié le 22/05/2020
Extrait du document
«
Octave Hamelin
1856-1907
Auteur de l' Essai sur les éléments principaux de la représentation (1907) ; Le système d'Aristote
(1920) et Le système de Descartes (1911).
On sépare difficilement Hamelin de Renouvier : le point de départ néocriticiste est le
même ; semblable la difficulté de concilier la dialectique des catégories et la croyance
inébranlable dans la liberté individuelle et l'évidence de la personne, cette liberté que, de
Lequier à Hamelin, Bergson attaquera, puisqu'elle est “ liberté dans le vide
métaphysique ”.
A la base de cette recherche, l'idée de relation, dérivée du kantisme,
devient une des catégories dont Renouvier avait déjà donné un tableau : chez Hamelin,
elle est la catégorie principale ; les autres sont nombre, temps, espace, mouvement, qualité,
altération, spécification causalité, finalité, personnalité.
(On ne s'étonnera pas, à la lecture
de ces premières catégories, qu'Hamelin, historien de la philosophie, se soit attaqué au
problème aristotélicien : il en dégage l'esprit systématique plus que l'esprit problématique,
donnant ainsi d'Aristote un tableau commode plutôt qu'exact, rigoureux plutôt
qu'attachant quelques dizaines d'années plus tard, un Leblond restituera à la méthode
aristotélicienne son dualisme, au système son caractère programmatique.) Ces catégories
sont — et cela est d'esprit kantien — des éléments de la représentation, non pas, comme
l'idée hégélienne, des déterminations de l'absolu.
Mais Hamelin tentera, à l'encontre de
Renouvier, une synthèse totale, d'esprit systématique, qui englobe la donnée de
l'expérience comme la “ personne ” dans un édifice cohérent.
Ainsi, si chaque catégorie est
la synthèse d'une thèse et d'une antithèse (le nombre, synthèse de la pluralité et de l'unité),
elle n'est pas produite par l'exclusion des deux termes, comme chez Hegel, mais portée par
un rapport positif de deux termes complémentaires.
Ainsi à la négativité se substitue la
complémentarité, à la destruction l'appel.
De la dialectique négative à la positivité
dialectique, s'épanouit ce que voulait glorifier Hamelin : la personne consciente et libre,
qui permet, par volonté de perfection, de passer à la personne divine.
Idéalisme qui ne
veut pas ignorer les grands systèmes pessimistes, spiritualisme qui reconnaît les
“ régions ” où domine la nécessité, Hamelin continue Renouvier : le lisant, on comprend
mieux Boutroux.
C'est l'image des volontés philosophiques d'une époque, à la fois
généreuses et limitées..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DESCARTES: vie et système philosophique
- GASSENDI, abbé Pierre Gassend dit (1592-1655)Philosophe et mathématicien, adversaire de la philosophie d'Aristote et de Descartes, il est partisan d'une morale épicurienne, fondée sur le plaisir de la sérénité.
- Selon Alain, « il n'y a point de fatalité dans le roman : au contraire, le sentiment qui y domine est d'une vie où tout est voulu, même les passions et les crimes, même le malheur » (Système des Beaux-Arts, 1920). Partagez-vous cette opinion ?
- Quels éléments du cytosquelette sont les principaux éléments structuraux des cils et des flagelles ?
- La consience chez Descartes