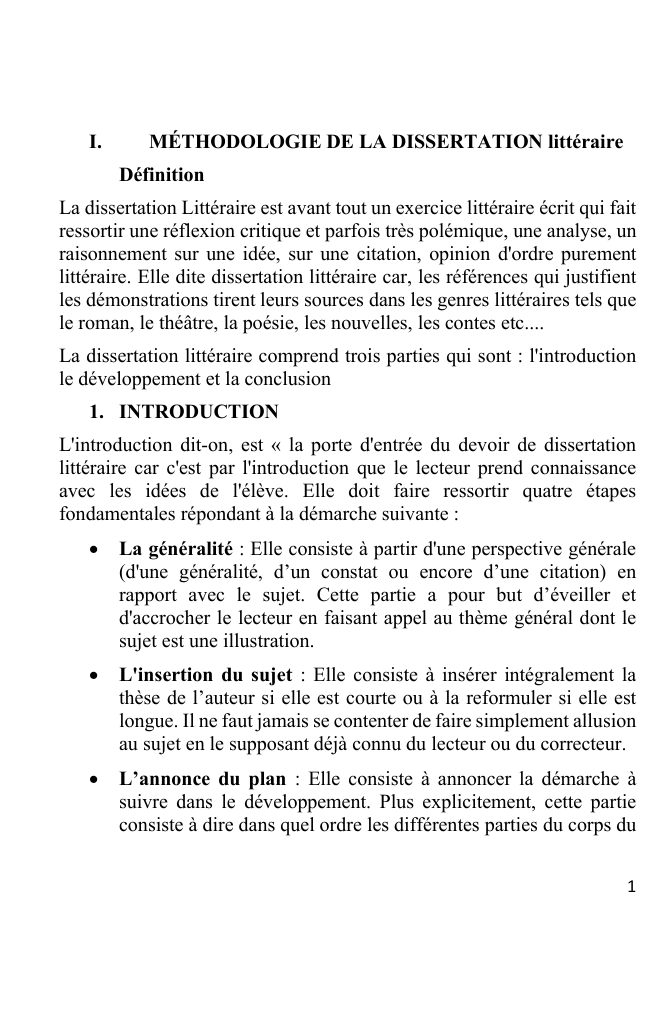MÉTHODOLOGIE DE LA DISSERTATION littéraire
Publié le 25/03/2025
Extrait du document
«
I.
MÉTHODOLOGIE DE LA DISSERTATION littéraire
Définition
La dissertation Littéraire est avant tout un exercice littéraire écrit qui fait
ressortir une réflexion critique et parfois très polémique, une analyse, un
raisonnement sur une idée, sur une citation, opinion d'ordre purement
littéraire.
Elle dite dissertation littéraire car, les références qui justifient
les démonstrations tirent leurs sources dans les genres littéraires tels que
le roman, le théâtre, la poésie, les nouvelles, les contes etc....
La dissertation littéraire comprend trois parties qui sont : l'introduction
le développement et la conclusion
1.
INTRODUCTION
L'introduction dit-on, est « la porte d'entrée du devoir de dissertation
littéraire car c'est par l'introduction que le lecteur prend connaissance
avec les idées de l'élève.
Elle doit faire ressortir quatre étapes
fondamentales répondant à la démarche suivante :
•
La généralité : Elle consiste à partir d'une perspective générale
(d'une généralité, d’un constat ou encore d’une citation) en
rapport avec le sujet.
Cette partie a pour but d’éveiller et
d'accrocher le lecteur en faisant appel au thème général dont le
sujet est une illustration.
•
L'insertion du sujet : Elle consiste à insérer intégralement la
thèse de l’auteur si elle est courte ou à la reformuler si elle est
longue.
Il ne faut jamais se contenter de faire simplement allusion
au sujet en le supposant déjà connu du lecteur ou du correcteur.
•
L’annonce du plan : Elle consiste à annoncer la démarche à
suivre dans le développement.
Plus explicitement, cette partie
consiste à dire dans quel ordre les différentes parties du corps du
1
devoir seront traitées.
Quelquefois, une série de questions bien
choisies peuvent constituer l'annonce du plan.
2.
DÉVELOPPEMENT
Le développement sert à faire le travail planifié c'est-à-dire, à réaliser le
travail établi.
C'est donc le plan énoncé à la fin de l'introduction qui sera
développé progressivement (étape par étape) et rationnellement (par
déduction logique).
La première phrase doit prendre en compte le
premier élément du plan.
Le développement nécessite des analyses, un
examen critique suscitant des définitions, des explications, des
commentaires et une appréciation objective des concepts contenus dans
le sujet.
Dans le développement, le candidat doit mener un débat qui a
pour but de rechercher la vérité pour convaincre et instruire le correcteur.
II (candidat) doit donc s'appuyer sur des références littéraires c'est-à-dire,
se servir des idées et citations tirées des genres littéraires (romans, poésie
ou théâtre) connus et écrits par des écrivains confirmés.
Toute citation
directe, toute thèse avancée, tout exemple formulé doivent s'écrire entre
guillemets et accompagnés des noms de leur auteur.
Pour passer d'une
idée ou d'une partie à une autre, on crée une transition.
Ce pont logique
consiste à annoncer l'élément suivant à la fin d'une idée ou d'une partie.
Concernant le style ou la manière d'écrire du candidat, il faut faire des
phrases courtes, correctes et choisir des mots simples, pertinents et
concrets.
La bonne rédaction est celle qui est légère agréable et facile à
lire.
Le candidat doit, en fin de compte, éviter le désordre, la confusion,
la récitation, les préjugés et les allusions vagues.
3.
LA CONCLUSION
À travers ses composantes (bilan récapitulatif réponse définitive à la
problématique ouverture du débat sur un problème plus vaste) est la
partie où l'on pose la vérité recherchée de façon claire et précise sans
s'adonner à d'autres détails, d'autres justifications, d'autres
démonstrations déjà abordés dans le développement.
2
II- METHODE PRATIQUE POUR LA RÉUSSITE D'UN DEVOIR
DE DISSERTATION LITTÉRAIRE
1.
L’analyse du sujet :
- Souligner les mots-clés, puis trouver des synonymes (bien
prendre en compte la polysémie de certains mots) et des éléments
de définition (repérer les notions littéraires, points de cours...).
- Dégager (si elle n’est pas incluse dans le sujet) ou reformuler la
problématique.
- Repérer le plan attendu : une question fermée ou une citation à
discuter appelle un plan dialectique (thèse / antithèse / synthèse).
Une question ouverte appelle un plan analytique (les axes
tournent autour des critères de définition d’un terme ou d’une
notion)
2.
La construction du plan :
- À partir de la problématique dégagée ou reformulée, construire
les grands axes : ce sont des éléments de réponse à la question.
Pensez à exploiter des modalisateurs (adverbes, conditionnel...)
pour nuancer votre propos et ne pas être trop contradictoire.
- Justifier chaque grand axe par deux ou trois arguments (sur le
brouillon, on peut les introduire par « parce que...
», cela dirige
mieux la pensée vers l’objectif attendu : justifier l’idée de chaque
grand axe).
À noter : Les axes et sous-axes seront efficaces s’ils
sont formulés par des phrases complètes (et non par des groupes
nominaux).
- Développer ses idées et trouver des exemples pour les illustrer,
afin d’obtenir un plan détaillé.
Chaque argument (sous axe) doit
être expliqué, précisé et développé pour mieux faire comprendre
sa pensée à l’examinateur.
Cherchez à reformuler l’idée, et
définissez les notions clés, contextualisez vos idées.
.
.
Ce sera
aussi l’occasion de montrer vos connaissances littéraires.
- Cherchez des exemples pertinents pour illustrer vos idées : faites
appel en premier lieu à l’œuvre sur laquelle porte le sujet, puis
3
complétez avec des exemples tirés du parcours associé et/ou de
vos connaissances personnelles.
Pensez à bien justifier le choix
de votre exemple en faisant le lien avec l’argument.
3- La rédaction
Si votre plan est bien détaillé, cette étape peut se faire sans difficulté.
Vous pourrez alors vous concentrer sur l’expression : construction
syntaxique de vos phrase, accords (sujet/verbe et nom/adjectif) et
orthographe.
Soignez aussi la présentation en paragraphes pour mettre en
valeur l’organisation et la progression de votre propos (sautez 2 lignes
entre l’introduction et le développement, une ligne entre les grands axes,
et pensez aux alinéas, aux phrases d’introduction et de bilan pour chaque
paragraphe argumentatif (= sous-partie).
II.
BANQUE D'ARGUMENTS littéraire
ARG 1 : L’ECRIVAIN PEUT EXPRIMER SA SOUFFRANCE ET
SON ANGOISSE.
La douleur et la peine ou le chagrin qu’il a vécu.
La voix de ma rue,
Sylvain KHEAN ZOH, où l’auteur relate son expérience douloureuse en
tant qu’enfant ayant vécu les dures réalités de la vie dans les rues.
ARG 2 : L’ECRIVAIN PEUT EXPRIMER SON AMOUR ET SON
ATTACHEMENT A UN ETRE OU UNE CHOSE
Certains écrivains se servent de leurs œuvres pour traduire leurs
affections, passions, amitié ou le lien qui les unis à un être, un peuple,
une culture ou une chose.
On observe cela dans les œuvres
autobiographiques.
L’enfant noir, Camara LAYE, c’est un récit
autobiographique, où l’auteur raconte son enfance dans une communauté
villageoise dont il reste intimement attaché.
ARG 3 : L’ECRIVAIN PEUT EXPRIMER SA COLERE ET SA
REVOLTE
4
L’œuvre peut être un moyen pour l’écrivain d’exprimer son
mécontentement et son exaspération vis à vis d’une situation révoltante.
Climbié, Bernard Binlin DADIE.
Ici, l’auteur raconte les aventures et les
difficultés de Climbié dès qu'il quitte l’école.
L’auteur utilise cette
autobiographie pour exprimer sa révolte contre les injustices dont il était
victime.
ARG 4 : le roman peut critiquer l’abus du pouvoir et la mauvaise
gouvernance de certains chefs d’Etats africains.
Les soleils des
indépendances d’AHMADOU KOUROUMA critique l'attitude
inhumaine des nouveaux gouvernants africains qui se comportent en
bourreaux à l’endroit du peuple à travers les arrestations arbitraires, les
meurtres politiques et la spoliation (gaspillage).
ARG 5 : Le roman peut faire une satire insolente de certaines coutumes
sociales.
Trois prétendantes un mari, GUILLAUME OYONO dénonce et pose
l’épineux problème de la dot, de l’exploitation du gendre par ses beauxparents, de la liberté du mariage et de la femme.
ARG 6 : Le roman peut être le résultat d’un discours piquant de certains
écrivains africains à la rencontre du colonisateur.
Une saison au Congo,
AIME CESAIRE, Une si belle leçon de patience MOUSSA MAKAN
déplore la désunion, l’orgueil aveugle et l’égoïsme des africains qui
facilitent l’invasion coloniale.
ARG 7 : Le roman peut retracer l’adolescence, vie intérieure et
l’expérience personnelles de l’écrivain dans le but d’édifier le lecteur.
L’enfant noir, CAMARA LAYE, met en évidence l’adolescence de
l’écrivain dans son milieu familial qui l’a vu naître et grandir.
ARG 8 : Le roman peut permettre le divertissement Elle a une fonction
multiple et récréative.
5
Petit Bodiel AMADOU HAMPATE BA, transporte le lecteur dans un
monde fictif, imaginaire où les animaux sont personnifiés.
Ici les
catégories logiques sont brisées car tout devient possible d’où l’idée de
divertissement.
ARG 9 : Le roman peut valoriser certaines vertus sociales et culturelles.
La carte d’identité de JEAN-MARIE ADIAFI et Chant d’ombre
Léopold Sédar SENGHOR, mettent respectivement en exergue les
vertus de la cuture africaine et de la femme.
ARG 10 : L’œuvre sert à faire une satire du pouvoir politique
L’écrivain peut dénoncer les guerres, l’abus du pouvoir, a démagogie, a
dictature et l’oppression du peuple.
Allah n’est pas obligé ! Ahmadou
KOUROUMA, Ici l’auteur s'élève contre l’instabilité des pays africains
éternellement sujets à des guerres et leurs corollaires d'atrocités et
d'enrôlements d'enfants soldats.
ARG 11 : La fiction se perçoit à travers les lieux.
L’auteur peut énoncer
des lieux qui sont le fruit de son imagination.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Méthodologie de la dissertation (cours)
- Méthodologie dissertation SES
- Dissertation littéraire: Défense de la littérature (1968), Claude Roy
- Comment faire une dissertation littéraire ?
- "Méthodologie" de la dissertation philo