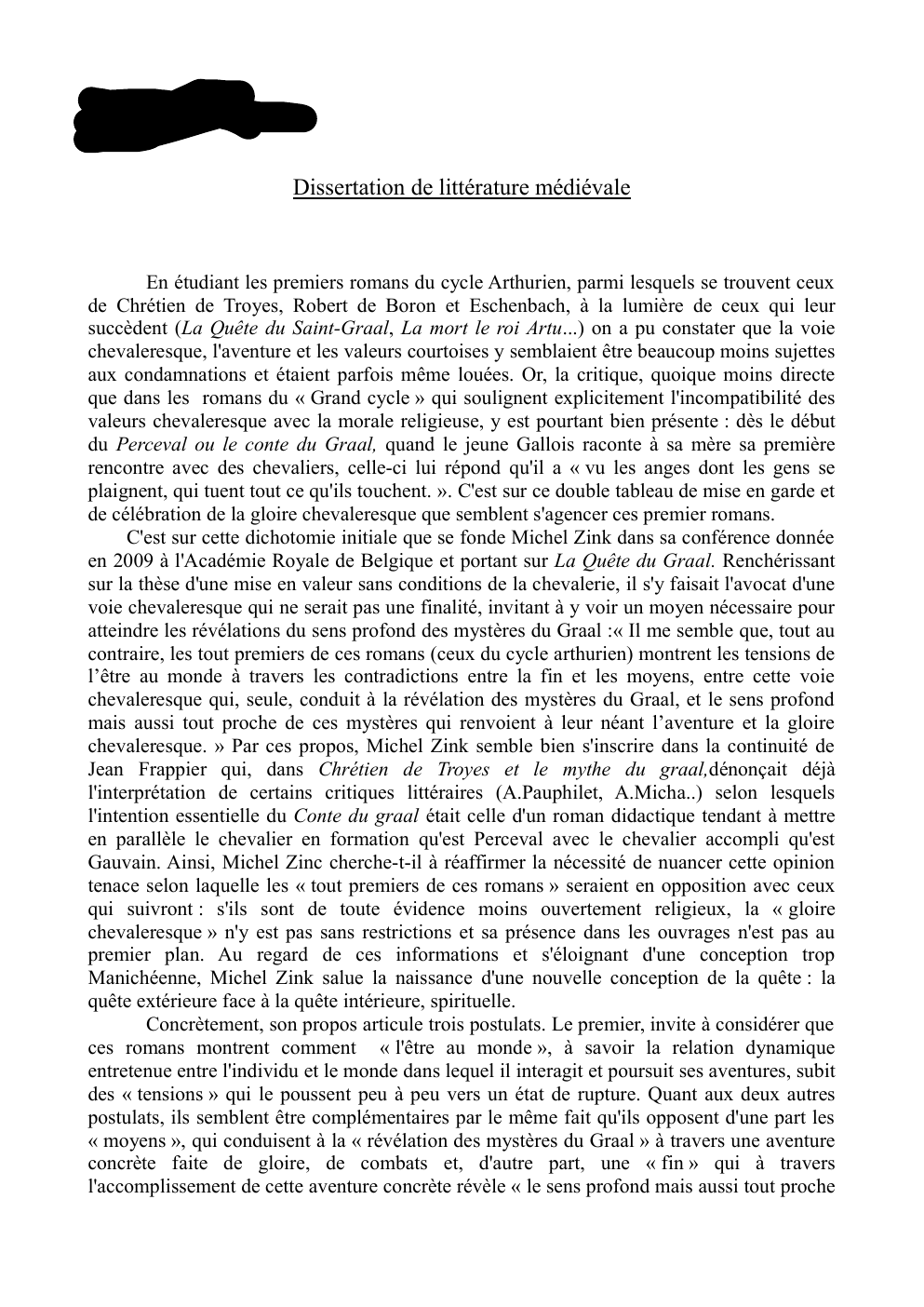M1 Littérature et linguistique UT2J Dissertation de littérature médiévale
Publié le 26/03/2025
Extrait du document
«
M1 Littérature et linguistique
UT2J
Dissertation de littérature médiévale
En étudiant les premiers romans du cycle Arthurien, parmi lesquels se trouvent ceux
de Chrétien de Troyes, Robert de Boron et Eschenbach, à la lumière de ceux qui leur
succèdent (La Quête du Saint-Graal, La mort le roi Artu...) on a pu constater que la voie
chevaleresque, l'aventure et les valeurs courtoises y semblaient être beaucoup moins sujettes
aux condamnations et étaient parfois même louées.
Or, la critique, quoique moins directe
que dans les romans du « Grand cycle » qui soulignent explicitement l'incompatibilité des
valeurs chevaleresque avec la morale religieuse, y est pourtant bien présente : dès le début
du Perceval ou le conte du Graal, quand le jeune Gallois raconte à sa mère sa première
rencontre avec des chevaliers, celle-ci lui répond qu'il a « vu les anges dont les gens se
plaignent, qui tuent tout ce qu'ils touchent.
».
C'est sur ce double tableau de mise en garde et
de célébration de la gloire chevaleresque que semblent s'agencer ces premier romans.
C'est sur cette dichotomie initiale que se fonde Michel Zink dans sa conférence donnée
en 2009 à l'Académie Royale de Belgique et portant sur La Quête du Graal.
Renchérissant
sur la thèse d'une mise en valeur sans conditions de la chevalerie, il s'y faisait l'avocat d'une
voie chevaleresque qui ne serait pas une finalité, invitant à y voir un moyen nécessaire pour
atteindre les révélations du sens profond des mystères du Graal :« Il me semble que, tout au
contraire, les tout premiers de ces romans (ceux du cycle arthurien) montrent les tensions de
l’être au monde à travers les contradictions entre la fin et les moyens, entre cette voie
chevaleresque qui, seule, conduit à la révélation des mystères du Graal, et le sens profond
mais aussi tout proche de ces mystères qui renvoient à leur néant l’aventure et la gloire
chevaleresque.
» Par ces propos, Michel Zink semble bien s'inscrire dans la continuité de
Jean Frappier qui, dans Chrétien de Troyes et le mythe du graal,dénonçait déjà
l'interprétation de certains critiques littéraires (A.Pauphilet, A.Micha..) selon lesquels
l'intention essentielle du Conte du graal était celle d'un roman didactique tendant à mettre
en parallèle le chevalier en formation qu'est Perceval avec le chevalier accompli qu'est
Gauvain.
Ainsi, Michel Zinc cherche-t-il à réaffirmer la nécessité de nuancer cette opinion
tenace selon laquelle les « tout premiers de ces romans » seraient en opposition avec ceux
qui suivront : s'ils sont de toute évidence moins ouvertement religieux, la « gloire
chevaleresque » n'y est pas sans restrictions et sa présence dans les ouvrages n'est pas au
premier plan.
Au regard de ces informations et s'éloignant d'une conception trop
Manichéenne, Michel Zink salue la naissance d'une nouvelle conception de la quête : la
quête extérieure face à la quête intérieure, spirituelle.
Concrètement, son propos articule trois postulats.
Le premier, invite à considérer que
ces romans montrent comment « l'être au monde », à savoir la relation dynamique
entretenue entre l'individu et le monde dans lequel il interagit et poursuit ses aventures, subit
des « tensions » qui le poussent peu à peu vers un état de rupture.
Quant aux deux autres
postulats, ils semblent être complémentaires par le même fait qu'ils opposent d'une part les
« moyens », qui conduisent à la « révélation des mystères du Graal » à travers une aventure
concrète faite de gloire, de combats et, d'autre part, une « fin » qui à travers
l'accomplissement de cette aventure concrète révèle « le sens profond mais aussi tout proche
de ces mystères » que l'on peut comprendre comme la promesse d'une vérité qui, tout en
étant en soi-même et donc parfaitement accessible, se veut le résultat d'une quête spirituelle
où « l'aventure et la gloire chevaleresque » sont confrontés à un sens qui les dépasse.
Si jusqu'ici le lecteur des premiers romans du cycle arthurien peut tout à fait souscrire
à l'idée d'un sens qui dépasserait la seule idée d'un éloge de la chevalerie on peut se
demander si l'on peut toujours suivre Michel Zink lorsqu'il dit que « ces mystères renvoient
à leur néant l'aventure et la gloire chevaleresque .
», ce qui tendrait à faire de l'aventure
concrète et de la gloire chevaleresque un simple medium destiné à atteindre une fin définie
et à s'effacer une fois la tâche accomplie : proposition qui n'est pas sans relever d'une
certaine restriction de champ, puisqu'elle n'en privilégie, en somme, qu'un seul aspect : celui
d'une finalité essentiellement spirituelle et entièrement corrélée à la révélation des mystères
du Graal ; au détriment de tous les premiers romans du cycle arthurien et de l'importance
accordée par Chrétien de Troyes au « bien dire » et à la « conjunture » qui soulignent
l'importance du plaisir de raconter et d'écouter une histoire qui prend sens en elle même.
De sorte que si l'on s'essayait à mettre la proposition de Michel Zink en débat, la question
pourrait être : Quel est le sens de la quête dans les premiers romans du cycle Arthurien ? Ou
plus précisément : Quel(s) rôle(s) joue(nt) la/les quêtes et ce à quelle fin ?
Si tout indique que la quête chevaleresque, loin d'être le sujet patient d'un éloge de la
chevalerie, devient le vaisseau d'une quête du sens, plus profonde, des mystères révélés du
Graal (I) il ne semble pas moins que la voie chevaleresque et le goût de l'aventure ne
s'effacent pas derrière une finalité unique mais prennent aussi sens en eux-même, en initiant
une réflexion sur leur propre valeur (II) ; de telle manière que dans ce va-et-vient entre
l'horizon fictif d'un univers chevaleresque de tous les possibles et la quête spirituelle d'une
vérité sur le monde et sur soi-même semble se dégager la figure du conteur qui allie la
« matière » et le « sen » (III).
Dans le cycle arthurien, le passage de l'eau signale l'intrusion de la merveille et l'entrée
dans un autre monde.L'eau est ainsi la frontière d'où « nul chevalier ne revient », motif
celtique qui apparaît à plusieurs reprises : le Conte du Graal développe l'image d'une
frontière aquatique qui sépare le monde des vivants de celui des morts, ce qui poussera
Perceval à penser devant la rivière réputée infranchissable que « si je pouvais passer cette
eau, je crois que je retrouverais ma mère si elle est encore de ce monde.
».
La traversée
d'une frontière matérielle (une rivière) se fait en même temps traversée d'une frontière
spirituelle, celle du royaume des vivants vers celui des morts.
Ainsi, la quête chevaleresque,
qui est confrontée à des obstacles concrets, appelle la quête spirituelle qui devient la finalité
de l'exploit à accomplir.
A la lumière de cet exemple nous pouvons postuler que la voie
chevaleresque permet de conduire à la révélation des mystères du Graal et opère une
transition entre l'épreuve qualifiante qui prouve la valeur du héros et le sens profond qui
réside dans une telle épreuve.
« [...]les tout premiers de ces romans montrent les tensions de l'être au monde à travers
les contradictions entre la fin et les moyens[...] » affirme Michel Zink.
Corrélativement à
l'idée d'une chevalerie et ses valeurs qui ne seraient pas la finalité de la quête, nul doute que
la notion de « tension » qui désigne l'état de ce qui menace de rompre joue un large rôle en
ce qui concerne l'insuffisance de la voie chevaleresque à donner sens aux mystères du
Graal ; et ce dès les premiers romans du cycle arthurien.
Tout au long du Conte du Graal en
particulier, bien que les exploits des chevaliers soient très nombreux tout au long du roman,
Chrétien de Troyes fait bien attention à distinguer la quête du Graal de celles que l'on
pourrait appeler secondaires, parmi lesquelles la « demoiselle hideuse », le « Lit de la
Merveille »...
Car si Perceval enchaîne bien les épreuves et les victoire au cours des cinq ans
qui suivent son échec au château du Graal au point qu'il devient l'un des meilleurs chevaliers
du royaume, ce dernier est encore très loin du Graal, d'autant plus qu'il a tout d'oublié de son
passé au point de s'être presque oublié lui-même.
Ainsi, loin de consolider sa vertu et de le
faire progresser à la manière d'un roman d'apprentissage, les aventures concrètes semblent
provoquer l'effet inverse en le faisant régresser comme le souligne son oncle ermite « Ah !
Mon doux ami, dit le saint homme, dis mois pourquoi tu as fait cela et prie Dieu qu'il ait
pitié de l'âme de son pécheur.
».
On voit bien ici l'effet de cette « tension » qui s'exerce sur
Perceval qui, cherchant à tout prix à rattraper la faute commise en faisant se succéder les
actes de bravoures pendant « [...]V.
anz trestuit antier [...] » ne parvient qu'à se perdre
d'autant plus dans son obsession pour les « moyens » d'atteindre le Graal : « Mais pour
autant il ne laissait pas d'être à....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation littéraire: Défense de la littérature (1968), Claude Roy
- dissertation master littérature de jeunesse sur le conte - Commentez : "Pierre Péju nous dit que «Le conte en général […] met en scène un héros au nom commun, à la psychologie sommaire, dont les aventures sont comme suspendues en dehors du temps et de l’espace. Le conte décrit souvent un « passage », une traversée […]. A la fin, celui qui est mal parti finit par accéder à un état nouveau de maturité, de puissance ou de richesse. Mais certains contes valent avant tout
- dissertation "pensez vous que la littérature incite l'homme à se révolter"
- La critique littéraire: LINGUISTIQUE ET LITTÉRATURE
- John Ronald Reuel Tolkien1892-1973Ancien professeur de littérature médiévale à l'université d'Oxford, il publia The Hobbit en1937.