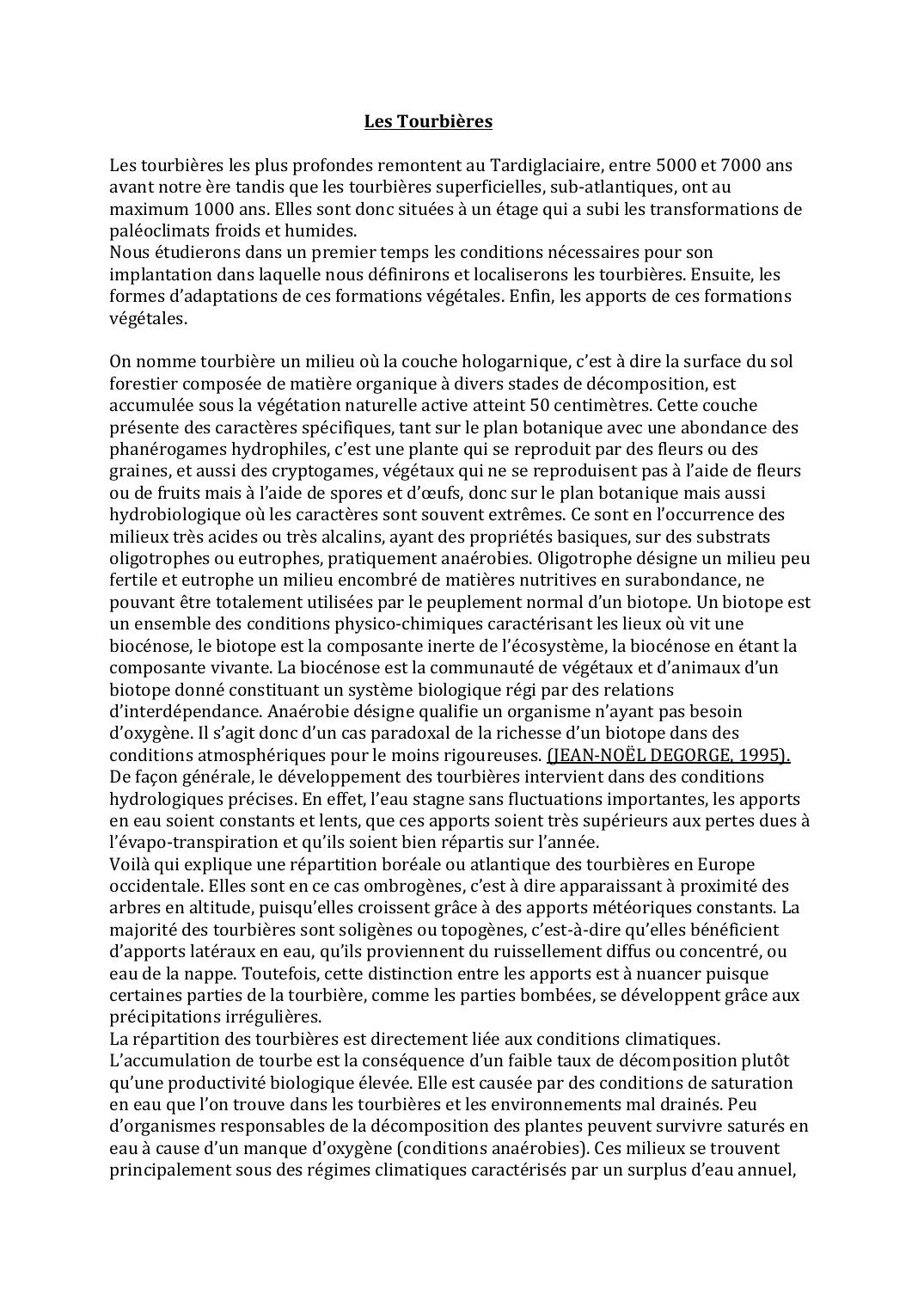Les Tourbières
Publié le 16/05/2020
Extrait du document
«
Les Tourbières
Les tourbières les plus profondes remontent au Tardiglaciaire, entre 5000 et 7000 ans
avant notre ère tandis que les tourbières superficielles, sub-atlantiques, ont au
maximum 1000 ans.
Elles sont donc situées à un étage qui a subi les transformations de
paléoclimats froids et humides.
Nous étudierons dans un premier temps les conditions nécessaires pour son
implantation dans laquelle nous définirons et localiserons les tourbières.
Ensuite, les
formes d’adaptations de ces formations végétales.
Enfin, les apports de ces formations
végétales.
On nomme tourbière un milieu où la couche hologarnique, c’est à dire la surface du sol
forestier composée de matière organique à divers stades de décomposition, est
accumulée sous la végétation naturelle active atteint 50 centimètres.
Cette couche
présente des caractères spécifiques, tant sur le plan botanique avec une abondance des
phanérogames hydrophiles, c’est une plante qui se reproduit par des fleurs ou des
graines, et aussi des cryptogames, végétaux qui ne se reproduisent pas à l’aide de fleurs
ou de fruits mais à l’aide de spores et d’ œufs, donc sur le plan botanique mais aussi
hydrobiologique où les caractères sont souvent extrêmes.
Ce sont en l’occurrence des
milieux très acides ou très alcalins, ayant des propriétés basiques, sur des substrats
oligotrophes ou eutrophes, pratiquement anaérobies.
Oligotrophe désigne un milieu peu
fertile et eutrophe un milieu encombré de matières nutritives en surabondance, ne
pouvant être totalement utilisées par le peuplement normal d’un biotope.
Un biotope est
un ensemble des conditions physico-chimiques caractérisant les lieux où vit une
biocénose, le biotope est la composante inerte de l’écosystème, la biocénose en étant la
composante vivante.
La biocénose est la communauté de végétaux et d’animaux d’un
biotope donné constituant un système biologique régi par des relations
d’interdépendance.
Anaérobie désigne qualifie un organisme n’ayant pas besoin
d’oxygène.
Il s’agit donc d’un cas paradoxal de la richesse d’un biotope dans des
conditions atmosphériques pour le moins rigoureuses.
(JEAN-NOËL DEGORGE, 1995).
De façon générale, le développement des tourbières intervient dans des conditions
hydrologiques précises.
En effet, l’eau stagne sans fluctuations importantes, les apports
en eau soient constants et lents, que ces apports soient très supérieurs aux pertes dues à
l’évapo-transpiration et qu’ils soient bien répartis sur l’année.
Voilà qui explique une répartition boréale ou atlantique des tourbières en Europe
occidentale.
Elles sont en ce cas ombrogènes, c’est à dire apparaissant à proximité des
arbres en altitude, puisqu’elles croissent grâce à des apports météoriques constants.
La
majorité des tourbières sont soligènes ou topogènes, c’est-à-dire qu’elles bénéficient
d’apports latéraux en eau, qu’ils proviennent du ruissellement diffus ou concentré, ou
eau de la nappe.
Toutefois, cette distinction entre les apports est à nuancer puisque
certaines parties de la tourbière, comme les parties bombées, se développent grâce aux
précipitations irrégulières.
La répartition des tourbières est directement liée aux conditions climatiques.
L’accumulation de tourbe est la conséquence d’un faible taux de décomposition plutôt
qu’une productivité biologique élevée.
Elle est causée par des conditions de saturation
en eau que l’on trouve dans les tourbières et les environnements mal drainés.
Peu
d’organismes responsables de la décomposition des plantes peuvent survivre saturés en
eau à cause d’un manque d’oxygène (conditions anaérobies).
Ces milieux se trouvent
principalement sous des régimes climatiques caractérisés par un surplus d’eau annuel,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓