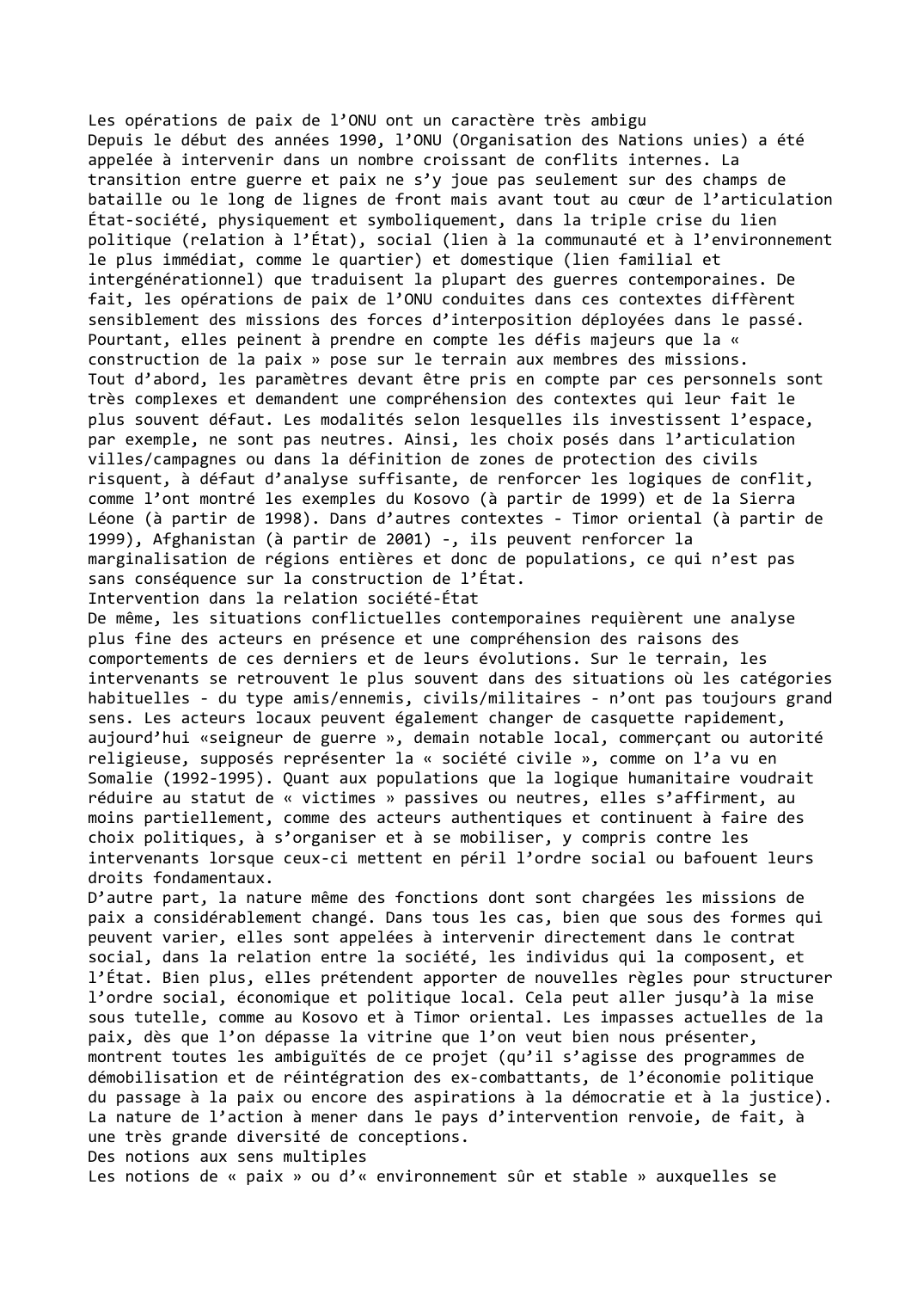Les opérations de paix de l'ONU ont un caractère très ambigu
Publié le 09/09/2020
Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Les opérations de paix de l'ONU ont un caractère très ambigu. Ce document contient 851 mots soit 2 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en: Histoire-géographie.
ONU (ORGANISATION DES NATIONS UNIES) Organisation internationale visant à la coopération entre les peuples et à la sauvegarde de la paix dans le monde. Elle succéda à la Société des Nations (S.D.N.) après la signature de la charte de San Francisco (26 juin 1945) approuvée par cinquante et une nations. En 1983, elle en regroupait cent cinquante-huit. Son Conseil de sécurité compte quinze membres dont cinq permanents (les États-Unis, la France, la Chine, la Grande-Bretagne et l’URSS). Parmi les principales sections spécialisées de l’ONU : □ l’Organisation internationale du travail (OIT) ; □ l’Organisation pour l’éducation, la science et la culture (Unesco); □ l’Union postale universelle (UPU); □ la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ; □ le Fonds monétaire international (FMI) ; □ l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cependant, l’efficacité de cet organisme s’est révélée de faible portée chaque fois qu’il s’est heurté à l’opposition d’une grande puissance résolue à ignorer ses décisions.«
Les opérations de paix de l’ONU ont un caractère très ambigu
Depuis le début des années 1990, l’ONU (Organisation des Nations unies) a été
appelée à intervenir dans un nombre croissant de conflits internes.
La
transition entre guerre et paix ne s’y joue pas seulement sur des champs de
bataille ou le long de lignes de front mais avant tout au c œur de l’articulation
État-société, physiquement et symboliquement, dans la triple crise du lien
politique (relation à l’État), social (lien à la communauté et à l’environnement
le plus immédiat, comme le quartier) et domestique (lien familial et
intergénérationnel) que traduisent la plupart des guerres contemporaines.
De
fait, les opérations de paix de l’ONU conduites dans ces contextes diffèrent
sensiblement des missions des forces d’interposition déployées dans le passé.
Pourtant, elles peinent à prendre en compte les défis majeurs que la «
construction de la paix » pose sur le terrain aux membres des missions.
Tout d’abord, les paramètres devant être pris en compte par ces personnels sont
très complexes et demandent une compréhension des contextes qui leur fait le
plus souvent défaut.
Les modalités selon lesquelles ils investissent l’espace,
par exemple, ne sont pas neutres.
Ainsi, les choix posés dans l’articulation
villes/campagnes ou dans la définition de zones de protection des civils
risquent, à défaut d’analyse suffisante, de renforcer les logiques de conflit,
comme l’ont montré les exemples du Kosovo (à partir de 1999) et de la Sierra
Léone (à partir de 1998).
Dans d’autres contextes - Timor oriental (à partir de
1999), Afghanistan (à partir de 2001) -, ils peuvent renforcer la
marginalisation de régions entières et donc de populations, ce qui n’est pas
sans conséquence sur la construction de l’État.
Intervention dans la relation société-État
De même, les situations conflictuelles contemporaines requièrent une analyse
plus fine des acteurs en présence et une compréhension des raisons des
comportements de ces derniers et de leurs évolutions.
Sur le terrain, les
intervenants se retrouvent le plus souvent dans des situations où les catégories
habituelles - du type amis/ennemis, civils/militaires - n’ont pas toujours grand
sens.
Les acteurs locaux peuvent également changer de casquette rapidement,
aujourd’hui «seigneur de guerre », demain notable local, commerçant ou autorité
religieuse, supposés représenter la « société civile », comme on l’a vu en
Somalie (1992-1995).
Quant aux populations que la logique humanitaire voudrait
réduire au statut de « victimes » passives ou neutres, elles s’affirment, au
moins partiellement, comme des acteurs authentiques et continuent à faire des
choix politiques, à s’organiser et à se mobiliser, y compris contre les
intervenants lorsque ceux-ci mettent en péril l’ordre social ou bafouent leurs
droits fondamentaux.
D’autre part, la nature même des fonctions dont sont chargées les missions de
paix a considérablement changé.
Dans tous les cas, bien que sous des formes qui
peuvent varier, elles sont appelées à intervenir directement dans le contrat
social, dans la relation entre la société, les individus qui la composent, et
l’État.
Bien plus, elles prétendent apporter de nouvelles règles pour structurer
l’ordre social, économique et politique local.
Cela peut aller jusqu’à la mise
sous tutelle, comme au Kosovo et à Timor oriental.
Les impasses actuelles de la
paix, dès que l’on dépasse la vitrine que l’on veut bien nous présenter,
montrent toutes les ambiguïtés de ce projet (qu’il s’agisse des programmes de
démobilisation et de réintégration des ex-combattants, de l’économie politique
du passage à la paix ou encore des aspirations à la démocratie et à la justice).
La nature de l’action à mener dans le pays d’intervention renvoie, de fait, à
une très grande diversité de conceptions.
Des notions aux sens multiples
Les notions de « paix » ou d’« environnement sûr et stable » auxquelles se.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La fondation de l'ONU nourrit l'espoir d'une paix mondiale durable
- En quoi cette scène d’aveu est-elle révélatrice du caractère héroïque des deux personnages ?
- comment la construction de la paix, à la fin de la Première Guerre mondiale, confirme le suicide de l’Europe
- Comment l’ONU pourrait-elle remplir ses missions d’une manière plus efficace?
- Les opérations Overlord et Bagration ont porté le coup de grâce à l’Allemagne nazie