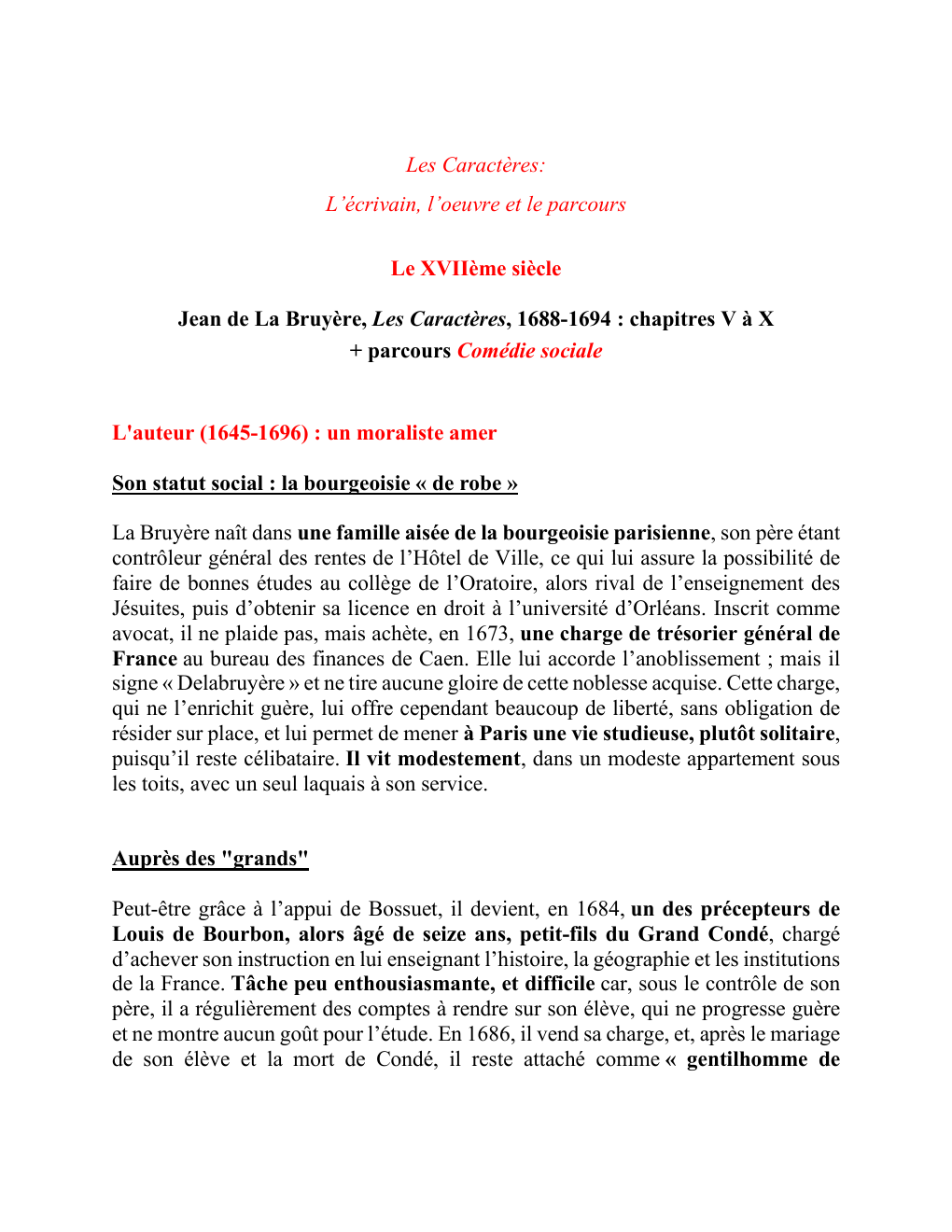Les Caractères: L’écrivain, l’oeuvre et le parcours Le XVIIème siècle Jean de La Bruyère, Les Caractères, 1688-1694 : chapitres V à X
Publié le 29/03/2025
Extrait du document
«
Les Caractères:
L’écrivain, l’oeuvre et le parcours
Le XVIIème siècle
Jean de La Bruyère, Les Caractères, 1688-1694 : chapitres V à X
+ parcours Comédie sociale
L'auteur (1645-1696) : un moraliste amer
Son statut social : la bourgeoisie « de robe »
La Bruyère naît dans une famille aisée de la bourgeoisie parisienne, son père étant
contrôleur général des rentes de l’Hôtel de Ville, ce qui lui assure la possibilité de
faire de bonnes études au collège de l’Oratoire, alors rival de l’enseignement des
Jésuites, puis d’obtenir sa licence en droit à l’université d’Orléans.
Inscrit comme
avocat, il ne plaide pas, mais achète, en 1673, une charge de trésorier général de
France au bureau des finances de Caen.
Elle lui accorde l’anoblissement ; mais il
signe « Delabruyère » et ne tire aucune gloire de cette noblesse acquise.
Cette charge,
qui ne l’enrichit guère, lui offre cependant beaucoup de liberté, sans obligation de
résider sur place, et lui permet de mener à Paris une vie studieuse, plutôt solitaire,
puisqu’il reste célibataire.
Il vit modestement, dans un modeste appartement sous
les toits, avec un seul laquais à son service.
Auprès des "grands"
Peut-être grâce à l’appui de Bossuet, il devient, en 1684, un des précepteurs de
Louis de Bourbon, alors âgé de seize ans, petit-fils du Grand Condé, chargé
d’achever son instruction en lui enseignant l’histoire, la géographie et les institutions
de la France.
Tâche peu enthousiasmante, et difficile car, sous le contrôle de son
père, il a régulièrement des comptes à rendre sur son élève, qui ne progresse guère
et ne montre aucun goût pour l’étude.
En 1686, il vend sa charge, et, après le mariage
de son élève et la mort de Condé, il reste attaché comme « gentilhomme de
Monsieur le duc » à sa maison en qualité d’« homme de lettres », c'est-à-dire chargé
de la bibliothèque.
Mais ne nous y trompons pas, si elle lui offre la possibilité d'observer la vie des
"grands", sa charge ne lui vaut que bien des mépris, comme le déclare le critique
Émile Faguet : « C’est un demi-déclassé, mêlé à un monde qui le regarde de haut et
qu’il observe d’en bas.
» (L'Âge d'or de la littérature française au XVIIème siècle)
C’est, en effet, son amertume qui ressort de la conclusion de son Discours à
l’Académie, où il remercie les Académiciens de son élection en 1693 après deux
échecs : « Il n’y a ni poste, ni crédit, ni richesses, ni titres, ni autorité, ni faveur qui
aient pu vous plier à faire ce choix : je n’ai rien de toutes ces choses, tout me manque.
Un Ouvrage qui a eu quelque succès par sa singularité, et dont les fausses, je dis les
fausses et malignes applications pouvaient me nuire auprès des personnes moins
équitables et moins éclairées que vous, a été toute la médiation que j’ai employée et
que vous avez reçue, quel moyen de me repentir jamais d’avoir écrit ! »
Le contexte de l'œuvre
Dans la mesure où, par-delà le modèle cité, Théophraste (vers 371-288 av.
J.-C.),
philosophe de l’antiquité grecque, le sous-titre de l’œuvre précise « de ce siècle », il
est important de connaître les caractéristiques de l’époque de l’écriture.
La politique extérieure
À la mort de Mazarin, en 1661, Louis XIV décide de gouverner seul, de « réunir
en lui seul toute l’autorité du maître », comme l’expliquent ses Mémoires.
Or, la
charge du Roi est d’abord, à ses yeux, de faire la guerre, de façon à imposer son
prestige et à assurer sa gloire.
La première guerre, celle dite "de Dévolution", en
1667-1668, correspond à son désir d’annexer une partie des Flandres et le Pays-Bas
espagnol, échec partiel de cette tentative, qui conduit à la "guerre de Hollande", en
1672.
Elle dure six ans : la conquête échoue, mais la "paix de Nimègue" établit la
paix, favorable au commerce et à la navigation.
Cependant, la Révocation de l’Édit
de Nantes, en 1685, en ramenant la division du pays entre catholiques et protestants,
conduit ceux-ci à s’exiler.
Outre l’appauvrissement du royaume, cela prépare la
coalition des pays protestants en Europe contre la France, qui mènera à de nouvelles
guerres dès 1688.
Or, ces guerres sont coûteuses, et le trésor royal se vide.
Pour faire rentrer de
l’argent, une partie du domaine royal est vendu, des exemptions d’impôts, des droits
et, surtout, des charges et des titres sont accordés.
Ainsi se multiplient des
parvenus, auxquels leur argent ouvre l’accès à la noblesse.
Parallèlement, de
nouveaux impôts sont créés, qui accablent le peuple et donnent du pouvoir aux «
fermiers généraux », chargés de les collecter, et l’État est aussi contraint
d’emprunter, ce qui accroît encore la puissance des banquiers.
La spéculation va
croissante.
Bien des critiques de La Bruyère portent sur ces changements sociaux.
La politique intérieure
Louis XIV est resté profondément marqué par la Fronde (1648-1653) qui a fait
vaciller la monarchie absolue.
Dès son accession au pouvoir absolu, il manifeste sa
méfiance envers les "nobles", qu’il écarte du Conseil du Roi et réduit au silence
dans les Parlements, notamment celui de Paris, pour privilégier la bourgeoisie :
devant tout au roi, ses titres, ses charges, sa fortune, il s’assure ainsi de la fidélité de
ces nouveaux "grands".
Il s’emploie aussi à contrôler l’armée, le clergé, voyage en
province pour sévir contre ce qu’il nomme « la tyrannie des nobles », tout en
réprimant sévèrement toute sédition du peuple, dont les guerres accentuent la
misère.
La cour, c’est-à-dire les membres de la famille royale et tous ceux qui exercent des
charges dans l’État, soient environ 4000 personnes, s’installe, en 1682, à Versailles,
château agrandi et embelli depuis plusieurs années.
Ainsi se multiplient les
"courtisans" : ils brillent par leur faste, qui fascine et sert de modèle, mais sont en
réalité dépourvus de pouvoir, pris au piège de l’étiquette, soumis au monarque et
à ses exigences.
La Bruyère en fera des portraits violemment critiques.
Le contexte culturel
Dans les Caractères, au début du premier chapitre « Des ouvrages de l’esprit », La
Bruyère écrit :
« Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des
hommes, et qui pensent.
Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur
est enlevé ; l’on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d’entre les
modernes.
Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener les autres à
notre goût et à nos sentiments ; c’est une grande entreprise.
»
Façon indirecte de parler de lui-même, cette phrase, outre le pessimisme de son
auteur, reflète la conception classique d’une permanence de la nature humaine,
héritage des auteurs moralistes antiques, tant au théâtre, avec le grec Ménandre ou
le latin Térence, mais aussi les satiristes, Horace, Juvénal… Elle contraste pourtant
avec la formule du sous-titre « les mœurs de ce siècle».
Elle illustre surtout la situation littéraire à la fin du siècle, car les grands succès
des auteurs "classiques" datent déjà de plusieurs années : en 1688, date de la
première édition des Caractères, La Rochefoucauld a publié ses Maximes en 1664,
Boileau ses Satires en 1666, Pascal ses Pensées en 1670, Molière ses deux recueils
de Fables en 1668 et 1678, et Molière est mort en 1673…
Mais tout est loin d’avoir été « dit », bien au contraire, l’esprit critique, qui prendra
son essor au "siècle des Lumières", s’installe en force, aussi bien dans les essais,
comme chez Bayle, dans Pensées diverses sur la comète (1683), chez Fontenelle
dans Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), que dans les pièces de Regnard,
de Dancourt ou de Saint-Yon qui abordent les thèmes de l’argent, des abbés de cour,
de l’arrivisme…
Ainsi, partisan des Anciens, La Bruyère s’inscrit, par le regard sévère qu’il jette
sur la société de son temps, dans le mouvement de son temps, et c’est ce qui
explique aussi le succès de son ouvrage.
Présentation des Caractères
Titre et sous-titre
Le modèle : Théophraste
C’est vers 319 av.
J.-C.
que le philosophe grec Théophraste a écrit ses Caractères,
en grec « Ἠθικοὶ χαρακτήρες », intéressante précision que cet adjectif, « éthiques »,
apporte sur l’orientation morale, et non pas physiologique, de l’ouvrage.
Depuis
Aristote, en effet, la « comédie de caractère », censée proposer le portrait particulier,
familier et souvent critique, d’un personnage, est distinguée de la « comédie de
mœurs », dénonciation plus générale.
Or, dans la Préface, sans doute apocryphe mais
que La Bruyère présente comme écrite par Théophraste, ces deux dimensions sont
réunies :
Je me suis toujours attaché à étudier les hommes vertueux, comme ceux qui n’étaient
connus que par leurs vices ; il semble que j’ai dû marquer les caractères des uns et
des autres, et ne me pas contenter de peindre les Grecs en général, mais même de
toucher ce qui est personnel, et ce que quelques-uns paraissent avoir de plus familier
[…]
[…] et sans faire une plus longue Préface,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- EXPLICATION LINEAIRE: Jean de la Bruyère, Les caractères, «De la cour», 62, 1688.
- La Bruyère, Les Caractères ou les moeurs de ce siècle. De la ville.1688. Narcisse
- Jean de La Bruyère, «Du Souverain ou de la République», Les Caractères, 1688.
- CARACTÈRES OU LES M¼URS DE CE SIÈCLE (Les) Jean de La Bruyère. Études de mœurs
- Analyse Linéaire : Jean de la Bruyère, Les caractères, « De la cour », 62, 1688.