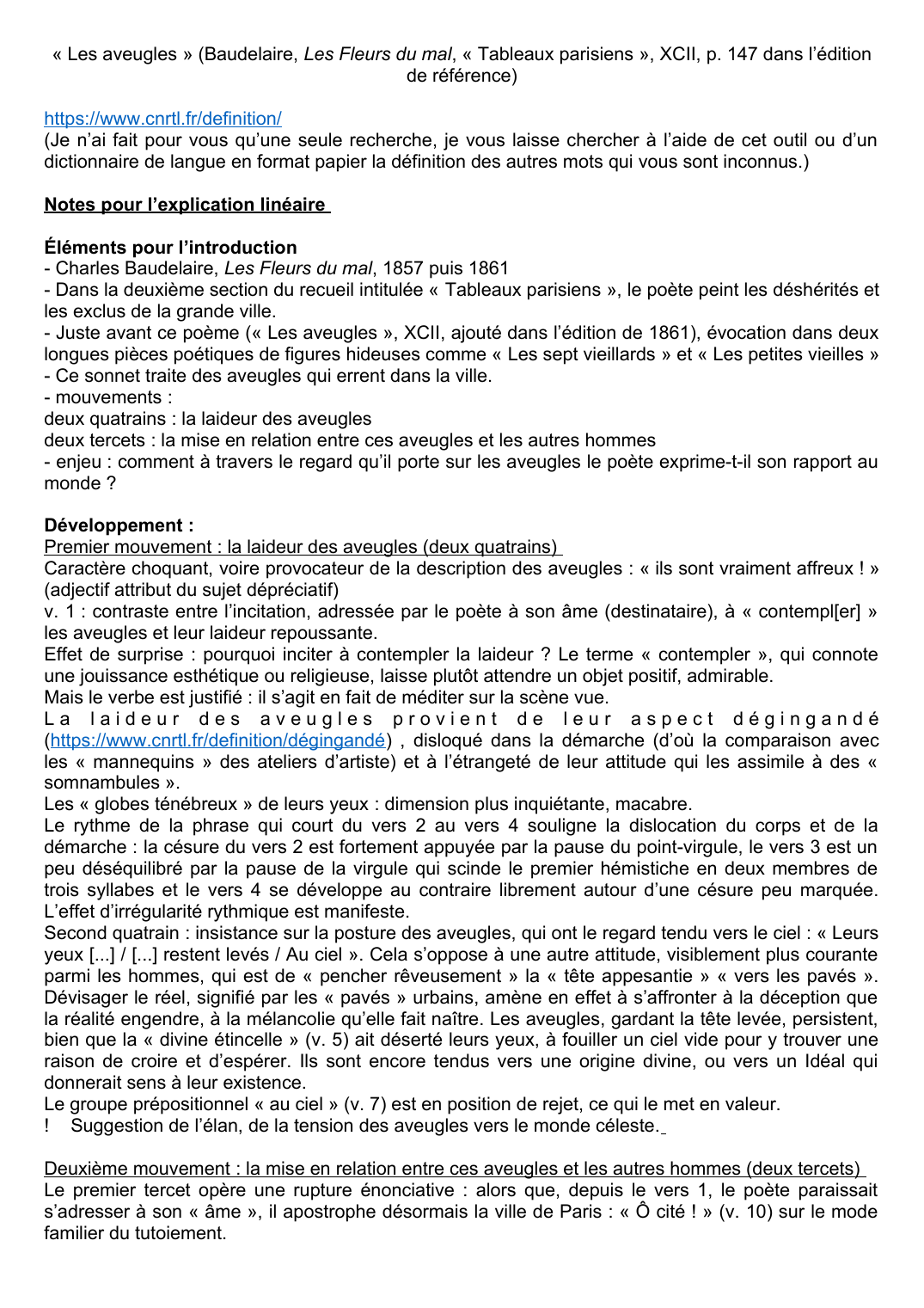« Les aveugles » (Baudelaire, Les Fleurs du mal , « Tableaux parisiens », XCII
Publié le 14/05/2021

Extrait du document
«
« Les aveugles » (Baudelaire, Les Fleurs du mal , « Tableaux parisiens », XCII, p.
147 dans l’édition
de référence)
https://www.cnrtl.fr/definition/
(Je n’ai fait pour vous qu’une seule recherche, je vous laisse chercher à l’aide de cet outil ou d’un
dictionnaire de langue en format papier la définition des autres mots qui vous sont inconnus.)
Notes pour l’explication linéaire
Éléments pour l’introduction
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal , 1857 puis 1861
- Dans la deuxième section du recueil intitulée « Tableaux parisiens », le poète peint les déshérités et
les exclus de la grande ville.
- Juste avant ce poème (« Les aveugles », XCII, ajouté dans l’édition de 1861), évocation dans deux
longues pièces poétiques de figures hideuses comme « Les sept vieillards » et « Les petites vieilles »
- Ce sonnet traite des aveugles qui errent dans la ville.
- mouvements :
deux quatrains : la laideur des aveugles
deux tercets : la mise en relation entre ces aveugles et les autres hommes
- enjeu : comment à travers le regard qu’il porte sur les aveugles le poète exprime-t-il son rapport au
monde ?
Développement :
Premier mouvement : la laideur des aveugles (deux quatrains)
Caractère choquant, voire provocateur de la description des aveugles : « ils sont vraiment affreux ! »
(adjectif attribut du sujet dépréciatif)
v.
1 : contraste entre l’incitation, adressée par le poète à son âme (destinataire), à « contempl[er] »
les aveugles et leur laideur repoussante.
Effet de surprise : pourquoi inciter à contempler la laideur ? Le terme « contempler », qui connote
une jouissance esthétique ou religieuse, laisse plutôt attendre un objet positif, admirable.
Mais le verbe est justifié : il s’agit en fait de méditer sur la scène vue.
L a l a i d e u r d e s a v e u g l e s p r o v i e n t d e l e u r a s p e c t d é g i n g a n d é
( https://www.cnrtl.fr/definition/dégingandé ) , disloqué dans la démarche (d’où la comparaison avec
les « mannequins » des ateliers d’artiste) et à l’étrangeté de leur attitude qui les assimile à des «
somnambules ».
Les « globes ténébreux » de leurs yeux : dimension plus inquiétante, macabre.
Le rythme de la phrase qui court du vers 2 au vers 4 souligne la dislocation du corps et de la
démarche : la césure du vers 2 est fortement appuyée par la pause du point-virgule, le vers 3 est un
peu déséquilibré par la pause de la virgule qui scinde le premier hémistiche en deux membres de
trois syllabes et le vers 4 se développe au contraire librement autour d’une césure peu marquée.
L’effet d’irrégularité rythmique est manifeste.
Second quatrain : insistance sur la posture des aveugles, qui ont le regard tendu vers le ciel : « Leurs
yeux [...] / [...] restent levés / Au ciel ».
Cela s’oppose à une autre attitude, visiblement plus courante
parmi les hommes, qui est de « pencher rêveusement » la « tête appesantie » « vers les pavés ».
Dévisager le réel, signifié par les « pavés » urbains, amène en effet à s’affronter à la déception que
la réalité engendre, à la mélancolie qu’elle fait naître.
Les aveugles, gardant la tête levée, persistent,
bien que la « divine étincelle » (v.
5) ait déserté leurs yeux, à fouiller un ciel vide pour y trouver une
raison de croire et d’espérer.
Ils sont encore tendus vers une origine divine, ou vers un Idéal qui
donnerait sens à leur existence.
Le groupe prépositionnel « au ciel » (v.
7) est en position de rejet, ce qui le met en valeur.
! Suggestion de l’élan, de la tension des aveugles vers le monde céleste.
Deuxième mouvement : la mise en relation entre ces aveugles et les autres hommes (deux tercets)
Le premier tercet opère une rupture énonciative : alors que, depuis le vers 1, le poète paraissait
s’adresser à son « âme », il apostrophe désormais la ville de Paris : « Ô cité ! » (v.
10) sur le mode
familier du tutoiement..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte EAF n°5 : « Le soleil », Charles Baudelaire, dans la section « Les Tableaux parisiens », Les Fleurs du Mal
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, Tableaux parisiens, « Brumes et pluies ». Commentaire
- « A une passante » in LES FLEURS DU MAL , section : « Les Tableaux parisiens » (XCIII)
- Baudelaire, Les Fleurs du mal, « Les Aveugles ». Commentaire
- Lecture analytique : «Le Soleil», in «Tableaux parisiens», Les Fleursdu mal, Baudelaire, 1861