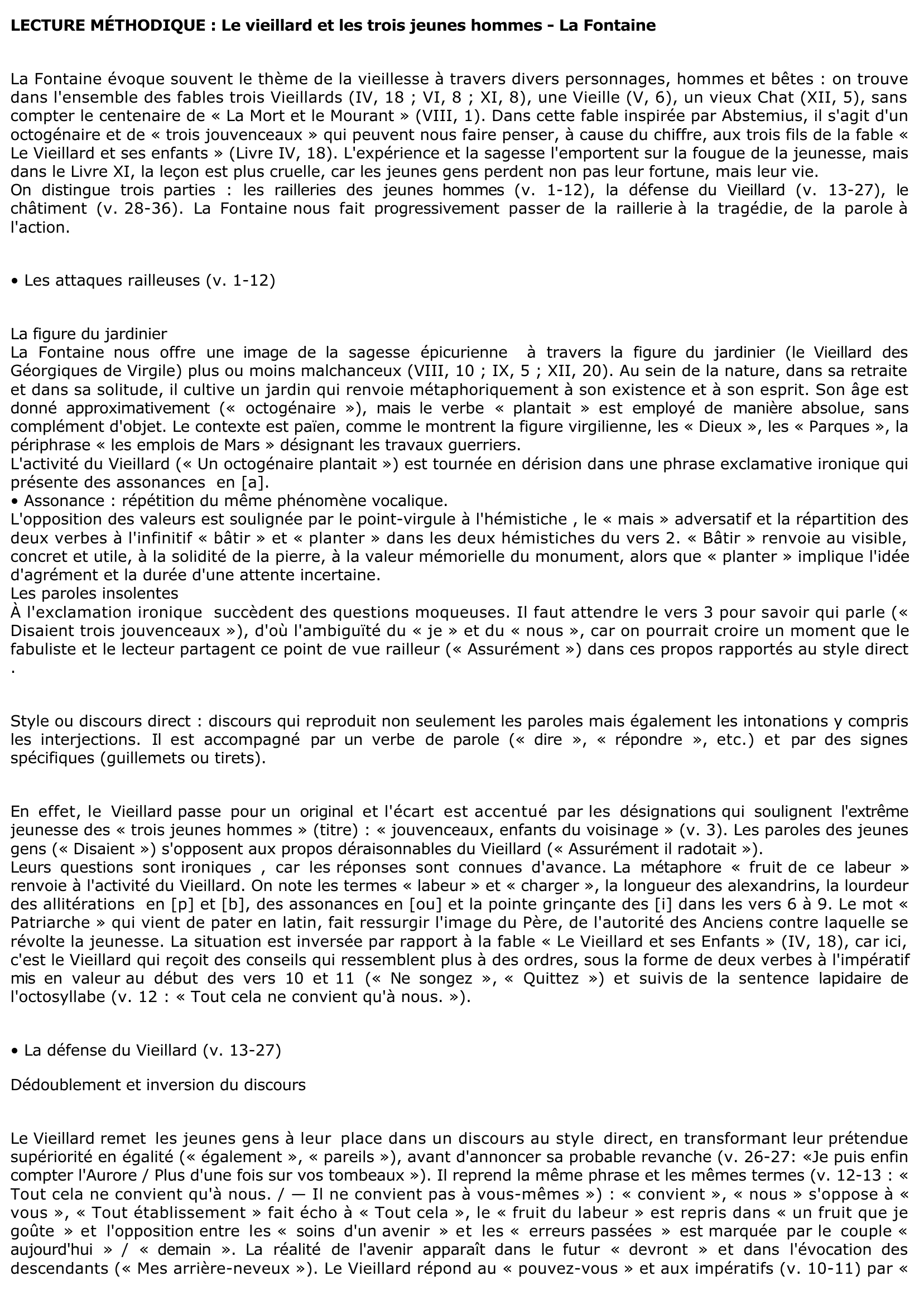LECTURE MÉTHODIQUE : Le vieillard et les trois jeunes hommes - La Fontaine
Publié le 15/05/2020

Extrait du document
«
LECTURE MÉTHODIQUE : Le vieillard et les trois jeunes hommes - La Fontaine
La Fontaine évoque souvent le thème de la vieillesse à travers divers personnages, hommes et bêtes : on trouvedans l'ensemble des fables trois Vieillards (IV, 18 ; VI, 8 ; XI, 8), une Vieille (V, 6), un vieux Chat (XII, 5), sanscompter le centenaire de « La Mort et le Mourant » (VIII, 1).
Dans cette fable inspirée par Abstemius, il s'agit d'unoctogénaire et de « trois jouvenceaux » qui peuvent nous faire penser, à cause du chiffre, aux trois fils de la fable «Le Vieillard et ses enfants » (Livre IV, 18).
L'expérience et la sagesse l'emportent sur la fougue de la jeunesse, maisdans le Livre XI, la leçon est plus cruelle, car les jeunes gens perdent non pas leur fortune, mais leur vie.On distingue trois parties : les railleries des jeunes hommes (v.
1-12), la défense du Vieillard (v.
13-27), lechâtiment (v.
28-36).
La Fontaine nous fait progressivement passer de la raillerie à la tragédie, de la parole àl'action.
• Les attaques railleuses (v.
1-12)
La figure du jardinierLa Fontaine nous offre une image de la sagesse épicurienne à travers la figure du jardinier (le Vieillard desGéorgiques de Virgile) plus ou moins malchanceux (VIII, 10 ; IX, 5 ; XII, 20).
Au sein de la nature, dans sa retraiteet dans sa solitude, il cultive un jardin qui renvoie métaphoriquement à son existence et à son esprit.
Son âge estdonné approximativement (« octogénaire »), mais le verbe « plantait » est employé de manière absolue, sanscomplément d'objet.
Le contexte est païen, comme le montrent la figure virgilienne, les « Dieux », les « Parques », lapériphrase « les emplois de Mars » désignant les travaux guerriers.L'activité du Vieillard (« Un octogénaire plantait ») est tournée en dérision dans une phrase exclamative ironique quiprésente des assonances en [a].• Assonance : répétition du même phénomène vocalique.L'opposition des valeurs est soulignée par le point-virgule à l'hémistiche , le « mais » adversatif et la répartition desdeux verbes à l'infinitif « bâtir » et « planter » dans les deux hémistiches du vers 2.
« Bâtir » renvoie au visible,concret et utile, à la solidité de la pierre, à la valeur mémorielle du monument, alors que « planter » implique l'idéed'agrément et la durée d'une attente incertaine.Les paroles insolentesÀ l'exclamation ironique succèdent des questions moqueuses.
Il faut attendre le vers 3 pour savoir qui parle («Disaient trois jouvenceaux »), d'où l'ambiguïté du « je » et du « nous », car on pourrait croire un moment que lefabuliste et le lecteur partagent ce point de vue railleur (« Assurément ») dans ces propos rapportés au style direct.
Style ou discours direct : discours qui reproduit non seulement les paroles mais également les intonations y comprisles interjections.
Il est accompagné par un verbe de parole (« dire », « répondre », etc.) et par des signesspécifiques (guillemets ou tirets).
En effet, le Vieillard passe pour un original et l'écart est accentué par les désignations qui soulignent l'extrêmejeunesse des « trois jeunes hommes » (titre) : « jouvenceaux, enfants du voisinage » (v.
3).
Les paroles des jeunesgens (« Disaient ») s'opposent aux propos déraisonnables du Vieillard (« Assurément il radotait »).Leurs questions sont ironiques , car les réponses sont connues d'avance.
La métaphore « fruit de ce labeur »renvoie à l'activité du Vieillard.
On note les termes « labeur » et « charger », la longueur des alexandrins, la lourdeurdes allitérations en [p] et [b], des assonances en [ou] et la pointe grinçante des [i] dans les vers 6 à 9.
Le mot «Patriarche » qui vient de pater en latin, fait ressurgir l'image du Père, de l'autorité des Anciens contre laquelle serévolte la jeunesse.
La situation est inversée par rapport à la fable « Le Vieillard et ses Enfants » (IV, 18), car ici,c'est le Vieillard qui reçoit des conseils qui ressemblent plus à des ordres, sous la forme de deux verbes à l'impératifmis en valeur au début des vers 10 et 11 (« Ne songez », « Quittez ») et suivis de la sentence lapidaire del'octosyllabe (v.
12 : « Tout cela ne convient qu'à nous.
»).
• La défense du Vieillard (v.
13-27)
Dédoublement et inversion du discours
Le Vieillard remet les jeunes gens à leur place dans un discours au style direct, en transformant leur prétenduesupériorité en égalité (« également », « pareils »), avant d'annoncer sa probable revanche (v.
26-27: «Je puis enfincompter l'Aurore / Plus d'une fois sur vos tombeaux »).
Il reprend la même phrase et les mêmes termes (v.
12-13 : «Tout cela ne convient qu'à nous.
/ — Il ne convient pas à vous-mêmes ») : « convient », « nous » s'oppose à «vous », « Tout établissement » fait écho à « Tout cela », le « fruit du labeur » est repris dans « un fruit que jegoûte » et l'opposition entre les « soins d'un avenir » et les « erreurs passées » est marquée par le couple «aujourd'hui » / « demain ».
La réalité de l'avenir apparaît dans le futur « devront » et dans l'évocation desdescendants (« Mes arrière-neveux »).
Le Vieillard répond au « pouvez-vous » et aux impératifs (v.
10-11) par «.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans son traité d'éducation, Émile, publié en 1762, Rousseau déclare à propos de l'utilisation, fréquente à l'époque, des Fables pour l'éducation morale des jeunes enfants : Composons M. de La Fontaine. Je promets quant à moi de vous lire, de vous aimer, de m'instruire dans vos fables, mais pour mon élève, permettez que je ne lui en laisse pas étudier une seule. Dans quelle mesure votre lecture personnelle du 2e recueil des Fables vous permet-elle de comprendre et de partager les rét
- fable les 3 jeunes hommes (méthode du bac) - La Fontaine
- Qui ne prend plaisir à la lecture des Fables de La Fontaine ?
- Encyclopédie littéraire: lecture méthodique
- POURQUOI AIMONS-NOUS LA FONTAINE ? Après avoir étudié l'oeuvre de La Fontaine, un critique contemporain conclut : « Il n'y a pas de note humaine qui ne s'y fasse entendre, l'ironie, l'émotion, la pitié, le courage, le goût du plaisir et de la retraite, l'acceptation de la vie et le besoin du rêve. On voudrait faire sentir pourquoi on l'aime ; mais on n'ose forcer la voix quand on parle du plus discret des poètes. » Vous direz si vous retrouvez dans ces quelques lignes l'impression que