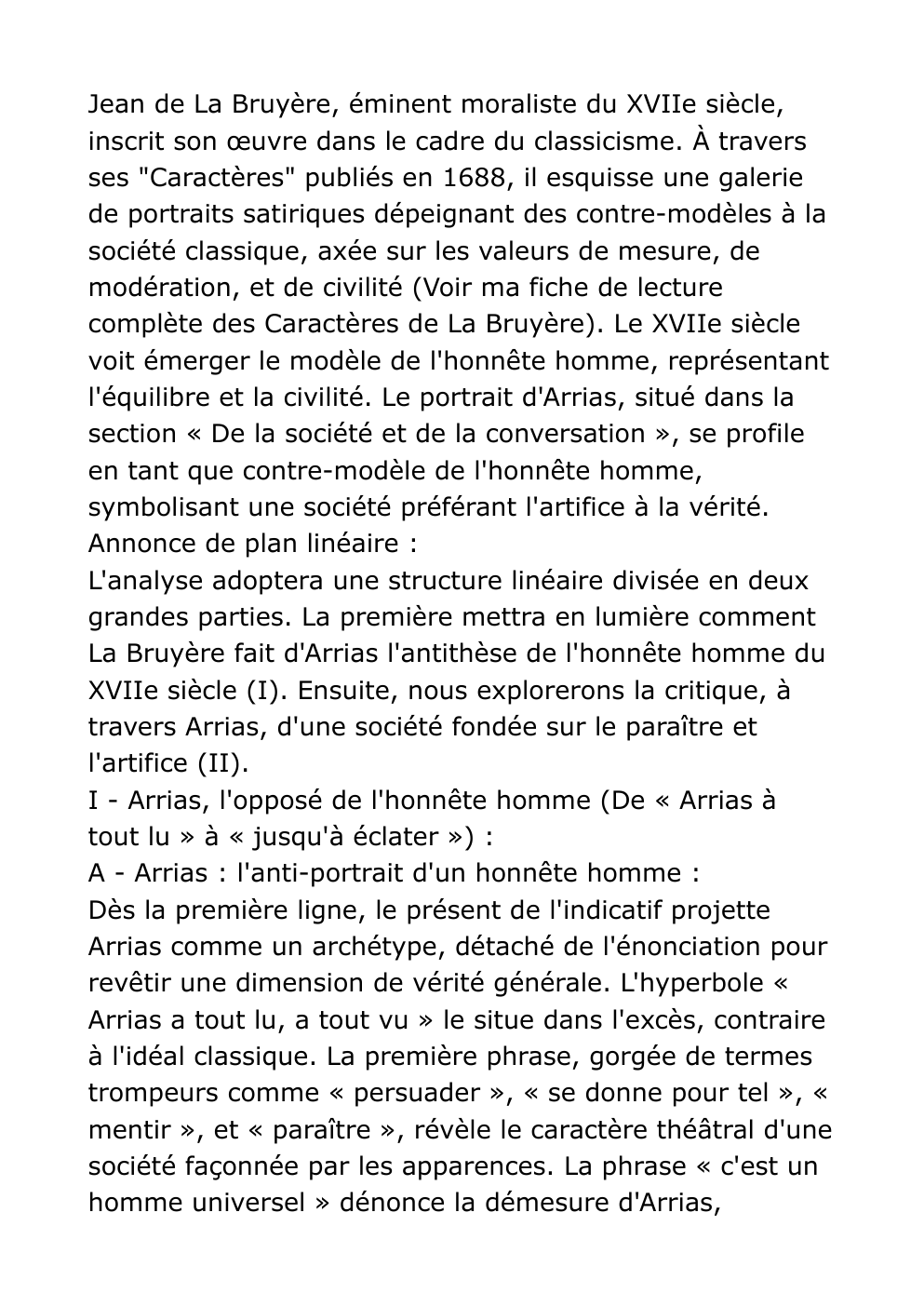lecture linéaire du portrait d'arrias
Publié le 15/01/2024
Extrait du document
«
Jean de La Bruyère, éminent moraliste du XVIIe siècle,
inscrit son œuvre dans le cadre du classicisme.
À travers
ses "Caractères" publiés en 1688, il esquisse une galerie
de portraits satiriques dépeignant des contre-modèles à la
société classique, axée sur les valeurs de mesure, de
modération, et de civilité (Voir ma fiche de lecture
complète des Caractères de La Bruyère).
Le XVIIe siècle
voit émerger le modèle de l'honnête homme, représentant
l'équilibre et la civilité.
Le portrait d'Arrias, situé dans la
section « De la société et de la conversation », se profile
en tant que contre-modèle de l'honnête homme,
symbolisant une société préférant l'artifice à la vérité.
Annonce de plan linéaire :
L'analyse adoptera une structure linéaire divisée en deux
grandes parties.
La première mettra en lumière comment
La Bruyère fait d'Arrias l'antithèse de l'honnête homme du
XVIIe siècle (I).
Ensuite, nous explorerons la critique, à
travers Arrias, d'une société fondée sur le paraître et
l'artifice (II).
I - Arrias, l'opposé de l'honnête homme (De « Arrias à
tout lu » à « jusqu'à éclater ») :
A - Arrias : l'anti-portrait d'un honnête homme :
Dès la première ligne, le présent de l'indicatif projette
Arrias comme un archétype, détaché de l'énonciation pour
revêtir une dimension de vérité générale.
L'hyperbole «
Arrias a tout lu, a tout vu » le situe dans l'excès, contraire
à l'idéal classique.
La première phrase, gorgée de termes
trompeurs comme « persuader », « se donne pour tel », «
mentir », et « paraître », révèle le caractère théâtral d'une
société façonnée par les apparences.
La phrase « c'est un
homme universel » dénonce la démesure d'Arrias,
assimilant son être à une dimension divine,
disproportionnée pour le lecteur du XVIIe siècle.
La
démesure d'Arrias se manifeste dans le comparatif de
supériorité « aime mieux mentir que de se taire ou de
paraître ignorer quelque chose », élevant le vice au
détriment de la vertu « se taire ».
B - Un portrait en mouvement :
À partir de la deuxième phrase, La Bruyère met en scène
le portrait d'Arrias.
Invitant le lecteur à « la table d'un
grand », cette scène s'inscrit dans la tradition satirique du
repas ridicule, déjà raillée par le poète latin Horace et
Boileau.
Le thème inhabituel de la « cour du Nord »
souligne le décalage avec les préoccupations françaises du
XVIIe siècle.
L'allitération en (p) et en (l) accentue le ton
péremptoire d'Arrias, monopolisant la conversation avec
son flot de paroles : « | prend la parole, et l'ôte à ceux qui
allaient dire ce qu'ils en savent ».
L'irréel du passé indique
qu'Arrias se livre à un monologue, transgressant les règles
de bienséance du XVIIe siècle.
La conversation, relevant
du savoir-vivre et de l'urbanité, est un art véritable,
méconnaître ces règles éloigne Arrias du portrait idéal de
l'honnête homme.
C - Arrias monopolise la conversation :
La Bruyère persiste dans l'utilisation du registre satirique
pour tourner Arrias en dérision.
L'anaphore du pronom
personnel « il » inonde la phrase, soulignant le
narcissisme d'Arrias qui aspire à être l'acteur principal de
ce dîner : « il prend la parole (...) il s'oriente (...) il
discourt (...) il récite (...) il les trouve et il en rit ».
Ces
répétitions métamorphosent Arrias en pantin, ses actions
devenant presque mécaniques.
Le champ lexical de la
parole (« parole », « dire », « discourt », « récite », «
contredire ») accentue la monopolisation verbale.
Bien
qu'Arrias n'ait jamais visité la « cour du Nord », une «
région lointaine », il en parle « comme s'il en était
originaire », révélant la supercherie à travers la
conjonction « comme si ».
L'énumération ironique des «
mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et
de ses coutumes » reproduit la structure des récits de
voyage, créant l'illusion d'un récit documenté.
Arrias se
présente....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- lecture linéaire la pricnesse de clèves: e : Quel est le rôle de ce portrait dans l’économie du roman En quoi peut-on dire que ce portrait possède un rôle programmatique ?
- Lecture linéaire du portrait de Goujet dans L’Assommoir Zola
- Première lecture linéaire : le portrait de Mlle de Chartres (Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, 1678, Tome I)
- Lecture linéaire : LE PORTRAIT DE MLLE DE CHARTRES
- Zadig lecture linéaire: En quoi cet extrait de Zadig fait-il le portrait d’un homme raisonnable et éclairé ?