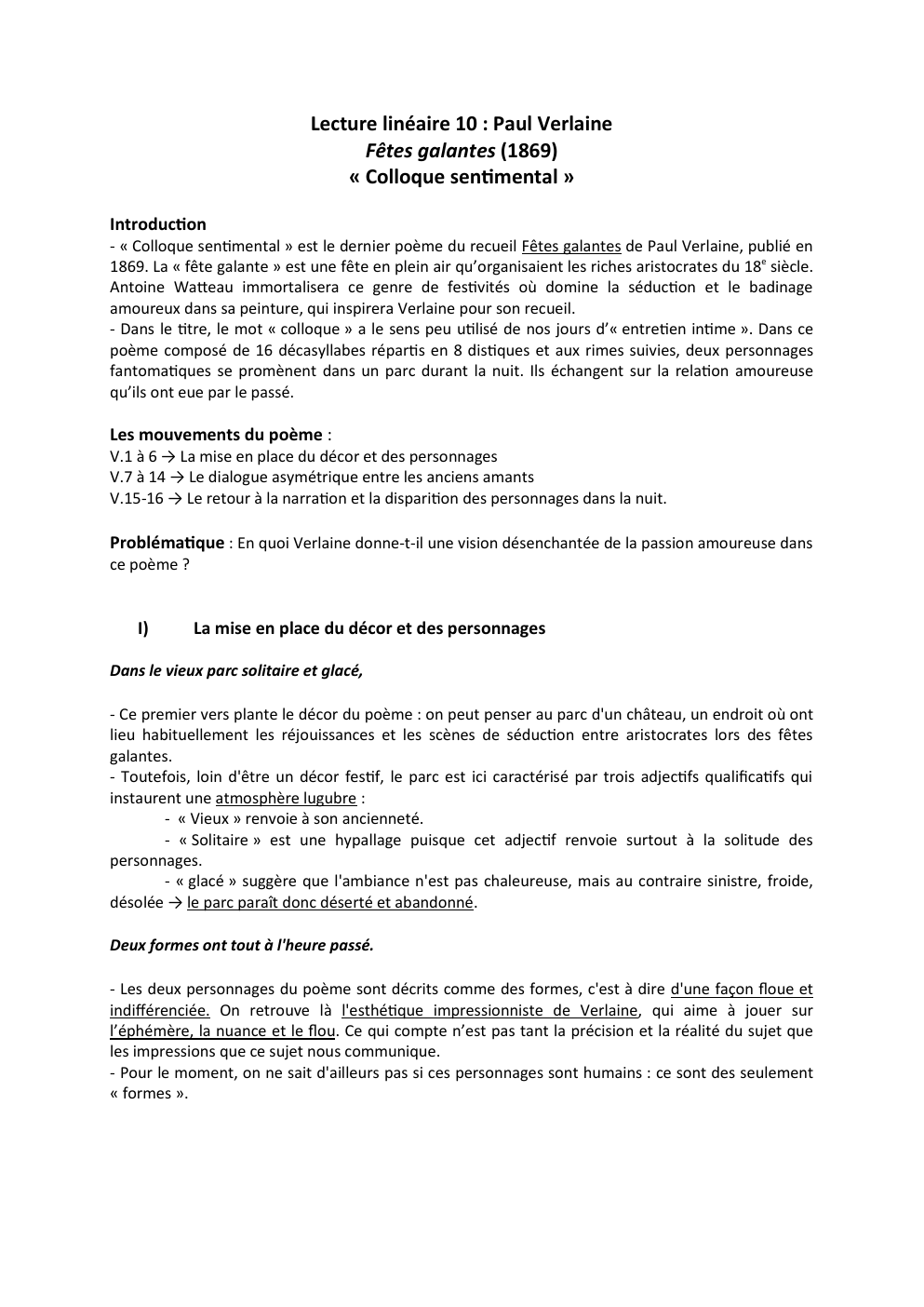Lecture linéaire 10 : Paul Verlaine Fêtes galantes (1869) « Colloque sen mental »
Publié le 21/06/2024
Extrait du document
«
Lecture linéaire 10 : Paul Verlaine
Fêtes galantes (1869)
« Colloque sen mental »
Introduc on
- « Colloque sen mental » est le dernier poème du recueil Fêtes galantes de Paul Verlaine, publié en
1869.
La « fête galante » est une fête en plein air qu’organisaient les riches aristocrates du 18e siècle.
Antoine Wa eau immortalisera ce genre de fes vités où domine la séduc on et le badinage
amoureux dans sa peinture, qui inspirera Verlaine pour son recueil.
- Dans le tre, le mot « colloque » a le sens peu u lisé de nos jours d’« entre en in me ».
Dans ce
poème composé de 16 décasyllabes répar s en 8 dis ques et aux rimes suivies, deux personnages
fantoma ques se promènent dans un parc durant la nuit.
Ils échangent sur la rela on amoureuse
qu’ils ont eue par le passé.
Les mouvements du poème :
V.1 à 6 → La mise en place du décor et des personnages
V.7 à 14 → Le dialogue asymétrique entre les anciens amants
V.15-16 → Le retour à la narra on et la dispari on des personnages dans la nuit.
Probléma que : En quoi Verlaine donne-t-il une vision désenchantée de la passion amoureuse dans
ce poème ?
I)
La mise en place du décor et des personnages
Dans le vieux parc solitaire et glacé,
- Ce premier vers plante le décor du poème : on peut penser au parc d'un château, un endroit où ont
lieu habituellement les réjouissances et les scènes de séduc on entre aristocrates lors des fêtes
galantes.
- Toutefois, loin d'être un décor fes f, le parc est ici caractérisé par trois adjec fs qualifica fs qui
instaurent une atmosphère lugubre :
- « Vieux » renvoie à son ancienneté.
- « Solitaire » est une hypallage puisque cet adjec f renvoie surtout à la solitude des
personnages.
- « glacé » suggère que l'ambiance n'est pas chaleureuse, mais au contraire sinistre, froide,
désolée → le parc paraît donc déserté et abandonné.
Deux formes ont tout à l'heure passé.
- Les deux personnages du poème sont décrits comme des formes, c'est à dire d'une façon floue et
indifférenciée.
On retrouve là l'esthé que impressionniste de Verlaine, qui aime à jouer sur
l’éphémère, la nuance et le flou.
Ce qui compte n’est pas tant la précision et la réalité du sujet que
les impressions que ce sujet nous communique.
- Pour le moment, on ne sait d'ailleurs pas si ces personnages sont humains : ce sont des seulement
« formes ».
(Pour votre culture :)
IMPRESSIONNISME : mouvement pictural né de l'associa on d'ar stes de la seconde moi é du 19ÈME
siècle vivant en France.
Fortement cri qué à ses débuts, ce mouvement se manifeste notamment de 1874 à
1886 par des exposi ons publiques à Paris, et marqua la rupture de l'art moderne avec la peinture
académique (on peint notamment au-dehors plutôt que dans un atelier).
Caractéris ques :
- une tendance à noter les impressions fugi ves, la mobilité des phénomènes clima ques et lumineux,
plutôt que l'aspect stable des choses.
- des traits de pinceau visibles - l'u lisa on d'angles de vue inhabituels - des tableaux de pe t format
Claude Monet, Impression, soleil levant (1872)
Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,
- Ce troisième vers est construit sur un parallélisme de construc on et un jeu de répé on sur les
sonorités puisque les deux adjec fs « morts » et « molles » sont proches phoné quement.
Ils
renvoient à l'idée de vieillesse et de mort présente dans le premier vers, appliquée au décor.
Les
yeux « morts » suggèrent un regard inquiétant, sans lueur de vie.
Les lèvres « molles » suggèrent les
chairs qui s’affaissent, la décrépitude.
→ la descrip on physique des personnages se limitent à ces deux détails physiques (les yeux et la
bouche), sans dis nc on entre les deux.
Encore l’esthé que impressionniste propre à Verlaine.
Et l’on entend à peine leurs paroles.
- Pourquoi entend-on à peine leur parole ? Est-ce parce qu'ils sont morts ? Ou parce que l'âge les fait
parler d'une toute pe te voix chevrotante ? Ou parce que dans ce parc solitaire et glacé, le vent
souffle et couvre leur voix ? (ce qui pourrait être suggéré dans le tout dernier vers du poème.)
Dans le vieux parc solitaire et glacé,
Deux spectres ont évoqué le passé.
- Ces deux vers sont la répé on légèrement modifiée des deux premiers.
On insiste sur l’aspect
lugubre du décor et la répé on donne une impression de monotonie, comme d’une errance
con nue des deux spectres.
- Les formes sont décrites comme des « spectres » : ce mot est-il à prendre dans son sens li éral ou
figuré ? Les deux êtres sont-ils des fantômes ou sont-ils simplement âgés et pâles au point de
ressembler à des fantômes ? Quoiqu’il en soit, l’atmosphère du poème est résolument fantas que.
- Etymologiquement, « évoquer » vient du la n evocare : du préfixe e- (ex- = en dehors) et
de vocare (« appeler »), de vox (« voix »).
C’est comme si les deux spectres, par la parole, tentaient
de ranimer un passé lointain, mort.
II)
Le dialogue asymétrique entre les anciens amants
- Te souvient-il de notre extase ancienne ?
- Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne ?
- C’est un début du dialogue au style direct qui va s’étendre sur 8 vers (même propor on de dialogue
et de narra on).
Ce dialogue sans incise donne l’impression d’un pe t dialogue de théâtre à
l’intérieur même du poème.
- Comme ce dialogue ne con ent aucune incise, nous n’avons aucun indice sur l’iden té des
interlocuteurs.
Qui est l’homme, qui est la femme ? S’agit-il d’ailleurs d’un couple composé d’un
homme et d’une femme ? Impossible de le savoir : nous sommes dans le flou complet (l’esthé que
impressionniste de Verlaine).
- Dans ce dialogue, nous avons une asymétrie entre les deux personnages qui s'adressent l'un à
l'autre de façon opposée.
L'un, au ton enthousiaste, lyrique, exprime une nostalgie pour une époque
heureuse passée.
Et l'autre, au ton glacial, se refuse à réac ver ce sen ment amoureux.
- Le premier personnage tutoie le second, ce qui marque une rela on de proximité et de
rapprochement, alors que le second le vouvoie, ce qui marque une volonté de maintenir ses
distances.
- Le premier personnage sollicite le second afin de replonger dans un passé lointain (« ancienne ») et
très heureux (« extase »).
Mais le second personnage répond à la ques on posée par une autre
ques on, une ques on rhétorique (puisqu’il s’agit d’une affirma on déguisée).....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les Fêtes galantes de Paul Verlaine
- L'oeuvre de Verlaine POÉSIEPOÈMES SATURNIENS (1866)FÊTES GALANTES (1869)LA BONNE CHANSON (1870)ROMANCES
- Lecture Linéaire, Notre Vie de Paul ÉLUARD
- Lecture linéaire: Nevermore, Verlaine
- lecture analytique paul verlaine