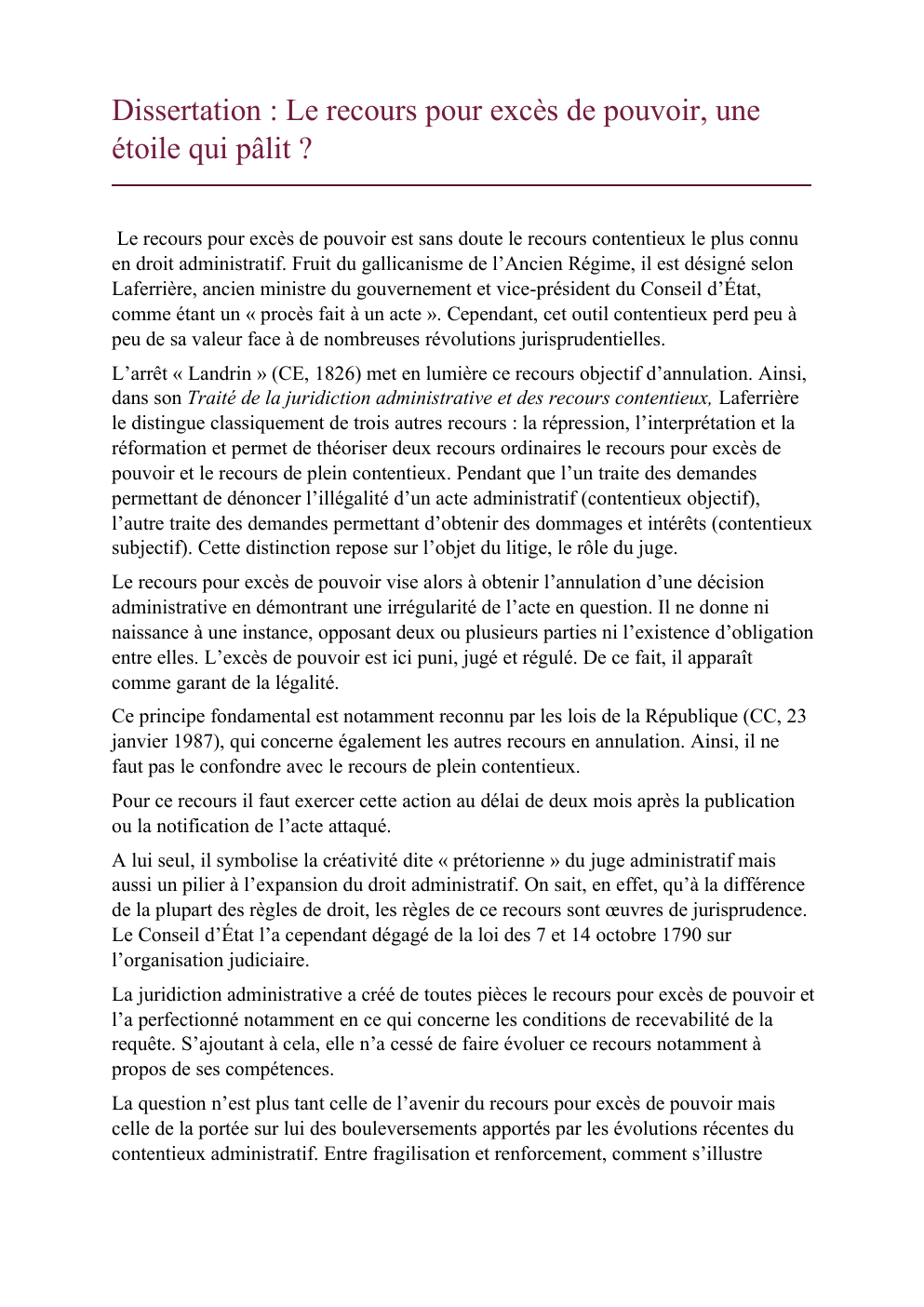Le recours pour excès de pouvoir, une espèce en voie de disparition ?
Publié le 13/10/2022

Extrait du document
«
Dissertation : Le recours pour excès de pouvoir, une
étoile qui pâlit ?
Le recours pour excès de pouvoir est sans doute le recours contentieux le plus connu
en droit administratif.
Fruit du gallicanisme de l’Ancien Régime, il est désigné selon
Laferrière, ancien ministre du gouvernement et vice-président du Conseil d’État,
comme étant un « procès fait à un acte ».
Cependant, cet outil contentieux perd peu à
peu de sa valeur face à de nombreuses révolutions jurisprudentielles.
L’arrêt « Landrin » (CE, 1826) met en lumière ce recours objectif d’annulation.
Ainsi,
dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Laferrière
le distingue classiquement de trois autres recours : la répression, l’interprétation et la
réformation et permet de théoriser deux recours ordinaires le recours pour excès de
pouvoir et le recours de plein contentieux.
Pendant que l’un traite des demandes
permettant de dénoncer l’illégalité d’un acte administratif (contentieux objectif),
l’autre traite des demandes permettant d’obtenir des dommages et intérêts (contentieux
subjectif).
Cette distinction repose sur l’objet du litige, le rôle du juge.
Le recours pour excès de pouvoir vise alors à obtenir l’annulation d’une décision
administrative en démontrant une irrégularité de l’acte en question.
Il ne donne ni
naissance à une instance, opposant deux ou plusieurs parties ni l’existence d’obligation
entre elles.
L’excès de pouvoir est ici puni, jugé et régulé.
De ce fait, il apparaît
comme garant de la légalité.
Ce principe fondamental est notamment reconnu par les lois de la République (CC, 23
janvier 1987), qui concerne également les autres recours en annulation.
Ainsi, il ne
faut pas le confondre avec le recours de plein contentieux.
Pour ce recours il faut exercer cette action au délai de deux mois après la publication
ou la notification de l’acte attaqué.
A lui seul, il symbolise la créativité dite « prétorienne » du juge administratif mais
aussi un pilier à l’expansion du droit administratif.
On sait, en effet, qu’à la différence
de la plupart des règles de droit, les règles de ce recours sont œuvres de jurisprudence.
Le Conseil d’État l’a cependant dégagé de la loi des 7 et 14 octobre 1790 sur
l’organisation judiciaire.
La juridiction administrative a créé de toutes pièces le recours pour excès de pouvoir et
l’a perfectionné notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité de la
requête.
S’ajoutant à cela, elle n’a cessé de faire évoluer ce recours notamment à
propos de ses compétences.
La question n’est plus tant celle de l’avenir du recours pour excès de pouvoir mais
celle de la portée sur lui des bouleversements apportés par les évolutions récentes du
contentieux administratif.
Entre fragilisation et renforcement, comment s’illustre
l’évolution de ce recours ? Quelle place occupe-t-il aujourd’hui ? Finalement, peut-on
parler d’un recours pour excès de pouvoir en voie de disparition ?
Au gré de nombreuses évolutions, le recours pour excès de pouvoir n’a cessé d’être
renforcer (I).
Cependant, de nos jours, son statut est sujet de plusieurs controverses ne
cessant de fragiliser son existence (II).
I)
Un recours pour excès de pouvoir renforcé par des mutations jurisprudentielles.
Le recours pour excès de pouvoir s’est vu renforcé son pouvoir par l’évolution, d’une
part de l’objet (A) mais aussi par ses conditions (B).
A) Des évolutions garantissant l’objet même du recours objectif d’annulation.
L’objet du recours pour excès de pouvoir est relativement étroit.
On ne pourrait
penser une évolution concrète, révolutionnaire et pourtant.
Son objet étant l’annulation
d’un acte administratif, il doit permettre de garantir l’efficacité de la justice
administrative et du caractère démocratique de l’accès à ce recours.
Ces caractères sont
fondamentaux pour en justice administrative, le législateur ne pouvait que renforcer ce
recours.
L’ensemble de ces rôles l’illustre, comme étant garant de légalité.
En ce statut, le juge
administratif, lors d’un recours d’annulation, doit vérifier que l’acte respecte les
normes qui lui sont supérieures (constitution, loi, ordonnance) mais aussi que l’acte
n’illustre pas une forme d’excès, d’illégalité au regard de la loi.
Ce principe constitue
la base du droit, plus précisément du droit administratif.
En effet, la juridiction
administrative offre aux administrés des moyens pour contrôler l’administration.
Ainsi, la loi du 8 février 1995 illustre le souhait de réformation du législateur au sujet
de l’objet même du recours, passant d’une annulation rétroactive des actes illégaux à
une compétence plus élargie.
Le recours pour excès de pouvoir se voit accorder plus
d’efficacité, le juge pouvant désormais doubler son annulation par une injonction
adressée à l’administration.
L’autre objet principal du recours pour excès de pouvoir est d’annuler un acte
administratif.
Cela correspond à disparaitre l’acte de manière rétroactive.
C’est-à-dire
que par l’annulation d’un acte administratif, son existence ne va ni exister ni dans le
passé, ni dans le présent, ni dans le futur.
En effet, l’acte étant illégal dès le départ doit
être supprimé dès le départ.
Le problème est qu’en pratique, il est parfois difficile
d’effacer les effets produits de l’acte.
La décision du “RODIERE” (CE, 26 décembre
1925) affirme que l’annulation par le juge d’un acte possède comme conséquence la
disparition rétroactive mais également les effets juridiques, produit par celui-ci.
Ici, il
était sujet plus précisément de l’annulation de la révocation d’un fonctionnaire,
désirant la reconstitution de sa carrière et sa réintégration.
Face à cela et au vide
2
juridique que cette décision risquait de poser, la décision du “Association AC !” (CE,
11 mai 2004) est venue porter une exception.
Si les conséquences d’une annulation
rétroactives sont une manifestation excessive alors le juge administratif peut moduler
dans le temps l’annulation qu’il prononce.
Si le juge se rend compte que l’annulation
est de nature d’avoir quantitatives, ce dernier peut choisir la date de sa décision.
S’inspirant de ses décisions de QCP, le Conseil d’État étendra cette jurisprudence
acceptant la modulation des décisions juridictionnelles aux changements de
jurisprudence (CE, 7 octobre 2009, « Sté d’équipement de Tahiti et des Iles).
Apportant des nombreuses modifications au sujet de l’objet même du recours pour
excès de pouvoir, le législateur ne s’est pas arrêté là.
Il n’a cessé de renforcer les
conditions de ce dernier.
La place du recours pour excès de pouvoir ne semble pour
l’instant que s’affirmer.
B) Des évolutions garantissant de nouvelles conditions du « procès fait à un acte ».
Pour qu’un recours soit recevable, ce dernier doit respecter certaines conditions.
Si
une de ces dernières n’est pas respectée, le recours est irrecevable.
Que ce soit par
rapport aux délais, l’intérêt à agir des requérants ou encore la nature de l’acte, le
recours pour excès de pouvoir tend à s’éloigner de ses conditions par de nombreuses
modifications.
L’article 24 paragraphe 4 de la loi du 13 avril 1900, a réduit à deux mois le délai des
recours porté devant le Conseil d’État, qui était auparavant fixé à trois mois par
l’article 11 du décret du 22 juillet 1806.
Se trouvant désormais à l’article R-421-2 du
code de justice administrative, ce délai bref permet de prendre le temps pour le
justiciable, d’être certain d’une sécurité juridique et que l’acte soit bien tangible.
De
plus, une distinction se pose, afin de comprendre à partir de quand ce délai débute,
entre les acte administratif réglementaires (à partir de la publication dans les recueils
officiels) et individuels (à partir de la notification de la décision à la personne
intéressée).
L’arrêt “CZABAJ” (CE, ass, 13 juillet 2016) affirme qu’il serait possible
de contester l’acte administratif confirmé dans un délai d’un an, après la décision
prise.
En effet, un problème se posait quant à la durée beaucoup trop longue.
Ainsi, un
certain équilibre entre sécurité juridique et légalité était recherché par le législateur.
L’intérêt à agir en justice n’est pas la capacité à agir mais bien de disposer d’un intérêt.
Le juge va vérifier ce critère, l’étudier seulement si le recours pour excès de pouvoir se
pose au sujet du recours.
Cette deuxième condition de recevabilité a aussi fait part
d’évolution.
La jurisprudence est marquée par deux points : le Casuistique ( le juge
examine si le requérant possède un intérêt à agir, il n’a pas d’intérêt universel) et le
libéralisme (le juge est plutôt libéral, il ouvre facilement sa porte et admet l’intérêt à
agir des requérants).
Le Conseil d’État n'a cessé de faire évoluer cette condition,
notamment avec la décision “Casanova” (CE, 29 mars 1901).
Il reconnaît qu’un
3
habitant d’une commune à l’intérêt à agir à l’encontre des décisions du maire mais
aussi de la commune, dès lors que ces décisions augmentent les dépenses de la
municipalité.
Dans sa décision “LOT” (CE, 11 décembre 1903), le Conseil d’État
vient montrer que l’intérêt peut être indirect.
Dans une autre décision, “Syndicat des
patrons coiffeurs de Limoges” (CE, 26 décembre1906), la juridiction reconnaît que des
personnes morales peuvent former un REP et donc remplir les conditions d’intérêt à
agir.
Il est même plus précis, il reconnaît aux personnes morales deux types d’actions :
la personne morale peut agir si ses intérêts sont perturbés mais elle peut aussi avoir un
intérêt à agir si elle défend les intérêts de ses membres.
Une personne morale....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EFFET DES ANNULATIONS CONTENTIEUSES C. E. 26 déc. 1925, RODIÈRE, Rec. 1065
- RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR INTÉRÊT POUR AGIR C. E. 11 déc. 1903, LOT, Rec. 780 (S. 1904.3.113, note Hauriou)
- Le recours en excès de pouvoir
- RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ET RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - C. E. 8 mars 1912, LAFAGE, Rec. 348, concl. Pichat (commentaire d'arrêt)
- espèce en voie de disparition: Extinct species: We must do something !