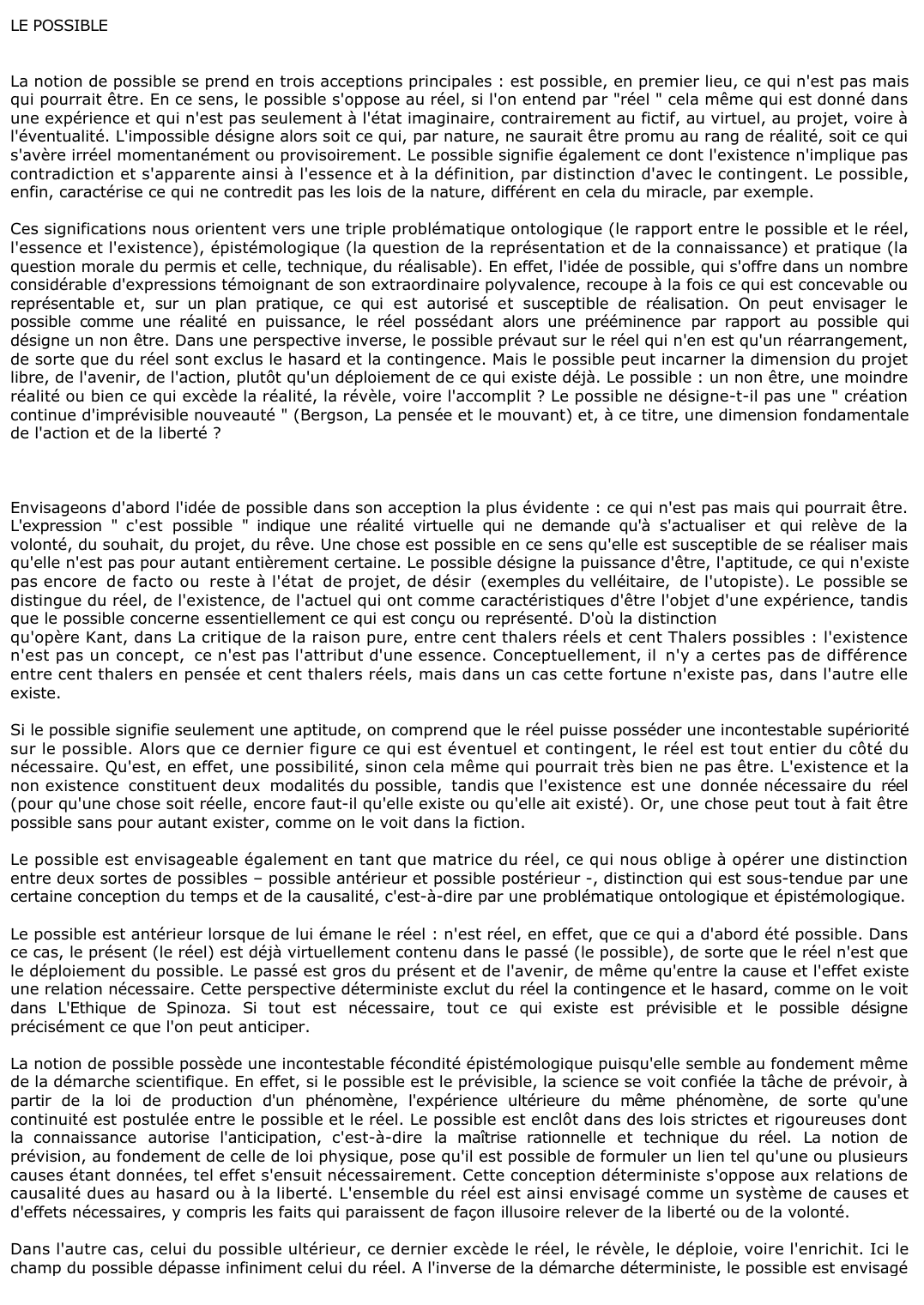LE POSSIBLE
Publié le 15/05/2020
Extrait du document
«
LE POSSIBLE
La notion de possible se prend en trois acceptions principales : est possible, en premier lieu, ce qui n'est pas maisqui pourrait être.
En ce sens, le possible s'oppose au réel, si l'on entend par "réel " cela même qui est donné dansune expérience et qui n'est pas seulement à l'état imaginaire, contrairement au fictif, au virtuel, au projet, voire àl'éventualité.
L'impossible désigne alors soit ce qui, par nature, ne saurait être promu au rang de réalité, soit ce quis'avère irréel momentanément ou provisoirement.
Le possible signifie également ce dont l'existence n'implique pascontradiction et s'apparente ainsi à l'essence et à la définition, par distinction d'avec le contingent.
Le possible,enfin, caractérise ce qui ne contredit pas les lois de la nature, différent en cela du miracle, par exemple.
Ces significations nous orientent vers une triple problématique ontologique (le rapport entre le possible et le réel,l'essence et l'existence), épistémologique (la question de la représentation et de la connaissance) et pratique (laquestion morale du permis et celle, technique, du réalisable).
En effet, l'idée de possible, qui s'offre dans un nombreconsidérable d'expressions témoignant de son extraordinaire polyvalence, recoupe à la fois ce qui est concevable oureprésentable et, sur un plan pratique, ce qui est autorisé et susceptible de réalisation.
On peut envisager lepossible comme une réalité en puissance, le réel possédant alors une prééminence par rapport au possible quidésigne un non être.
Dans une perspective inverse, le possible prévaut sur le réel qui n'en est qu'un réarrangement,de sorte que du réel sont exclus le hasard et la contingence.
Mais le possible peut incarner la dimension du projetlibre, de l'avenir, de l'action, plutôt qu'un déploiement de ce qui existe déjà.
Le possible : un non être, une moindreréalité ou bien ce qui excède la réalité, la révèle, voire l'accomplit ? Le possible ne désigne-t-il pas une " créationcontinue d'imprévisible nouveauté " (Bergson, La pensée et le mouvant) et, à ce titre, une dimension fondamentalede l'action et de la liberté ?
Envisageons d'abord l'idée de possible dans son acception la plus évidente : ce qui n'est pas mais qui pourrait être.L'expression " c'est possible " indique une réalité virtuelle qui ne demande qu'à s'actualiser et qui relève de lavolonté, du souhait, du projet, du rêve.
Une chose est possible en ce sens qu'elle est susceptible de se réaliser maisqu'elle n'est pas pour autant entièrement certaine.
Le possible désigne la puissance d'être, l'aptitude, ce qui n'existepas encore de facto ou reste à l'état de projet, de désir (exemples du velléitaire, de l'utopiste).
Le possible sedistingue du réel, de l'existence, de l'actuel qui ont comme caractéristiques d'être l'objet d'une expérience, tandisque le possible concerne essentiellement ce qui est conçu ou représenté.
D'où la distinctionqu'opère Kant, dans La critique de la raison pure, entre cent thalers réels et cent Thalers possibles : l'existencen'est pas un concept, ce n'est pas l'attribut d'une essence.
Conceptuellement, il n'y a certes pas de différenceentre cent thalers en pensée et cent thalers réels, mais dans un cas cette fortune n'existe pas, dans l'autre elleexiste.
Si le possible signifie seulement une aptitude, on comprend que le réel puisse posséder une incontestable supérioritésur le possible.
Alors que ce dernier figure ce qui est éventuel et contingent, le réel est tout entier du côté dunécessaire.
Qu'est, en effet, une possibilité, sinon cela même qui pourrait très bien ne pas être.
L'existence et lanon existence constituent deux modalités du possible, tandis que l'existence est une donnée nécessaire du réel(pour qu'une chose soit réelle, encore faut-il qu'elle existe ou qu'elle ait existé).
Or, une chose peut tout à fait êtrepossible sans pour autant exister, comme on le voit dans la fiction.
Le possible est envisageable également en tant que matrice du réel, ce qui nous oblige à opérer une distinctionentre deux sortes de possibles – possible antérieur et possible postérieur -, distinction qui est sous-tendue par unecertaine conception du temps et de la causalité, c'est-à-dire par une problématique ontologique et épistémologique.
Le possible est antérieur lorsque de lui émane le réel : n'est réel, en effet, que ce qui a d'abord été possible.
Dansce cas, le présent (le réel) est déjà virtuellement contenu dans le passé (le possible), de sorte que le réel n'est quele déploiement du possible.
Le passé est gros du présent et de l'avenir, de même qu'entre la cause et l'effet existeune relation nécessaire.
Cette perspective déterministe exclut du réel la contingence et le hasard, comme on le voitdans L'Ethique de Spinoza.
Si tout est nécessaire, tout ce qui existe est prévisible et le possible désigneprécisément ce que l'on peut anticiper.
La notion de possible possède une incontestable fécondité épistémologique puisqu'elle semble au fondement mêmede la démarche scientifique.
En effet, si le possible est le prévisible, la science se voit confiée la tâche de prévoir, àpartir de la loi de production d'un phénomène, l'expérience ultérieure du même phénomène, de sorte qu'unecontinuité est postulée entre le possible et le réel.
Le possible est enclôt dans des lois strictes et rigoureuses dontla connaissance autorise l'anticipation, c'est-à-dire la maîtrise rationnelle et technique du réel.
La notion deprévision, au fondement de celle de loi physique, pose qu'il est possible de formuler un lien tel qu'une ou plusieurscauses étant données, tel effet s'ensuit nécessairement.
Cette conception déterministe s'oppose aux relations decausalité dues au hasard ou à la liberté.
L'ensemble du réel est ainsi envisagé comme un système de causes etd'effets nécessaires, y compris les faits qui paraissent de façon illusoire relever de la liberté ou de la volonté.
Dans l'autre cas, celui du possible ultérieur, ce dernier excède le réel, le révèle, le déploie, voire l'enrichit.
Ici lechamp du possible dépasse infiniment celui du réel.
A l'inverse de la démarche déterministe, le possible est envisagé.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓