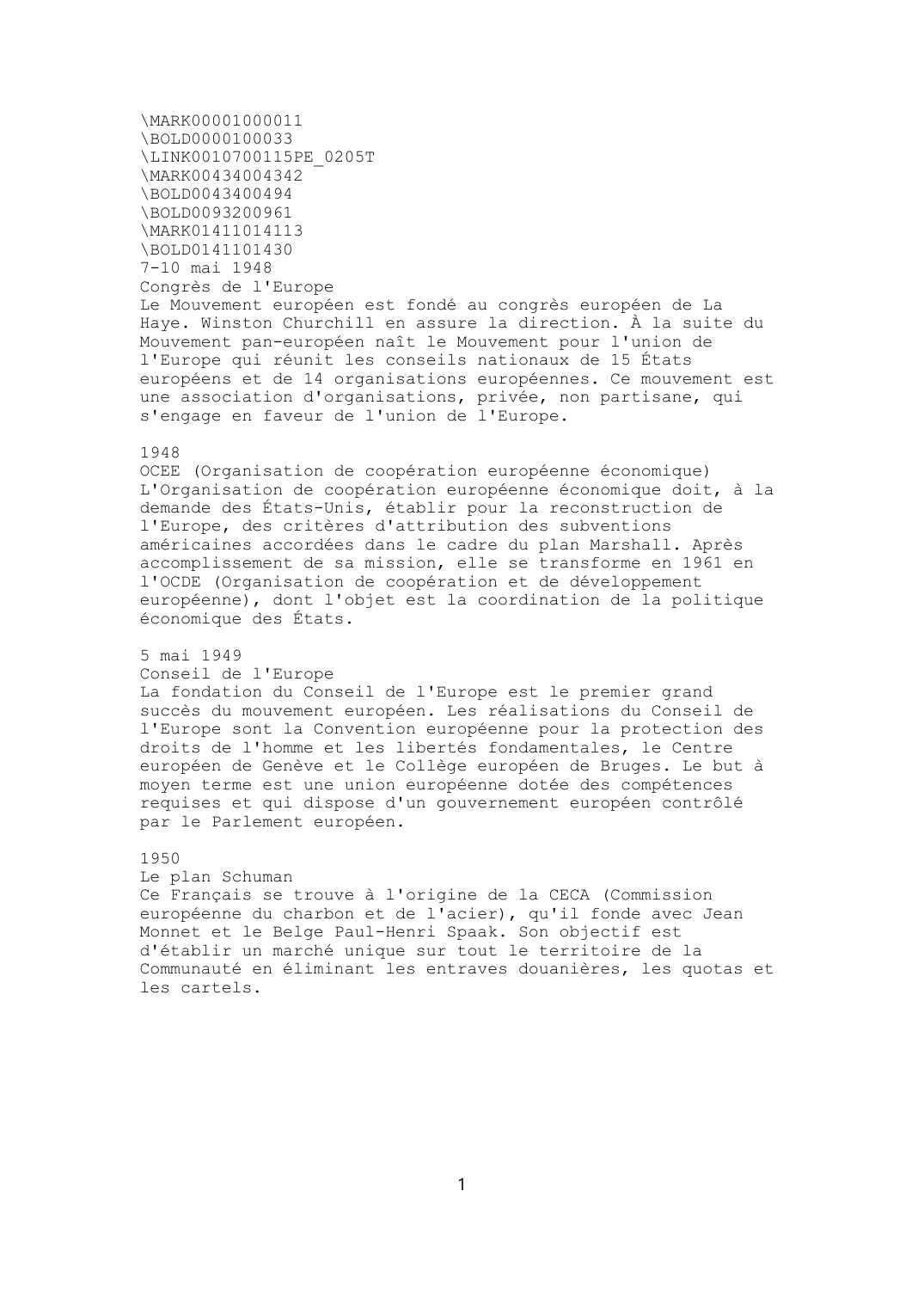Le plan Schuman
Publié le 10/12/2021
Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Le plan Schuman. Ce document contient 1622 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Ressources gratuites
9 mai 1950 - " Ce mercredi 9 mai, à 17 heures, au salon de l'Horloge du Quai d'Orsay, le ministre des affaires étrangères fera une importante déclaration. " Dans la salle pleine à craquer, un homme grand et frêle, de sa voix sourde et avec son accent de l'Est, donne connaissance du document qui va courir immédiatement sur tous les téléphones et les antennes du monde. Robert Schuman était la droiture, la conviction intrépide : il en tirait ce sang-froid dont il avait fait preuve comme président du conseil confronté à une grève générale en 1947. Pour mesurer le sens de ce qui venait de se passer, il faut se reporter à l'époque, que les jeunes d'aujourd'hui ont peine à imaginer. Il y avait à peine cinq ans qu'on était sorti de la plus horrible des guerres. L'Allemagne avait bien un gouvernement, mais il n'avait pas recouvré sa souveraineté. Il avait besoin, en politique étrangère, de l'accord des trois commissaires alliés. La Ruhr était administrée par une autorité internationale dont Alain Poher était le représentant français. La Sarre était placée sous le protectorat de Gilbert Grandval. Une conférence allait se tenir à Londres pour décider du relèvement du niveau accordé à l'Allemagne dans sa production d'acier. Un an avant, dans le jardin de Jean Monnet (1) une rencontre à bâtons rompus, sans instructions, sans ordre du jour, le réunissait, accompagné d'Etienne Hirsch et de moi-même, avec son homologue britannique, Edwin Plowden, qui avait amené Robert Hall, conseiller économique du gouvernement de Sa Majesté. On avait noté, au passage, qu'on en était venu à oublier l'Allemagne. Depuis, l'esprit de Jean Monnet n'avait pas cessé d'être en mouvement. Et puis l'idée s'est fixée un week-end de 1er Mai. Il avait avec lui Etienne Hirsch et Paul Reuter, le juriste. Trois thèmes : les rapports franco-allemands; le charbon et l'acier, choisis pour leur valeur symbolique comme moyens de la guerre et de la paix; l'autorité supranationale. Un premier papier était esquissé. Le lendemain, Monnet m'appelle, me le montre. Je dis : " Cela change tout, tout retombe en place : la souveraineté allemande, la Sarre. " Sur le dessein économique, une mise au point restait nécessaire : la fusion des marchés plus qu'une organisation dirigiste, des conditions assurant par elles-mêmes le niveau de productivité le plus élevé. Je suis chargé de récrire. Bernard Clappier, directeur du cabinet de Robert Schuman, nous rejoint. Il voit immédiatement l'immense perspective ouverte, la gigantesque partie de quitte ou double qui s'offre à son patron. Les modifications jusqu'au neuvième texte, arrêté le samedi 6 mai, ont été limitées. René Mayer fit ajouter l'Afrique; Georges Bidault, président du conseil, demanda le rappel des efforts constants de la France pour une Europe unie : on traduit " l'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre "; le Quai d'Orsay se couvre par l'allusion aux obligations de l'Allemagne, " tant que celles-ci subsisteront ". Le secret avait été bien gardé. Un émissaire envoyé à Adenauer avait obtenu sur-le-champ son adhésion enthousiaste. Dean Acheson passait par Paris pour se rendre à la conférence de Londres : il ne sut pas bien que penser du papier qu'on lui montra en confidence. Le projet aurait pu être un plan Bidault : son directeur de cabinet, qui n'aimait pas Monnet, oublia de lui communiquer le rendez-vous. C'est dans le Monde qu'on lut que le président était censé l'avoir reçu. Deux ministres étaient dans le coup : René Mayer et René Pleven. Le mercredi matin, 9 mai 1950, ils aidaient Robert Schuman à faire adopter le projet par le conseil des ministres. Les acceptations de l'Italie et du Benelux ne tardaient pas. L'urgent était de se rendre à Londres. Monnet y rencontra Stafford Cripps, nous demanda, à Hirsch et à moi, de le rejoindre. Après le refus, Robert Hall me dit : " Hazy fears " (des craintes brumeuses). La conférence pour l'élaboration du traité de la CECA était convoquée pour le 1er juin. Nous préparâmes un document de travail découpé en articles qui ont été suivis, enrichis, complétés par la négociation. Monnet créa un style sans précédent. Pas de traduction, pas de procès-verbal. On ne liait pas l'accord sur un point à l'accord sur un autre : suivant un mot allemand qu'il venait d'apprendre, il n'y avait pas de junctim. Pour comble, vient de me rappeler un ami néerlandais, Hirsch et moi ne craignions pas de discuter devant les autres. Ce n'était pas l'étalage d'un désaccord, c'était, par principe, une recherche ouverte. Les négociateurs les plus expérimentés en étaient désarçonnés : comment pouvaient-ils présenter leur position nationale s'il n'y avait pas de position nationale française ? Nous gagnions, à ce jeu, un exceptionnel crédit. Il n'y avait pas de rencontre entre deux délégations sans qu'un Français y participât. La délégation française tenait le rôle si neuf et si essentiel du catalyseur, elle préfigurait l'Europe. Au beau milieu des pourparlers éclate la malheureuse déclaration de John McCloy, haut commissaire en Allemagne, qui propose la mise sur pied de douze divisions allemandes. C'était le contraire de ce que nous tentions de faire : dans la recherche d'une souveraineté européenne, sauter à pieds joints l'affaire de la souveraineté allemande. Il fallut improviser la riposte : l'idée de la Communauté de défense. L'équipe qui en prépara le traité copia où elles n'avaient rien à faire les dispositions que nous élaborions pour le charbon et l'acier. Quand Paul Van Zeeland refusa un budget commun authentique en le réduisant à la somme des contributions décidées par chaque Parlement, quand toute décision du commissariat était soumise à des avis conformes du conseil pris à l'unanimité, je pensai qu'on cumulait les inconvénients : braquer les phares sur une autorité supranationale mais qui serait totalement démunie de pouvoirs. Lors des travaux préparatoires du traité de la CECA, Hirsch avait dirigé une grande part des discussions économiques et techniques, le conseiller d'Etat Maurice Lagrange prenait charge des aspects juridiques, moi plus particulièrement des affaires sociales et commerciales. Mais tout le monde touchait à tout. Notre conférence s'interrompit pour que la délégation française rédigeât un projet complet; elle fournit aussi un mémorandum sur la période transitoire : il se traduisit aisément en convention. Un comité de lecture, où j'étais aux côtés de Lagrange, se chargea des questions encore non résolues, acheva la mise au point des textes et, si mes souvenirs sont bons, accepta sans en changer un mot la convention sur les dispositions transitoires. Il restait aux ministres à fixer le siège : ce faillit être le drame. Finalement Joseph Bech, par sa bonhomie et son habileté, obtint que la Communauté s'installe à Luxembourg, la France gardant le Parlement pour Strasbourg. Quand Jean Monnet, le 10 août 1952, inaugura sa présidence, c'était la petite poignée des principaux négociateurs qui se mit immédiatement au travail. Il faudra raconter quelque jour ce que furent ces premiers mois de labeur incessant, et à quel rythme, pour mettre les institutions en place, entrer en contact avec les industries et gouvernements, accomplir toutes les tâches préalables à l'ouverture successive du Marché commun pour le charbon et pour l'acier. Le même esprit régnait que pendant la négociation : les difficultés de chaque pays étaient considérées comme des difficultés communes à résoudre en commun. Car la coopération, au sens de l'organisation européenne à laquelle le plan Marshall avait donné naissance, ne suffisait pas : elle était ou le blocage, ou le compromis boiteux, ou l'accord forcé par la puissance extérieure, l'Amérique qui détenait l'argent. A l'Europe de trouver dans son nouveau style de travail son fédérateur interne. Des institutions, mais pour des tâches concrètes, et pour écarter le mal suprême : l'esprit de domination, qui avilit autant celui qui domine que celui qui est dominé. Et cette conception neuve de ce que Jacques Rueff a appelé un marché institutionnel, c'est-à-dire la libre initiative, mais entourée des conditions qui l'assortissent aux circonstances de notre temps. En particulier cette grande invention qu'était la réadaptation, pour mettre la main-d'oeuvre à l'abri des charges et des risques du progrès, pour que tout changement d'emploi fût une chance de promotion. Le général de Gaulle, dans sa retraite, crut pouvoir se gausser de ce " méli-mélo de charbon et d'acier ", s'attaquer à celui que, sans citer son nom, il désignait comme " l'inspirateur ". Il nous prenait pour des naïfs. Il ne mesurait pas l'extraordinaire autorité dont, dans les négociations de Paris aussi bien que dans celles du traité de Rome, bénéficiaient les hommes de la France. Que reste-t-il de sa politique du poing sur la table ? L'histoire retiendra que pendant quinze ans a été arrêtée et faillit périr la plus grande et la plus pacifique révolution de notre temps. Quand, après le retour du général au pouvoir, Adenauer, surmontant ses hésitations, le rencontra, il avoua pourtant qu'il avait sous-estimé la portée politique de ce qui avait été accompli. Cette reconnaissance tardive n'empêcha pas le rusé politicien, en proposant un accord franco-allemand, dont rien n'est sorti sauf des réunions périodiques où parfois s'exacerbaient les antagonismes, de proclamer que la réconciliation franco-allemande était son oeuvre. Ceux qui peuvent se souvenir savent bien comment, en quelques jours, la déclaration du 9 mai 1950 avait brusquement changé, et pour toujours, le couple France-Allemagne. Plus généralement, tout le sens de ce qui avait commencé ce jour-là, c'était de changer les relations entre les peuples. Nous avons connu les crises successives. Jean Monnet demeure le plus optimiste : " Ce que nous avons fait est solide; la preuve, c'est que, chaque fois qu'il y a des crises, elles sont surmontées. " Il pense aujourd'hui à une tâche plus vaste encore et plus difficile : bannir l'esprit de domination. Ce devra être aussi changer les relations entre les hommes. PIERRE URI Le Monde du 9 mai 1975
9 mai 1950 - " Ce mercredi 9 mai, à 17 heures, au salon de l'Horloge du Quai d'Orsay, le ministre des affaires étrangères fera une importante déclaration. " Dans la salle pleine à craquer, un homme grand et frêle, de sa voix sourde et avec son accent de l'Est, donne connaissance du document qui va courir immédiatement sur tous les téléphones et les antennes du monde. Robert Schuman était la droiture, la conviction intrépide : il en tirait ce sang-froid dont il avait fait preuve comme président du conseil confronté à une grève générale en 1947. Pour mesurer le sens de ce qui venait de se passer, il faut se reporter à l'époque, que les jeunes d'aujourd'hui ont peine à imaginer. Il y avait à peine cinq ans qu'on était sorti de la plus horrible des guerres. L'Allemagne avait bien un gouvernement, mais il n'avait pas recouvré sa souveraineté. Il avait besoin, en politique étrangère, de l'accord des trois commissaires alliés. La Ruhr était administrée par une autorité internationale dont Alain Poher était le représentant français. La Sarre était placée sous le protectorat de Gilbert Grandval. Une conférence allait se tenir à Londres pour décider du relèvement du niveau accordé à l'Allemagne dans sa production d'acier. Un an avant, dans le jardin de Jean Monnet (1) une rencontre à bâtons rompus, sans instructions, sans ordre du jour, le réunissait, accompagné d'Etienne Hirsch et de moi-même, avec son homologue britannique, Edwin Plowden, qui avait amené Robert Hall, conseiller économique du gouvernement de Sa Majesté. On avait noté, au passage, qu'on en était venu à oublier l'Allemagne. Depuis, l'esprit de Jean Monnet n'avait pas cessé d'être en mouvement. Et puis l'idée s'est fixée un week-end de 1er Mai. Il avait avec lui Etienne Hirsch et Paul Reuter, le juriste. Trois thèmes : les rapports franco-allemands; le charbon et l'acier, choisis pour leur valeur symbolique comme moyens de la guerre et de la paix; l'autorité supranationale. Un premier papier était esquissé. Le lendemain, Monnet m'appelle, me le montre. Je dis : " Cela change tout, tout retombe en place : la souveraineté allemande, la Sarre. " Sur le dessein économique, une mise au point restait nécessaire : la fusion des marchés plus qu'une organisation dirigiste, des conditions assurant par elles-mêmes le niveau de productivité le plus élevé. Je suis chargé de récrire. Bernard Clappier, directeur du cabinet de Robert Schuman, nous rejoint. Il voit immédiatement l'immense perspective ouverte, la gigantesque partie de quitte ou double qui s'offre à son patron. Les modifications jusqu'au neuvième texte, arrêté le samedi 6 mai, ont été limitées. René Mayer fit ajouter l'Afrique; Georges Bidault, président du conseil, demanda le rappel des efforts constants de la France pour une Europe unie : on traduit " l'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre "; le Quai d'Orsay se couvre par l'allusion aux obligations de l'Allemagne, " tant que celles-ci subsisteront ". Le secret avait été bien gardé. Un émissaire envoyé à Adenauer avait obtenu sur-le-champ son adhésion enthousiaste. Dean Acheson passait par Paris pour se rendre à la conférence de Londres : il ne sut pas bien que penser du papier qu'on lui montra en confidence. Le projet aurait pu être un plan Bidault : son directeur de cabinet, qui n'aimait pas Monnet, oublia de lui communiquer le rendez-vous. C'est dans le Monde qu'on lut que le président était censé l'avoir reçu. Deux ministres étaient dans le coup : René Mayer et René Pleven. Le mercredi matin, 9 mai 1950, ils aidaient Robert Schuman à faire adopter le projet par le conseil des ministres. Les acceptations de l'Italie et du Benelux ne tardaient pas. L'urgent était de se rendre à Londres. Monnet y rencontra Stafford Cripps, nous demanda, à Hirsch et à moi, de le rejoindre. Après le refus, Robert Hall me dit : " Hazy fears " (des craintes brumeuses). La conférence pour l'élaboration du traité de la CECA était convoquée pour le 1er juin. Nous préparâmes un document de travail découpé en articles qui ont été suivis, enrichis, complétés par la négociation. Monnet créa un style sans précédent. Pas de traduction, pas de procès-verbal. On ne liait pas l'accord sur un point à l'accord sur un autre : suivant un mot allemand qu'il venait d'apprendre, il n'y avait pas de junctim. Pour comble, vient de me rappeler un ami néerlandais, Hirsch et moi ne craignions pas de discuter devant les autres. Ce n'était pas l'étalage d'un désaccord, c'était, par principe, une recherche ouverte. Les négociateurs les plus expérimentés en étaient désarçonnés : comment pouvaient-ils présenter leur position nationale s'il n'y avait pas de position nationale française ? Nous gagnions, à ce jeu, un exceptionnel crédit. Il n'y avait pas de rencontre entre deux délégations sans qu'un Français y participât. La délégation française tenait le rôle si neuf et si essentiel du catalyseur, elle préfigurait l'Europe. Au beau milieu des pourparlers éclate la malheureuse déclaration de John McCloy, haut commissaire en Allemagne, qui propose la mise sur pied de douze divisions allemandes. C'était le contraire de ce que nous tentions de faire : dans la recherche d'une souveraineté européenne, sauter à pieds joints l'affaire de la souveraineté allemande. Il fallut improviser la riposte : l'idée de la Communauté de défense. L'équipe qui en prépara le traité copia où elles n'avaient rien à faire les dispositions que nous élaborions pour le charbon et l'acier. Quand Paul Van Zeeland refusa un budget commun authentique en le réduisant à la somme des contributions décidées par chaque Parlement, quand toute décision du commissariat était soumise à des avis conformes du conseil pris à l'unanimité, je pensai qu'on cumulait les inconvénients : braquer les phares sur une autorité supranationale mais qui serait totalement démunie de pouvoirs. Lors des travaux préparatoires du traité de la CECA, Hirsch avait dirigé une grande part des discussions économiques et techniques, le conseiller d'Etat Maurice Lagrange prenait charge des aspects juridiques, moi plus particulièrement des affaires sociales et commerciales. Mais tout le monde touchait à tout. Notre conférence s'interrompit pour que la délégation française rédigeât un projet complet; elle fournit aussi un mémorandum sur la période transitoire : il se traduisit aisément en convention. Un comité de lecture, où j'étais aux côtés de Lagrange, se chargea des questions encore non résolues, acheva la mise au point des textes et, si mes souvenirs sont bons, accepta sans en changer un mot la convention sur les dispositions transitoires. Il restait aux ministres à fixer le siège : ce faillit être le drame. Finalement Joseph Bech, par sa bonhomie et son habileté, obtint que la Communauté s'installe à Luxembourg, la France gardant le Parlement pour Strasbourg. Quand Jean Monnet, le 10 août 1952, inaugura sa présidence, c'était la petite poignée des principaux négociateurs qui se mit immédiatement au travail. Il faudra raconter quelque jour ce que furent ces premiers mois de labeur incessant, et à quel rythme, pour mettre les institutions en place, entrer en contact avec les industries et gouvernements, accomplir toutes les tâches préalables à l'ouverture successive du Marché commun pour le charbon et pour l'acier. Le même esprit régnait que pendant la négociation : les difficultés de chaque pays étaient considérées comme des difficultés communes à résoudre en commun. Car la coopération, au sens de l'organisation européenne à laquelle le plan Marshall avait donné naissance, ne suffisait pas : elle était ou le blocage, ou le compromis boiteux, ou l'accord forcé par la puissance extérieure, l'Amérique qui détenait l'argent. A l'Europe de trouver dans son nouveau style de travail son fédérateur interne. Des institutions, mais pour des tâches concrètes, et pour écarter le mal suprême : l'esprit de domination, qui avilit autant celui qui domine que celui qui est dominé. Et cette conception neuve de ce que Jacques Rueff a appelé un marché institutionnel, c'est-à-dire la libre initiative, mais entourée des conditions qui l'assortissent aux circonstances de notre temps. En particulier cette grande invention qu'était la réadaptation, pour mettre la main-d'oeuvre à l'abri des charges et des risques du progrès, pour que tout changement d'emploi fût une chance de promotion. Le général de Gaulle, dans sa retraite, crut pouvoir se gausser de ce " méli-mélo de charbon et d'acier ", s'attaquer à celui que, sans citer son nom, il désignait comme " l'inspirateur ". Il nous prenait pour des naïfs. Il ne mesurait pas l'extraordinaire autorité dont, dans les négociations de Paris aussi bien que dans celles du traité de Rome, bénéficiaient les hommes de la France. Que reste-t-il de sa politique du poing sur la table ? L'histoire retiendra que pendant quinze ans a été arrêtée et faillit périr la plus grande et la plus pacifique révolution de notre temps. Quand, après le retour du général au pouvoir, Adenauer, surmontant ses hésitations, le rencontra, il avoua pourtant qu'il avait sous-estimé la portée politique de ce qui avait été accompli. Cette reconnaissance tardive n'empêcha pas le rusé politicien, en proposant un accord franco-allemand, dont rien n'est sorti sauf des réunions périodiques où parfois s'exacerbaient les antagonismes, de proclamer que la réconciliation franco-allemande était son oeuvre. Ceux qui peuvent se souvenir savent bien comment, en quelques jours, la déclaration du 9 mai 1950 avait brusquement changé, et pour toujours, le couple France-Allemagne. Plus généralement, tout le sens de ce qui avait commencé ce jour-là, c'était de changer les relations entre les peuples. Nous avons connu les crises successives. Jean Monnet demeure le plus optimiste : " Ce que nous avons fait est solide; la preuve, c'est que, chaque fois qu'il y a des crises, elles sont surmontées. " Il pense aujourd'hui à une tâche plus vaste encore et plus difficile : bannir l'esprit de domination. Ce devra être aussi changer les relations entre les hommes. PIERRE URI Le Monde du 9 mai 1975
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le plan Schuman
- Tableau géopolitique du monde en 1913 (plan détaillé)
- En quel sens peut-on dire d'une oeuvre d'art qu'elle est vraie? (plan)
- Plan détaillé du commentaire acte II scène 4 de Lucrèce Borgia
- Philosophie dissert sur la vérité et science - DM : Ce qui est vrai est-il toujours vérifiable ? (plan)