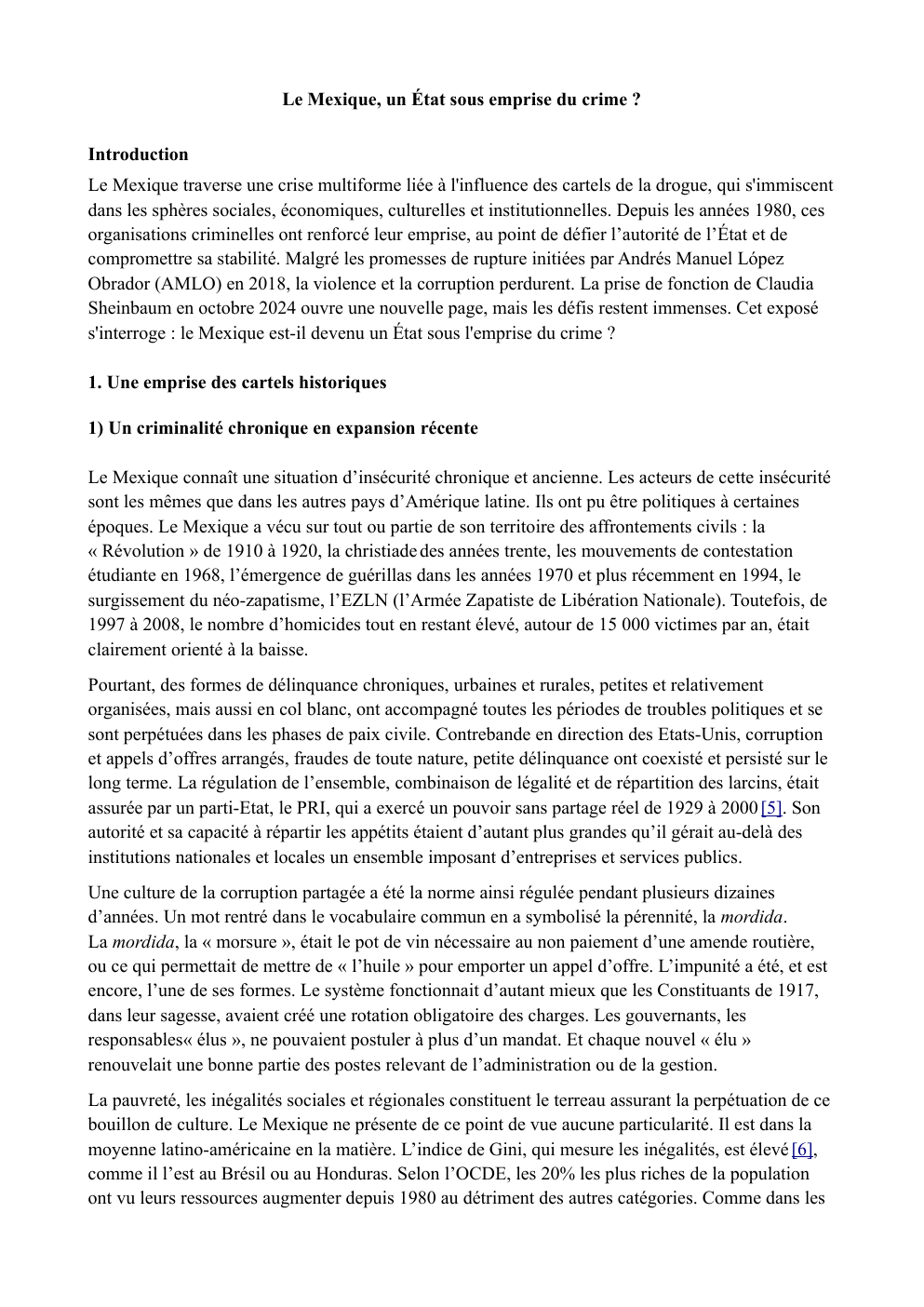Le Mexique, un État sous emprise du crime ?
Publié le 05/01/2025
Extrait du document
«
Le Mexique, un État sous emprise du crime ?
Introduction
Le Mexique traverse une crise multiforme liée à l'influence des cartels de la drogue, qui s'immiscent
dans les sphères sociales, économiques, culturelles et institutionnelles.
Depuis les années 1980, ces
organisations criminelles ont renforcé leur emprise, au point de défier l’autorité de l’État et de
compromettre sa stabilité.
Malgré les promesses de rupture initiées par Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) en 2018, la violence et la corruption perdurent.
La prise de fonction de Claudia
Sheinbaum en octobre 2024 ouvre une nouvelle page, mais les défis restent immenses.
Cet exposé
s'interroge : le Mexique est-il devenu un État sous l'emprise du crime ?
1.
Une emprise des cartels historiques
1) Un criminalité chronique en expansion récente
Le Mexique connaît une situation d’insécurité chronique et ancienne.
Les acteurs de cette insécurité
sont les mêmes que dans les autres pays d’Amérique latine.
Ils ont pu être politiques à certaines
époques.
Le Mexique a vécu sur tout ou partie de son territoire des affrontements civils : la
« Révolution » de 1910 à 1920, la christiade des années trente, les mouvements de contestation
étudiante en 1968, l’émergence de guérillas dans les années 1970 et plus récemment en 1994, le
surgissement du néo-zapatisme, l’EZLN (l’Armée Zapatiste de Libération Nationale).
Toutefois, de
1997 à 2008, le nombre d’homicides tout en restant élevé, autour de 15 000 victimes par an, était
clairement orienté à la baisse.
Pourtant, des formes de délinquance chroniques, urbaines et rurales, petites et relativement
organisées, mais aussi en col blanc, ont accompagné toutes les périodes de troubles politiques et se
sont perpétuées dans les phases de paix civile.
Contrebande en direction des Etats-Unis, corruption
et appels d’offres arrangés, fraudes de toute nature, petite délinquance ont coexisté et persisté sur le
long terme.
La régulation de l’ensemble, combinaison de légalité et de répartition des larcins, était
assurée par un parti-Etat, le PRI, qui a exercé un pouvoir sans partage réel de 1929 à 2000 [5].
Son
autorité et sa capacité à répartir les appétits étaient d’autant plus grandes qu’il gérait au-delà des
institutions nationales et locales un ensemble imposant d’entreprises et services publics.
Une culture de la corruption partagée a été la norme ainsi régulée pendant plusieurs dizaines
d’années.
Un mot rentré dans le vocabulaire commun en a symbolisé la pérennité, la mordida.
La mordida, la « morsure », était le pot de vin nécessaire au non paiement d’une amende routière,
ou ce qui permettait de mettre de « l’huile » pour emporter un appel d’offre.
L’impunité a été, et est
encore, l’une de ses formes.
Le système fonctionnait d’autant mieux que les Constituants de 1917,
dans leur sagesse, avaient créé une rotation obligatoire des charges.
Les gouvernants, les
responsables« élus », ne pouvaient postuler à plus d’un mandat.
Et chaque nouvel « élu »
renouvelait une bonne partie des postes relevant de l’administration ou de la gestion.
La pauvreté, les inégalités sociales et régionales constituent le terreau assurant la perpétuation de ce
bouillon de culture.
Le Mexique ne présente de ce point de vue aucune particularité.
Il est dans la
moyenne latino-américaine en la matière.
L’indice de Gini, qui mesure les inégalités, est élevé [6],
comme il l’est au Brésil ou au Honduras.
Selon l’OCDE, les 20% les plus riches de la population
ont vu leurs ressources augmenter depuis 1980 au détriment des autres catégories.
Comme dans les
autres pays cette réalité nourrit et facilite les dissidences citoyennes et la délinquance.
L’informalité
criminelle offre aux plus démunis des emplois (passeurs, chauffeurs, petits vendeurs de stupéfiants,
hommes de main, chimistes, gestionnaires blanchissant l’argent de la drogue), des revenus et des
modèles de « réussite » sociale sans commune mesure avec ce que propose le marché du travail
légal.
En 2009, la revue Forbes a signalé que le responsable présumé du cartel de Sinaloa, Joaquín
« El Chapo » Guzmán, aurait une fortune personnelle estimée à 1 milliard de dollars.
Le destin de
ces chefs mafieux fait l’objet d’une vénération populaire cristallisée en chansons,
les narcocorridos et en feuilletons télévisés (ou telenovelas) [7].
Depuis l’alternance électorale de juillet 2000 et l’exercice du pouvoir présidentiel par des
représentants du PAN, à la droite de l’échiquier politique, ces équilibres ont été rompus.
Le pouvoir
politique a été partagé entre le PAN, le PRI et le PRD (Parti de la Révolution Démocratique) [8].
Le
pouvoir central est revenu au PAN, qui a par ailleurs gagné quelques Etats de la fédération
mexicaine.
Le PRD a conquis la mairie du district fédéral, Mexico, et quelques Etats également.
Le
PRI a conservé la gestion de la majorité des Etats.
Cette dilution a été accentuée par les
privatisations d’entreprises publiques réalisées sous la responsabilité des derniers chefs d’Etat
Priistes, Carlos Salinas de Gortari et Ernesto Zedillo.
C’est à la même époque que la demande de stupéfiants sur le marché des Etats-Unis d’abord, puis
ensuite en Europe, a explosé.
La guerre du Vietnam, la contre-culture des années 1968, dans les
pays développés, la résurgence d’une question sociale dans les pays riches après le premier choc
pétrolier, ont en effet créé les conditions d’une consommation massive de narcotiques.
La Colombie
a été la première en mesure de relever ce défi économique en organisant de façon structurée la
production, la transformation et l’acheminement de cocaïne vers les marchés de consommation.
Le
démantèlement des grands cartels colombiens intégrés, les cartels de Cali et Medellin, a donné aux
subalternes mexicains qui jusque-là ne faisaient qu’assurer une partie du transit, un rôle majeur au
milieu des années 1990.
Le début des années 1990 voit ainsi monter en puissance des petits réseaux
de contrebandiers.
Bien qu’ils soient aujourd’hui abusivement qualifiés de « cartels », ce qu’ils ne
sont pas, ils ont acquis une surface et des capacités de nuisance financière et de l’ordre public sans
commune mesure avec les époques antérieures.
L’argent permet d’acheter des fonctionnaires de police et de justice mal payés, ainsi que des
responsables politiques [9].
Les armes permettent d’intimider ou d’éliminer les récalcitrants et
de faire taire la presse d’investigation, activité dans laquelle excelle le Cartel de Sinaloa.
Publié
dans la ville de Ciudad Juarez disputée par les « cartels » de Juarez et Sinaloa, un quotidien local
dont les journalistes sont assassinés et menacés, a, depuis septembre 2010, renoncé à parler de cette
guerre.
Depuis 2000, l’organisme Reporters Sans Frontières rapporte 77 journalistes assassinés et
13 autres disparus, dont plus de la moitié auraient enquêté sur le narcotrafic [10].
L’État de Veracruz
est depuis le début de l’année l’un des plus criminogènes pour les journalistes.
Les principaux cartels de stupéfiants au Mexique (responsables, localisation et zone d’influence)
Source : Sergio Aguayo, El Almanaque Mexicano 2007, Mexique, Aguilar, 2008.
Cette dérive a coïncidé avec la fin du contrôle régulateur exercé par le parti Etat, le PRI, tandis que
l’enjeu financier avait pris une dimension sans commune mesure avec celle des périodes
antérieures.
Depuis ces années-là, la chronique judiciaire est périodiquement alimentée par
l’arrestation de fonctionnaires modestes ou de haut niveau mis en examen pour leurs connivences
avec la délinquance organisée.
Certains acteurs des forces de l’ordre sont même passés de l’autre
côté de la barrière, attirés par des perspectives de gains nettement supérieurs aux salaires versés par
l’Etat mexicain.
Une partie des troupes d’élite, après avoir servi de milice supplétive à divers
« cartels », s’est mise à son compte sous le nom de Zetas.
Le noyau originel des Zetas a été créé par
des policiers issus du corps des GAFES (Grupos Aeromóviles de Fuerzas especiales) formés à
l’Ecole des Amériques, par le GIGN, et le Sayeret Matkaj israélien.
Ils ont été ultérieurement
rejoints pas des militaires de la BFP (Brigada de Fusileros Paracaidistas), constituée pour faire
face à l’EZLN au Chiapas.
Zeta était leur nom de code au sein de la police.
Une guerre sans fin alors a commencé entre groupes mafieux de circonstance, pour contrôler les
points stratégiques du territoire mexicain [11] : la frontière avec les Etats-Unis, lieu de passage des
produits illicites vers le marché de consommation (90% de la cocaïne présente sur le sol américain
proviendrait du Mexique) [12] ; les zones côtières sont le lieu d’arrivée de la cocaïne andine.
50%
des crimes commis en 2010 l’ont été dans les Etats de Chihuahua, Sinaloa et Tamaulipas.
La chute,
arrestation ou extradition vers les Etats-Unis d’un chef mafieux, entraîne très vite une redistribution
brutale et sanglante des cartes, une guerre entre clans pour accaparer le territoire ainsi « libéré ».
Ce
n’est donc pas un hasard si le taux des homicides a littéralement explosé dans les villes frontières
convoitées de Tijuana, Ciudad Juarez et Nuevo Laredo.
Le taux d’homicides à Ciudad Juarez en
2010 a été de 229 pour 100 000 habitants, c’est-à-dire supérieur à celui constaté à Kandahar en
Afghanistan (où il est de 169), selon le Conseil citoyen de la sécurité publique et la justice du
Mexique.
La criminalité est en progression constante.
15 273 personnes ont été tuées dans les
conflits de la drogue en 2010.
Deux fois....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La bête humaine commentaire: Comment, à travers ce récit de scène de crime, Zola fait-il le portrait d’un assassin inhabituel ?
- crime.
- Sierra Léone (2004-2005): Ouverture des procès pour crime contre lhumanité
- Mexique (2003-2004) Paralysie politique
- Mexique (2002-2003) Réformes en suspens