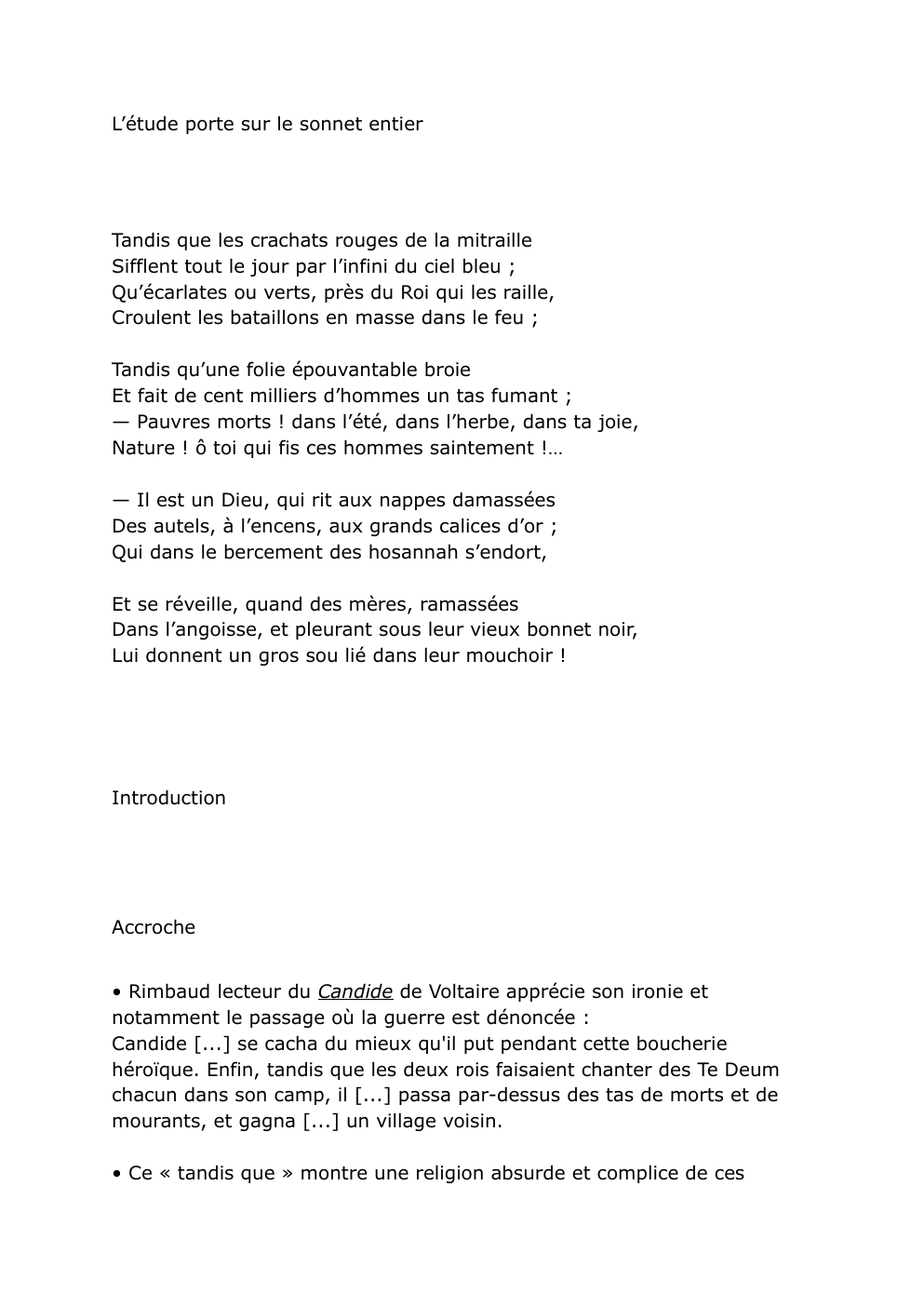le mal analyse analytique
Publié le 27/03/2024
Extrait du document
«
L’étude porte sur le sonnet entier
Tandis que les crachats rouges de la mitraille
Sifflent tout le jour par l’infini du ciel bleu ;
Qu’écarlates ou verts, près du Roi qui les raille,
Croulent les bataillons en masse dans le feu ;
Tandis qu’une folie épouvantable broie
Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant ;
— Pauvres morts ! dans l’été, dans l’herbe, dans ta joie,
Nature ! ô toi qui fis ces hommes saintement !…
— Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées
Des autels, à l’encens, aux grands calices d’or ;
Qui dans le bercement des hosannah s’endort,
Et se réveille, quand des mères, ramassées
Dans l’angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir,
Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir !
Introduction
Accroche
• Rimbaud lecteur du Candide de Voltaire apprécie son ironie et
notamment le passage où la guerre est dénoncée :
Candide [...] se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie
héroïque.
Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum
chacun dans son camp, il [...] passa par-dessus des tas de morts et de
mourants, et gagna [...] un village voisin.
• Ce « tandis que » montre une religion absurde et complice de ces
massacres.
Cela va inspirer à Rimbaud ce poème « Le Mal ».
Situation
• Rimbaud poète engagé, se réapproprie l’adage de Voltaire : « écrasons
l’infâme ».
• Le tableau impressionnant est fait pour marquer et toucher le lecteur.
Dénoncer les rois qui raillent leurs sujets.
• Message universel qui revendique la dignité humaine et la spiritualité
simple et bienfaisante de la Nature.
• La religion au service du pouvoir des Rois fait de Dieu un être infâme et
contre-nature.
C’est cela « Le Mal » pour Rimbaud.
Problématique
Comment ce poème inspiré par Voltaire permet à Rimbaud de dénoncer,
avec des images impressionnantes et émouvantes, les méfaits d’un
pouvoir malfaisant qui dénature la religion ?
Mouvements pour un commentaire linéaire
Poème entier construit sur une longue phrase, avec une parenthèse au
milieu (annoncée par un tiret) : courte louange à la Nature.
Cela dessine
trois mouvements :
1) Un tableau épouvantable de guerres absurdes, sur le modèle de ce que
fait Voltaire dans Candide.
2) Une Nature qu’on peut tout de suite comparer, à partir du deuxième
tiret, avec la religion instituée.
3) La clé et la pointe du sonnet : le poète se rebelle contre le Dieu d’une
religion qui participe aux injustices.
Axes de lecture pour un commentaire composé
I.Dénoncer l'absurdité de la guerre
1) Dénoncer la guerre
2) Un tableau impressionnant
3) La folie des Rois
II.
Revendiquer des valeurs humaines
1) Un message universel
2) La parole d'un poète engagé
3) Préserver la dignité humaine
III.
Dénoncer une religion contre-nature
1) Nature et spiritualité
2) Dénoncer la religion instituée
3) Vision d'un Dieu infâme
Premier mouvement :
Un tableau épouvantable de guerres absurdes
Tandis que les crachats rouges de la mitraille
Sifflent tout le jour par l’infini du ciel bleu ;
Qu’écarlates ou verts, près du Roi qui les raille,
Croulent les bataillons en masse dans le feu ;
Tandis qu’une folie épouvantable broie
Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant ;
Comment est créé l’effet de tension qui traverse le poème ?
• Anaphore rhétorique : « tandis que » revient deux fois.
Donne de
l’ampleur au discours.
Deux subordonnées temporelles.
• Référence à Voltaire Candide : « Tandis que les deux rois faisaient
chanter des Te Deum ».
• La locution conjonctive de subordination temporelle « tandis que »
exprime la simultanéité.
• On se demande : que se passe-t-il au même moment ? Tout le poème
est une longue phrase qui ménage le suspense.
⇨ Absurdité de la guerre mais aussi absurdité de la religion.
Comment est parodié le registre épique ?
• Les pluriels « écarlates … verts … les bataillons » et les chiffres élevés «
cent milliers d’hommes ».
• Tout cela devient un simple « tas fumant » au singulier.
• Le lien logique d’alternative « écarlates ou verts » peu importe la
couleur de l’uniforme, tous meurent.
• Ces couleurs peuvent aussi être le sang et l’herbe mélangés.
⇨ Tout ce qui est humain est détruit.
En quoi ce tableau est-il impressionnant ?
• L’enjambement « les crachats // sifflent » imite le vol des boulets de
canon d’une ligne à l’autre.
• L’allitération en F « sifflent … infini » nous fait entendre les boulets de
canon qui traversent le ciel.
• Allitérations en R pour les bataillons qui « croulent ».
• L'adjectif participe présent « fumant » résultat en mouvement.
⇨ C’est une hypotypose (description saisissante et animée).
Comment la guerre devient-elle une immense moquerie ?
• Métaphore des « crachats rouges » projectiles qui sont aussi des
moqueries du Roi qui les « raille ».
• La conscription des soldats est une grande moquerie.
Ainsi, la rime «
mitraille / raille » est signifiante.
• On peut penser aussi à une maladie qui fait cracher du sang : cela
renvoie au titre « Le Mal ».
⇨ La guerre ne respecte aucune dignité humaine.
Comment Rimbaud accuse-t-il la monarchie ?
• Majuscule au mot « Roi » : n’importe quel roi agit ainsi.
• Proximité accablante « près du Roi » : tout le monde meurt autour de
lui, qui reste sain et sauf.
• La mitraille sort de la bouche des canons, les railleries sortent de la
bouche du roi, c’est lui l’instrument de mort.
⇨ La monarchie conduit à la tyrannie et à la guerre.
Comment se traduit cette dimension universelle de la dénonciation ?
• Les verbes « siffler … railler … crouler … broyer … faire » mêlent les
valeurs du présent : le présent historique de narration peut tout aussi
bien être un présent de vérité générale.
• Le pronom « les raille » vient avant les « bataillons » : c’est une
cataphore (le pronom précède le nom qu’il désigne.)
• Personnification de « la folie » qui « broie » les hommes.
⇨ Rimbaud dénonce l’absurdité de la guerre comme une folie.
Comment est filée l’allégorie de la folie ?
• L’article indéfini « une folie » indique qu’il y en a d’autres, en d’autres
temps et d’autres lieux.
• Adjectif « épouvantable » : registre fantastique.
• L’action « broyer cent milliers d’hommes » monstre géant.
• Le CC de manière « en masse » annonce déjà le « tas fumant ».
• Chronologie dans le lien logique « broie et fait ».
⇨ Cette folie déshumanise les soldats.
Rimbaud donne-t-il son avis explicitement ?
• Le premier quatrain est factuel : les crachats sifflent, les bataillons
croulent.
• Le jugement du poète passe par les connotations : « siffler, railler » :
les verbes révèlent la moquerie du poète.
• Le rythme avec la césure après la 5e syllabe « sifflent tout le jour // par
l’infini du ciel bleu » crée une dissonance.
• Le 2e quatrain est explicite avec l’adjectif « épouvantable » la guerre
devient un véritable monstre.
⇨ Le tableau est bien un enfer sur terre.
Comme la guerre s’oppose-t-elle déjà à la Nature ?
• La couleur des uniformes et des armes humaines « rouges … écarlate »
s’oppose au « bleu » du ciel.
• La rime « bleu / feu » accentue encore cette opposition.
• « Tout le jour » : moments où le soleil brille.
Le ciel est « infini ».
⇨ La guerre est contre-nature.
dimension spirituelle de la Nature qu’on
retrouvera plus loin dans le poème.
Deuxième mouvement :
Une religion instituée contre-nature
— Pauvres morts ! dans l’été, dans l’herbe, dans ta joie,
Nature ! ô toi qui fis ces hommes saintement !…
— Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées
Des autels, à l’encens, aux grands calices d’or ;
Qui dans le bercement des hosannah s’endort,
La structure laisse découvrir un jeu complexe....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Si je mourrais là bas - Apollinaire Analyse analytique
- analyse linéaire "Le Mal" de Rimbaud
- analyse du poème fleurs du mal: XIV. L’homme et la mer
- Analyse linéaire - L'invitation au voyage, Les Fleurs du Mal, Baudelaire
- analyse de plusieurs poèmes des Fleurs du Mal