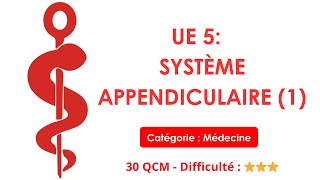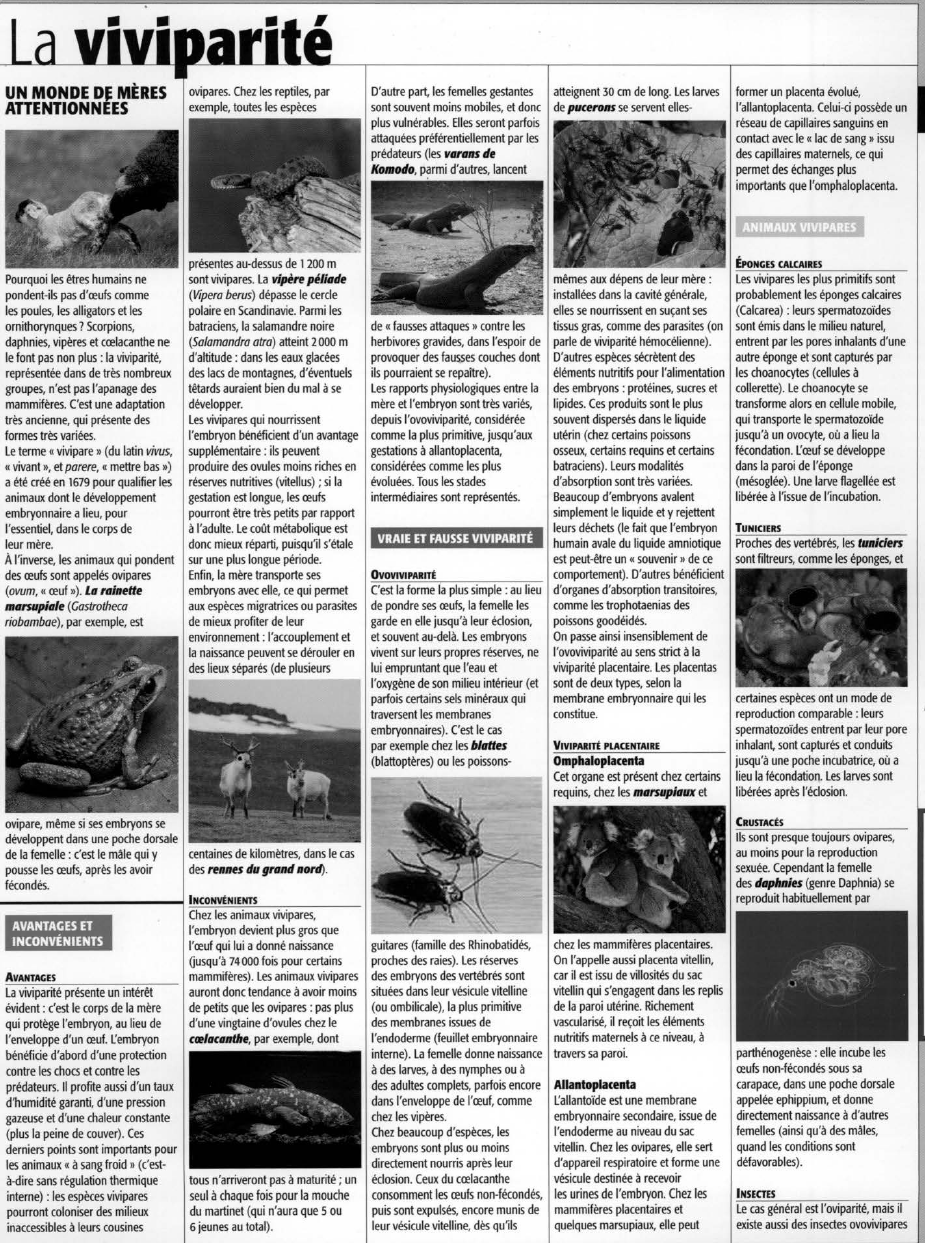La viviparité
Publié le 18/05/2020
Extrait du document
«
Pourquoi les êtres humains ne pondent-ils pas d'œufs comme les poules , les alligators et les ornithorynques? Scorpions , daphnies , vipères et cœlacanthe ne le font pas non plus : la viviparité , représentée dans de très nombreux groupes , n'est pas l'apanage des mammifères.
C'est une adap tation très ancienne, qui présente des formes très variées.
Le terme « vivipare • (du latin vivus, • vivant •.
et porere , • mettre bas •) a été créé en 1679 pour qualifier les animaux dont le développement embryonnaire a lieu, pour l'essentiel, dans le corps de leur mère .
A l'inverse, les animaux qui pondent des œufs sont appe lés ovipares (ovum, • œuf •).
Lo roiotttttt ••1$11pioltt ( Gostrotheca riobombae ), par exemple , est
ovipare, même si ses embryons se développe nt dans une poche dorsale de la femelle : c'est le male qui y pousse les œufs , après les avoir fécondés.
présentes au-dessus de l 200 m sont vivipares.
La "'"'~ "'llottt (Vipero berus ) dépasse le cercle polaire en Scandinavie .
Parmi les batraciens , la salamandre noire (So/omondro afro ) atteint 2 000 m d'altitude : dans les eaux glacées des lacs de montagnes, d'êventuels têtards auraient bien du mal à se dêvelopper .
Les vivipares qui nour rissent l'embryon bénéficient d'un avantage supplémentaire : ils peuvent produire des ovules moins riches en réserves nutritives (vitellu s) ; si la gestation est longue , les œufs pourront être très petits par rapport à l'adulte.
Le coOt métabolique est donc mieux réparti, puisqu'il s'étale sur une plus longue période .
Enfin, la mère transporte ses embryon s avec elle, ce qui permet aux espèces migratrices ou parasrtes de mieux profiter de leur environnement : l'accouplement et la naissance peuvent se dérouler en des lieux séparés (de plusieurs
------------ I_N_co_NVt_~NI_ENT_s _____ _ _
La viviparité présente un intérêt évident : c'est le corps de la mère qui protège l'embryon , au lieu de l'enveloppe d'un œuf.
L'embryon bénéficie d'abord d'une protection contre les chocs et contre les prédateurs .
Il profite aussi d'un taux d'humidité garanti, d'une pression gazeuse et d'une chaleur constante (plus la peine de couver ).
Ces derniers points sont importants pour les animaux • à sang froid • (c'est à-dire sans régulation thermique interne) : les espèces vivipares pourront coloniser des milieux inaccessibles à leurs cousines
Chez les animaux vivipares , l'embryon devient plus gros que l'œuf qui lui a donné naissance Gusqu 'à 74 000 fois pour certains mammifères ).
Les animaux vivipares auront donc tendance à avoir moins de petits que les ovipares : pas plus d'une vingtaine d'ovules chez le cœlocontlllt , par exemple , dont
tous n'arriveront pas à maturité ; un seul à chaque fois pour la mouche du martinet (qui n'aura que 5 ou 6 jeunes au totaQ.
D'autre part.
les femelles gestantes sont souvent moins mobiles, et donc plus vulnérables .
Elles seront parfois attaquées préférentiellement par les prédateurs (les 11orons ttt Koaotlo , parmi d'autres, lancent
de • fausses attaques • contre les herbivores gravides, dans l'espoir de provoquer des fausses couches dont ils pour raient se repaître ).
Les rapports physiologiques entre la mère et l'embryon sont très variés , depuis l'ovoviviparité , considérée comme la plus primitive , jusqu 'aux gestations à allantoplacenta , considérées comme les plus êvoluées .
Tous les stades intermédia ires sont représentés.
VRAIE ET FAUSSE VIVIPARITÉ
Ovov1vi,Aa1Tt C'est la forme la plus simple : au lieu de pondre ses œufs , la femelle les garde en elle jusqu 'à leur éclosion, et souvent au-delà .
Les embryon s vivent sur leurs propres réserves , ne lui empruntant que l'eau et l'oxygène de son milieu intérieur (et parfois certains sels minéraux qui traversent les membranes embryonnaires) .
C'est le cas par exemple chez les blotttts (blattoptères ) ou les poissons -
guitares (famille des Rhinobatidés , proches des raies ).
Les réserves des embryons des vertébrés sont situées dans leur vésicule vitelline (ou ombilicale ), la plus primitive des membranes issues de l'endoderme (feuillet embryonnaire interne ).
La femelle donne naissance à des larves , à des nymphes ou à des adultes complets , parfois encore dans l'enveloppe de l'œuf , comme chez les vipères.
Chez beaucoup d'espèces , les embryons sont plus ou moins directement nourr is après leur éclosion.
Ceux du cœlacanthe consomment les œufs non-fécondés , puis sont expulsés , encore muni s de leur vésicule vitelline , dès qu'ils
mêmes aux dépens de leur mère : installées dans la cavité générale , elles se nourrissent en suçant ses tissus gras, comme des paras ites (on parle de viviparité hémoc élienne ).
D'autres espèces sécrètent des éléments nutritifs pour l'alimentation des embryons : protéines , sucres et lipides.
Ces produits sont le plus souvent dispersés dans le liquide utérin (chez certains poissons osseux, certains requ ins et certains batraciens ).
Leurs modalités d'absorption sont très variées .
Beaucoup d'embryons avalent simplement le liquid e et y rejettent leurs déchets (le fart que l'embryon humain avale du liquide amniotique est peut-être un •souvenir • de ce comportement ).
D'autres bénéficient d'organes d'absorption transrtoires, comme les trophotaenias des poissons goodéidés .
On passe ainsi insensiblement de l'ovoviviparité au sens strict à la viviparrté placentaire.
Les placentas sont de deux types , selon la membrane embryonna ire qui les constrtue.
V1vi,MITT PLACENTAIIE Omph,alopla.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓