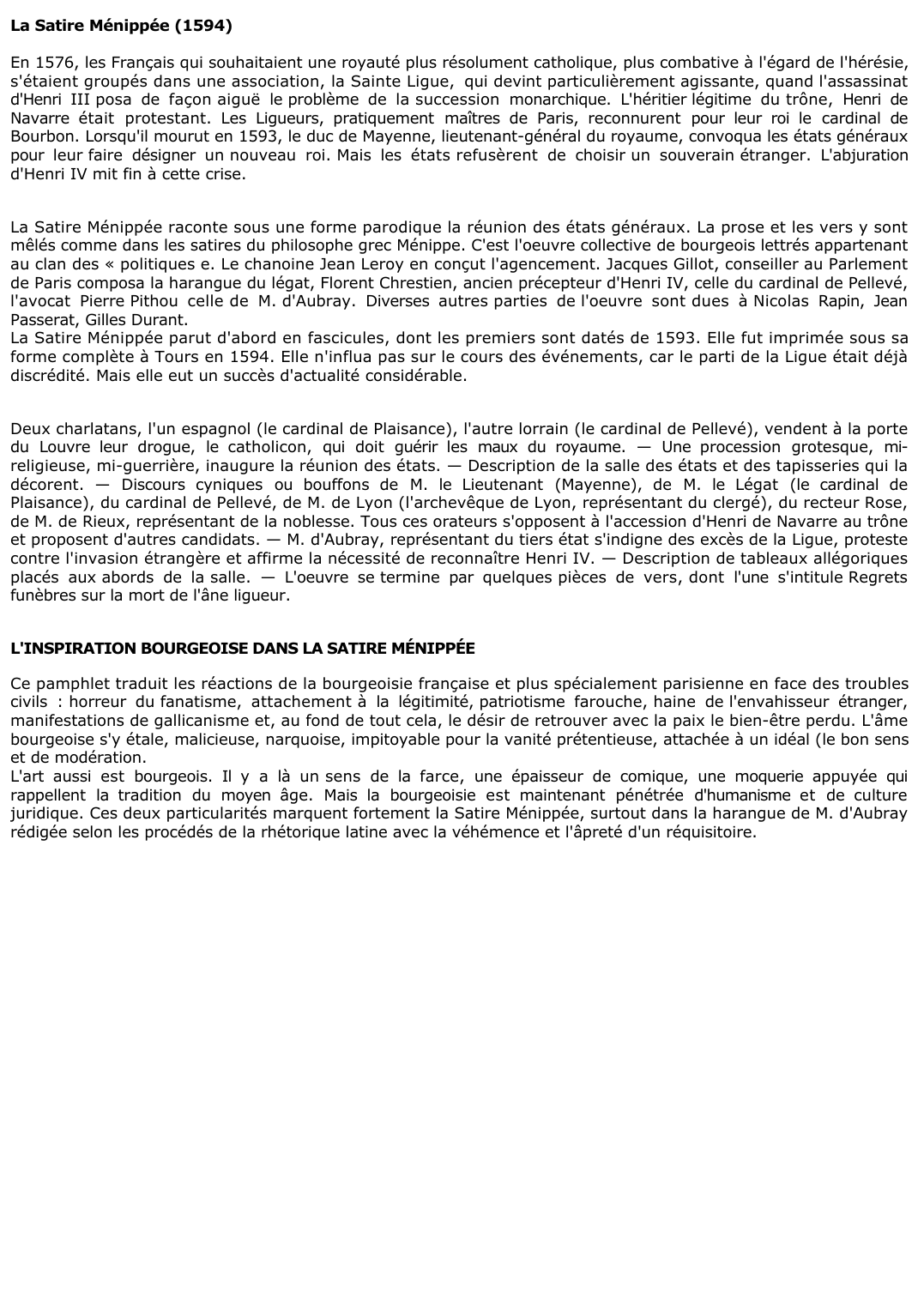La Satire Ménippée
Publié le 09/12/2021
Extrait du document
«
La Satire Ménippée (1594)
En 1576, les Français qui souhaitaient une royauté plus résolument catholique, plus combative à l'égard de l'hérésie,s'étaient groupés dans une association, la Sainte Ligue, qui devint particulièrement agissante, quand l'assassinatd'Henri III posa de façon aiguë le problème de la succession monarchique.
L'héritier légitime du trône, Henri deNavarre était protestant.
Les Ligueurs, pratiquement maîtres de Paris, reconnurent pour leur roi le cardinal deBourbon.
Lorsqu'il mourut en 1593, le duc de Mayenne, lieutenant-général du royaume, convoqua les états générauxpour leur faire désigner un nouveau roi.
Mais les états refusèrent de choisir un souverain étranger.
L'abjurationd'Henri IV mit fin à cette crise.
La Satire Ménippée raconte sous une forme parodique la réunion des états généraux.
La prose et les vers y sontmêlés comme dans les satires du philosophe grec Ménippe.
C'est l'oeuvre collective de bourgeois lettrés appartenantau clan des « politiques e.
Le chanoine Jean Leroy en conçut l'agencement.
Jacques Gillot, conseiller au Parlementde Paris composa la harangue du légat, Florent Chrestien, ancien précepteur d'Henri IV, celle du cardinal de Pellevé,l'avocat Pierre Pithou celle de M.
d'Aubray.
Diverses autres parties de l'oeuvre sont dues à Nicolas Rapin, JeanPasserat, Gilles Durant.La Satire Ménippée parut d'abord en fascicules, dont les premiers sont datés de 1593.
Elle fut imprimée sous saforme complète à Tours en 1594.
Elle n'influa pas sur le cours des événements, car le parti de la Ligue était déjàdiscrédité.
Mais elle eut un succès d'actualité considérable.
Deux charlatans, l'un espagnol (le cardinal de Plaisance), l'autre lorrain (le cardinal de Pellevé), vendent à la portedu Louvre leur drogue, le catholicon, qui doit guérir les maux du royaume.
— Une procession grotesque, mi-religieuse, mi-guerrière, inaugure la réunion des états.
— Description de la salle des états et des tapisseries qui ladécorent.
— Discours cyniques ou bouffons de M.
le Lieutenant (Mayenne), de M.
le Légat (le cardinal dePlaisance), du cardinal de Pellevé, de M.
de Lyon (l'archevêque de Lyon, représentant du clergé), du recteur Rose,de M.
de Rieux, représentant de la noblesse.
Tous ces orateurs s'opposent à l'accession d'Henri de Navarre au trôneet proposent d'autres candidats.
— M.
d'Aubray, représentant du tiers état s'indigne des excès de la Ligue, protestecontre l'invasion étrangère et affirme la nécessité de reconnaître Henri IV.
— Description de tableaux allégoriquesplacés aux abords de la salle.
— L'oeuvre se termine par quelques pièces de vers, dont l'une s'intitule Regretsfunèbres sur la mort de l'âne ligueur.
L'INSPIRATION BOURGEOISE DANS LA SATIRE MÉNIPPÉE
Ce pamphlet traduit les réactions de la bourgeoisie française et plus spécialement parisienne en face des troublescivils : horreur du fanatisme, attachement à la légitimité, patriotisme farouche, haine de l'envahisseur étranger,manifestations de gallicanisme et, au fond de tout cela, le désir de retrouver avec la paix le bien-être perdu.
L'âmebourgeoise s'y étale, malicieuse, narquoise, impitoyable pour la vanité prétentieuse, attachée à un idéal (le bon senset de modération.L'art aussi est bourgeois.
Il y a là un sens de la farce, une épaisseur de comique, une moquerie appuyée quirappellent la tradition du moyen âge.
Mais la bourgeoisie est maintenant pénétrée d'humanisme et de culturejuridique.
Ces deux particularités marquent fortement la Satire Ménippée, surtout dans la harangue de M.
d'Aubrayrédigée selon les procédés de la rhétorique latine avec la véhémence et l'âpreté d'un réquisitoire..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PITHOU, Pierre (1539-1596)Jurisconsulte et écrivain, il est l'un des collaborateurs de la Satire Ménippée.
- Analyse linéaire : 1ère Générale Bac de français Extrait de la Satire XI de Boileau Vers 9 à 29
- Sujet: Le genre de la comédie vous semble-t-il le mieux approprié pour faire la satire d'une société ?
- Dans La Religieuse "Diderot se livre à ce qu'il nomme lui-même une effroyable satire des couvents, mais cette volonté polémique ne vaudrait que pour l'anecdote s'il n'y développait une véritable méditation sur les méfaits de la solitude et sur les effets pervers de la violence que l'homme exerce contre la nature et contre lui-même- spirituellement par le fanatisme, physiquement par la répression systématique des besoins du corps". Dans quelle mesure ce propos de Pierre Lepape (Diderot
- Satire et ironie dans Candide de Voltaire