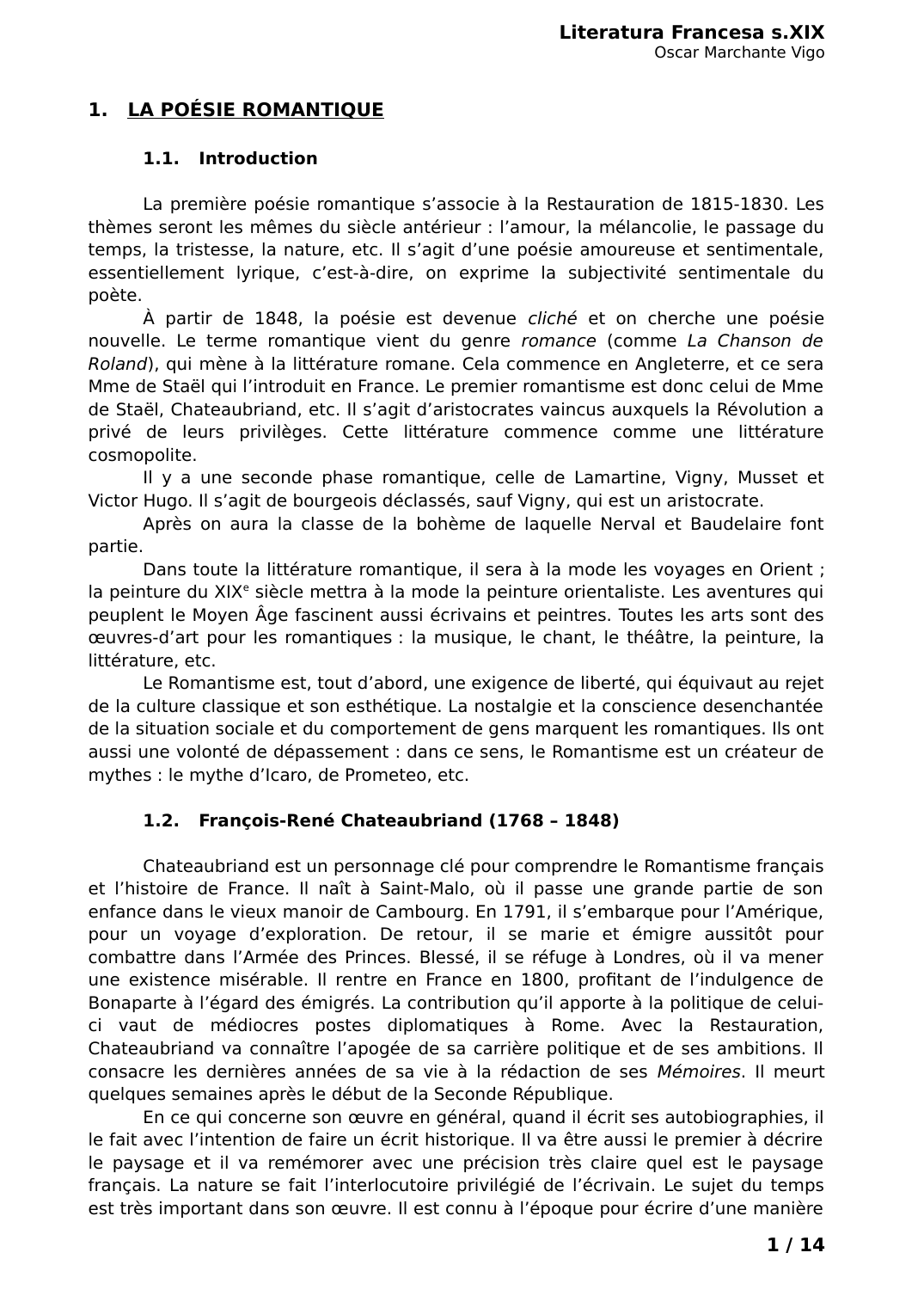La Littérature française du XIXe siècle
Publié le 14/03/2021

Extrait du document
LE RÉALISME 2.1. Introduction Le réalisme est la mise en place du genre roman, c’est-à-dire, le mouvement du roman sera le réalisme. Il faut savoir que presque tous les romans réalistes sont des romans d’initiation. Une des caractéristiques c’est justement la présence de 6 / 14 l’analyse psychologique. Il s’agit d’un mouvement qui fait constamment voir ses outils, ses instruments et l’invisibilité de l’auteur est caractéristique aussi. Il est doté de plusieurs éléments, parmi eux le temps de l’intrigue et la description. Le modèle de la science va l’influencer aussi : c’est la relation entre la littérature et la science à ce siècle-là. Il y aura chez les réalistes la volonté de ce qu’on appelait à l’époque faire vrai ; cependant, un peu plus tard, ce faire vrai sera un obstacle. Comme on sait, un roman c’est temps, espace et action. Dans presque tout le réalisme, le temps est chronologique et le milieu va être très important. La mimésis et la diégèse du roman seront des éléments essentiels dans le courant. Il y a trois phases dans le réalisme : le réalisme romantique ou subjectif de Stendhal ; le réalisme objectif de Balzac ; et le réalisme scientifique de Flaubert. 2.2. Stendhal (1783 – 1842) Stendhal, c’est un pseudonyme : il s’appelle en réalité Henri Beyle. Stendhal est le nom d’une ville allemande où il passait quelques périodes de temps. Le pseudonyme vient à cause de la question d’identité, qui mène à l’autobiographie et au problème du moi. Stendhal détestait son père, sa ville de naissance et la France. Ses parents étaient anti-revolutionnaires et lui, il était un libéral, partisan de Napoléon. Il est parti, jeune, à Paris, où il entre dans la vie politique et dans la vie napoléonienne. À partir de 1830, il sera consul en Italie ; à partir de ce moment, il passera presque toute sa vie là-bas. Stendhal commence à écrire quand sa vie politique finit, une fois que Napoléon est déplacé à Sainte-Hélène. Il adorait Shakespeare et détestait Racine ; la musique de Mozart était une autre de ses passions. On peut diviser sa vie en trois grandes périodes : la figure de Napoléon, qui détermine sa vie et son œuvre, était un mythe pour lui ; le républicanisme ; et son idéologie. Il y a deux notions essentielles associées à l’œuvre de Stendhal : le baylisme et l’égotisme. Dans sa vie, il y a des souvenirs d’égotisme ; il y a cette persistance de la question d’identité et de la biographie. On trouve quatre caractéristiques qui résument l’œuvre de Stendhal. D’une part, le moi, représenté dans ses écrits autobiographiques, constitue la partie la plus importante de son œuvre. Son esthétique est basée sur la musique et la peinture, ses deux grandes passions. Puis, les voyages, surtout l’Italie, sont essentiels pour lui. Finalement, la passion, reflétée dans De l’amour écrit en 1822, était une préoccupation constante. Il parlait de la cristallisation amoureuse qu’il attribuera à l’état amoureux. Deux notions clés pour comprendre l’œuvre de Stendhal sont la beauté et le bonheur, deux axes qui apparaissent toujours dans ses œuvres. Chez lui, il y aura une quête du bonheur qui vient normalement à travers de l’amour. Dans Le Rouge et le noir on peut trouver la chasse du bonheur. Celui-ci est un état de moments d’extase amoureux. L’amour est aussi essentiel chez Stendhal. Il va vivre entre deux siècles : il est à la fois un romantique convaincu, mais aussi un homme du XVIIIe siècle. Il disait qu’il voulait écrire comme un homme de lumières et comme un homme romantique, avec des sentiments. Il va vivre de la même façon le napoléonisme et le républicanisme. Il y avait beaucoup de gens qui le détestaient par son anticléricarisme et par son amour à Napoléon ; cependant, tout le monde adorait son œuvre. Son style n’a rien à voir avec celui de Chateaubriand : il voulait écrire comme le Code Civil, son idéal était la clarté. 7 / 14 Dans son œuvre, il va avoir un composant social de classes ; il s’occupe surtout de la bourgeoisie de province. Dans Le Rouge et le noir, par exemple, Mme de Rênal appartient à cette bourgeoisie et Mathilde à l’aristocratie. Tous les romans de Stendhal seront centrés sur un héros, marque du Romantisme qui reste chez lui. Ses personnages seront son miroir. On pourrait dire que toutes les œuvres de Stendhal sont inachevées dans la mesure qu’il ne cesse d’ajouter des nouveaux éléments. En 1834, il commence à écrire Vie d’Henry Brulard, une autobiographie interrompue, inachevée. En 1839, il va publier son grand roman italien, La Chartreuse de Parme. Le refus et la haine par la France, par Grénoble, par la bourgeoisie de province et par les Bourbons s’accrochent à son amour par l’Italie, selon lui la patrie du bonheur et de la beauté. On peut même parler du syndrome de Stendhal pour faire référence à tout ce qui a relation avec l’Italie et surtout avec Milan. De la même manière que Stendhal est une personne très complexe, les personnages de ses romans sont très compliqués. On peut comparer ses personnages avec ceux de Balzac. Chez les deux, il y a une présence énorme de l’introspection psychologique, mais il y a plus d’insistance dans la personnalité des personnages chez Stendhal que chez Balzac. Puis, le personnage-type est caractéristique de Balzac, chose qui n’arrive pas chez Stendhal. Une autre différence entre les deux est la manière de traiter le temps de l’histoire : chez Stendhal, le temps est chronologique, tandis que chez Balzac le roman commence in-media-res.
«
Literatura Francesa s.XIX
Oscar Marchante Vigo
1.
LA POÉSIE ROMANTIQUE
1.1.
Introduction
La première poésie romantique s’associe à la Restauration de 1815-1830.
Les
thèmes seront les mêmes du siècle antérieur : l’amour, la mélancolie, le passage du
temps, la tristesse, la nature, etc.
Il s’agit d’une poésie amoureuse et sentimentale,
essentiellement lyrique, c’est-à-dire, on exprime la subjectivité sentimentale du
poète.
À partir de 1848, la poésie est devenue cliché et on cherche une poésie
nouvelle.
Le terme romantique vient du genre romance (comme La Chanson de
Roland ), qui mène à la littérature romane.
Cela commence en Angleterre, et ce sera
Mme de Staël qui l’introduit en France.
Le premier romantisme est donc celui de Mme
de Staël, Chateaubriand, etc.
Il s’agit d’aristocrates vaincus auxquels la Révolution a
privé de leurs privilèges.
Cette littérature commence comme une littérature
cosmopolite.
Il y a une seconde phase romantique, celle de Lamartine, Vigny, Musset et
Victor Hugo.
Il s’agit de bourgeois déclassés, sauf Vigny, qui est un aristocrate.
Après on aura la classe de la bohème de laquelle Nerval et Baudelaire font
partie.
Dans toute la littérature romantique, il sera à la mode les voyages en Orient ;
la peinture du XIX e
siècle mettra à la mode la peinture orientaliste.
Les aventures qui
peuplent le Moyen Âge fascinent aussi écrivains et peintres.
Toutes les arts sont des
œuvres-d’art pour les romantiques : la musique, le chant, le théâtre, la peinture, la
littérature, etc.
Le Romantisme est, tout d’abord, une exigence de liberté, qui équivaut au rejet
de la culture classique et son esthétique.
La nostalgie et la conscience desenchantée
de la situation sociale et du comportement de gens marquent les romantiques.
Ils ont
aussi une volonté de dépassement : dans ce sens, le Romantisme est un créateur de
mythes : le mythe d’Icaro, de Prometeo, etc.
1.2.
François-René Chateaubriand (1768 – 1848)
Chateaubriand est un personnage clé pour comprendre le Romantisme français
et l’histoire de France.
Il naît à Saint-Malo, où il passe une grande partie de son
enfance dans le vieux manoir de Cambourg.
En 1791, il s’embarque pour l’Amérique,
pour un voyage d’exploration.
De retour, il se marie et émigre aussitôt pour
combattre dans l’Armée des Princes.
Blessé, il se réfuge à Londres, où il va mener
une existence misérable.
Il rentre en France en 1800, profitant de l’indulgence de
Bonaparte à l’égard des émigrés.
La contribution qu’il apporte à la politique de celui-
ci vaut de médiocres postes diplomatiques à Rome.
Avec la Restauration,
Chateaubriand va connaître l’apogée de sa carrière politique et de ses ambitions.
Il
consacre les dernières années de sa vie à la rédaction de ses Mémoires .
Il meurt
quelques semaines après le début de la Seconde République.
En ce qui concerne son œuvre en général, quand il écrit ses autobiographies, il
le fait avec l’intention de faire un écrit historique.
Il va être aussi le premier à décrire
le paysage et il va remémorer avec une précision très claire quel est le paysage
français.
La nature se fait l’interlocutoire privilégié de l’écrivain.
Le sujet du temps
est très important dans son œuvre.
Il est connu à l’époque pour écrire d’une manière
1 / 14.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE ROMANTISME : LITTÉRATURE (XIXe siècle)
- Charles Bouchard1837-1915Bouchard incarne vraiment la pathologie générale française à la fin du XIXe siècle.
- Louis Niedermeyer1802-1861D'origine vaudoise, il fit revivre sous son nom l'École fondée naguère par Choron ; elledevint alors (avec Saint-Saëns, Gigout, qui y enseignèrent, Fauré et Messager qui en furentélèves) un foyer important de la renaissance musicale française au XIXe siècle.
- Littérature française du XVIIe
- « Poésie ! ô trésor ! perle de la pensée! [...] 0 toi ! des vrais penseurs impérissable amour ! Comment se garderaient les profondes pensées, Sans rassembler leurs feux dans ton diamant pur Qui conserve si bien leurs splendeurs condensées ? Ce fin miroir solide, étincelant et dur, Reste des nations mortes, durable pierre Qu'on trouve sous ses pieds lorsque dans la poussière On cherche les cités sans en voir un seul mur. » (Vigny, La Maison du Berger.) Vous dégagerez la définition de la