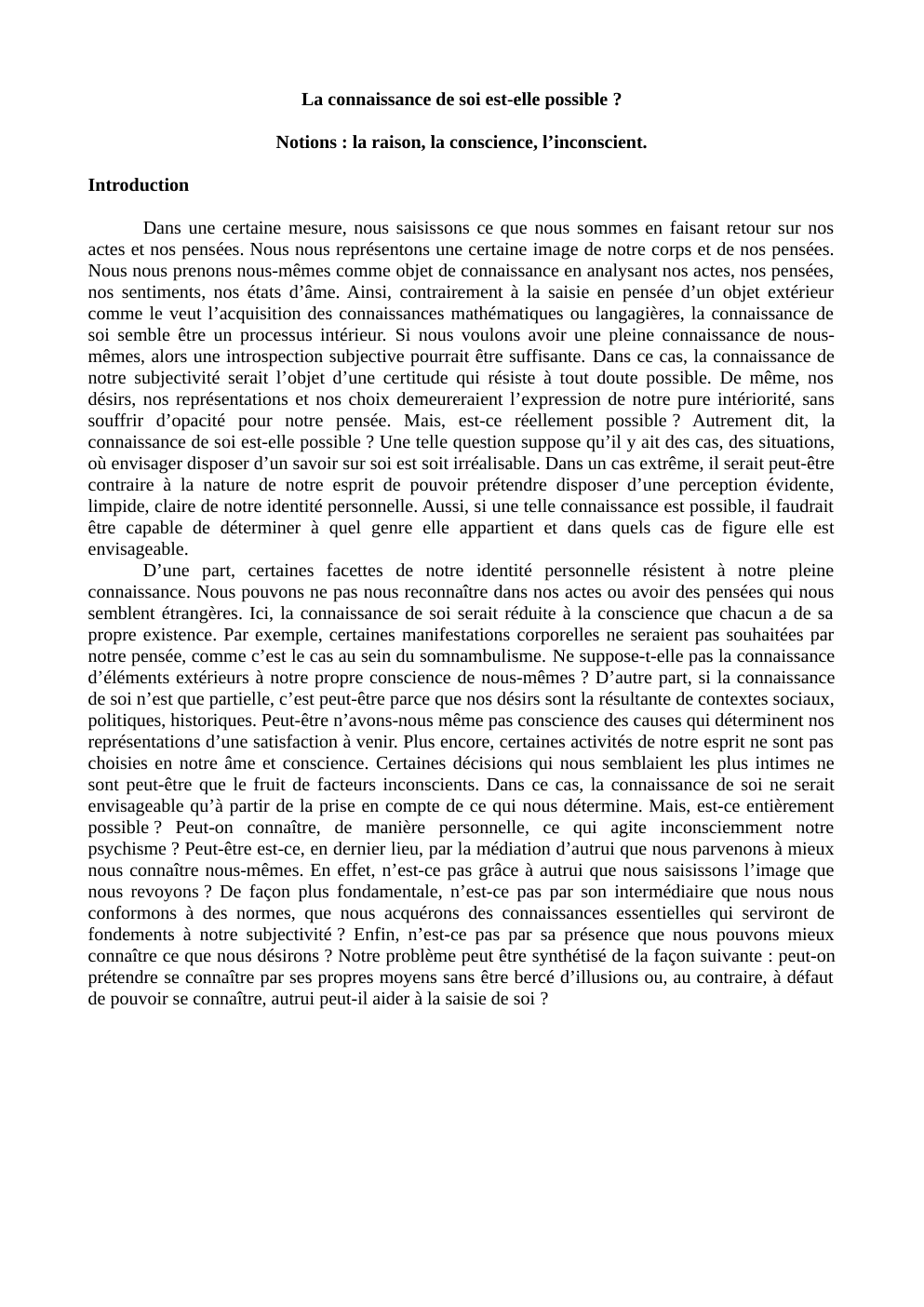La connaissance de soi est-elle possible ?
Publié le 11/02/2025
Extrait du document
«
La connaissance de soi est-elle possible ?
Notions : la raison, la conscience, l’inconscient.
Introduction
Dans une certaine mesure, nous saisissons ce que nous sommes en faisant retour sur nos
actes et nos pensées.
Nous nous représentons une certaine image de notre corps et de nos pensées.
Nous nous prenons nous-mêmes comme objet de connaissance en analysant nos actes, nos pensées,
nos sentiments, nos états d’âme.
Ainsi, contrairement à la saisie en pensée d’un objet extérieur
comme le veut l’acquisition des connaissances mathématiques ou langagières, la connaissance de
soi semble être un processus intérieur.
Si nous voulons avoir une pleine connaissance de nousmêmes, alors une introspection subjective pourrait être suffisante.
Dans ce cas, la connaissance de
notre subjectivité serait l’objet d’une certitude qui résiste à tout doute possible.
De même, nos
désirs, nos représentations et nos choix demeureraient l’expression de notre pure intériorité, sans
souffrir d’opacité pour notre pensée.
Mais, est-ce réellement possible ? Autrement dit, la
connaissance de soi est-elle possible ? Une telle question suppose qu’il y ait des cas, des situations,
où envisager disposer d’un savoir sur soi est soit irréalisable.
Dans un cas extrême, il serait peut-être
contraire à la nature de notre esprit de pouvoir prétendre disposer d’une perception évidente,
limpide, claire de notre identité personnelle.
Aussi, si une telle connaissance est possible, il faudrait
être capable de déterminer à quel genre elle appartient et dans quels cas de figure elle est
envisageable.
D’une part, certaines facettes de notre identité personnelle résistent à notre pleine
connaissance.
Nous pouvons ne pas nous reconnaître dans nos actes ou avoir des pensées qui nous
semblent étrangères.
Ici, la connaissance de soi serait réduite à la conscience que chacun a de sa
propre existence.
Par exemple, certaines manifestations corporelles ne seraient pas souhaitées par
notre pensée, comme c’est le cas au sein du somnambulisme.
Ne suppose-t-elle pas la connaissance
d’éléments extérieurs à notre propre conscience de nous-mêmes ? D’autre part, si la connaissance
de soi n’est que partielle, c’est peut-être parce que nos désirs sont la résultante de contextes sociaux,
politiques, historiques.
Peut-être n’avons-nous même pas conscience des causes qui déterminent nos
représentations d’une satisfaction à venir.
Plus encore, certaines activités de notre esprit ne sont pas
choisies en notre âme et conscience.
Certaines décisions qui nous semblaient les plus intimes ne
sont peut-être que le fruit de facteurs inconscients.
Dans ce cas, la connaissance de soi ne serait
envisageable qu’à partir de la prise en compte de ce qui nous détermine.
Mais, est-ce entièrement
possible ? Peut-on connaître, de manière personnelle, ce qui agite inconsciemment notre
psychisme ? Peut-être est-ce, en dernier lieu, par la médiation d’autrui que nous parvenons à mieux
nous connaître nous-mêmes.
En effet, n’est-ce pas grâce à autrui que nous saisissons l’image que
nous revoyons ? De façon plus fondamentale, n’est-ce pas par son intermédiaire que nous nous
conformons à des normes, que nous acquérons des connaissances essentielles qui serviront de
fondements à notre subjectivité ? Enfin, n’est-ce pas par sa présence que nous pouvons mieux
connaître ce que nous désirons ? Notre problème peut être synthétisé de la façon suivante : peut-on
prétendre se connaître par ses propres moyens sans être bercé d’illusions ou, au contraire, à défaut
de pouvoir se connaître, autrui peut-il aider à la saisie de soi ?
I.
Nous pouvons envisager de nous connaître par nos propres moyens.
Propres moyens : de manière seule.
Connaître : Accepter, admettre quelqu'un ou quelque chose
comme ayant de l'autorité à partir d’une observation par les sens, par l’expérience, par la pensée.
A.
Nous nous connaissons davantage à travers nos pensées qu’à partir de nos perceptions.
De façon immédiate, on prend connaissance de ce qui se situe hors de nous, de ce qui n’est
pas nous par un acte perceptif et sensitif.
Par exemple, lorsque je vois une personne en face de moi,
je sais que je ne suis pas elle.
La conscience réflexive considère ce qui se passe en nous et faisant
retour sur ses propres états.
Par exemple, la conscience morale est un retour du sujet sur ses propres
actions vis-à-vis d’autrui.
Alors, si on a une capacité de pouvoir se connaître, on peut supposer que
la pensée consciente est ce qui accompagne tous nos actes, et qu’elle est une certitude première.
Ce type de certitude de la connaissance de soi peut être étudié à partir de la philosophie de
René Descartes.
Ce dernier recherche le fondement de la connaissance.
Il est en quête d’une vérité
indubitable à partir de laquelle reconstruire tout l’édifice du savoir.
Dès le départ (Méditation
première), Descartes pense avoir acquis un savoir incertain puisqu’il y « a en notre esprit quelques
fausses opinions ».
La pensée désigne la connaissance immédiate de tout ce qui a lieu dans la
conscience du sujet.
Il faut donc prendre ici le terme de pensée dans son sens large, quasi-synonyme
de représentation, puisque les perceptions et sentiments, par exemple, sont, au sens de Descartes,
des pensées, non moins que les souhaits, désirs, fictions de l’imagination ou les conceptions pures
d’un esprit s’appliquant à une démonstration mathématique.
La pensée s’identifierait donc à la
connaissance immédiate des représentations qui se forment en chacun, donc à la conscience.
« J'avais dès longtemps remarqué que, pour les mœurs, il est besoin quelquefois de
suivre des opinions qu'on sait fort incertaines, tout de même que si elles étaient
indubitables, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; mais, parce qu'alors je désirais vaquer
seulement à la recherche de la vérité, je pensai qu'il fallait que je fisse tout le contraire,
et que je rejetasse, comme absolument faux, tout ce en quoi je pourrais imaginer le
moindre doute afin de voir s'il ne resterait point, après cela, quelque chose en ma
créance, qui fût entièrement indubitable.
Ainsi, à cause que nos sens nous trompent
quelquefois, je voulus supposer qu'il n'y avait aucune chose qui fût telle qu'ils nous la
font imaginer.
Et parce qu'il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant, même
touchant les plus simples matières de géométrie, et y font des paralogismes, jugeant que
j'étais sujet à faillir, autant qu'aucun autre, je rejetai comme fausses toutes les raisons
que j'avais prises auparavant pour démonstrations.
Et enfin, considérant que toutes les
mêmes pensées, que nous avons étant éveillés, nous peuvent aussi venir, quand nous
dormons, sans qu'il y en ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je me résolus de feindre
que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que
les illusions de mes songes.
Mais, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je
voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais,
fusse quelque chose.
Et remarquant que cette vérité : je pense, donc je suis, était si
ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques
n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir, sans scrupule,
pour le premier principe de la philosophie que je cherchais.
Puis, examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que
je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse; mais
que je ne pouvais pas feindre, pour cela, que je n'étais point; et qu'au contraire, de cela
même que je pensais à douter de la vérité des autres choses, il suivait très évidemment
et très certainement que j'étais; au lieu que, si j'eusse seulement cessé de penser, encore
que tout le reste de ce que j'avais jamais imaginé eût été vrai, je n'avais aucune raison de
croire que j'eusse été : je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la
nature n'est que de penser, et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend
d'aucune chose matérielle.
En sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce
que je suis, est entièrement distincte du corps, et même qu'elle est plus aisée à connaître
que lui, et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est.
Après cela, je considérai en général ce qui est requis à une proposition pour être
vraie et certaine; car, puisque je venais d'en trouver une que je savais être telle, je pensai
que je devais aussi savoir en quoi consiste cette certitude.
Et ayant remarqué qu'il n'y a
rien du tout en ceci : je pense, donc je suis, qui m'assure que je dis la vérité, sinon que je
vois très clairement que, pour penser, il faut être : je jugeai que je pouvais prendre pour
règle générale, que les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement
sont toutes vraies; mais qu'il y a seulement quelque difficulté à bien remarquer quelles
sont celles que nous concevons distinctement.
»
René Descartes, Discours de la méthode (1637), IVe partie.
1° constatation du caractère douteux que présentent nos connaissances, sauf une ; 2° décision
de considérer comme fausses toutes les connaissances qui sont rendues douteuses.
« Je pourrais imaginer… »....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La connaissance de l'homme ne peut pas s'étendre au-delà de son expérience propre. Locke.
- L'art est-il un mode de connaissance ?
- Géopolitique : l’enjeu de la connaissance
- « Je ne connais rien de plus délectable, a dit Sainte-Beuve, ni de plus profitable pour la connaissance des oeuvres littéraires qu'une biographie bien faite ». Commentez cette opinion.
- Dans quelle mesure le personnage de roman donne-t-il au lecteur un accès privilégié à la connaissance du coeur humain ? Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté en vous appuyant sur les textes qui vous sont proposés, ceux que vous avez étudiés en classe et vos lectures personnelles.