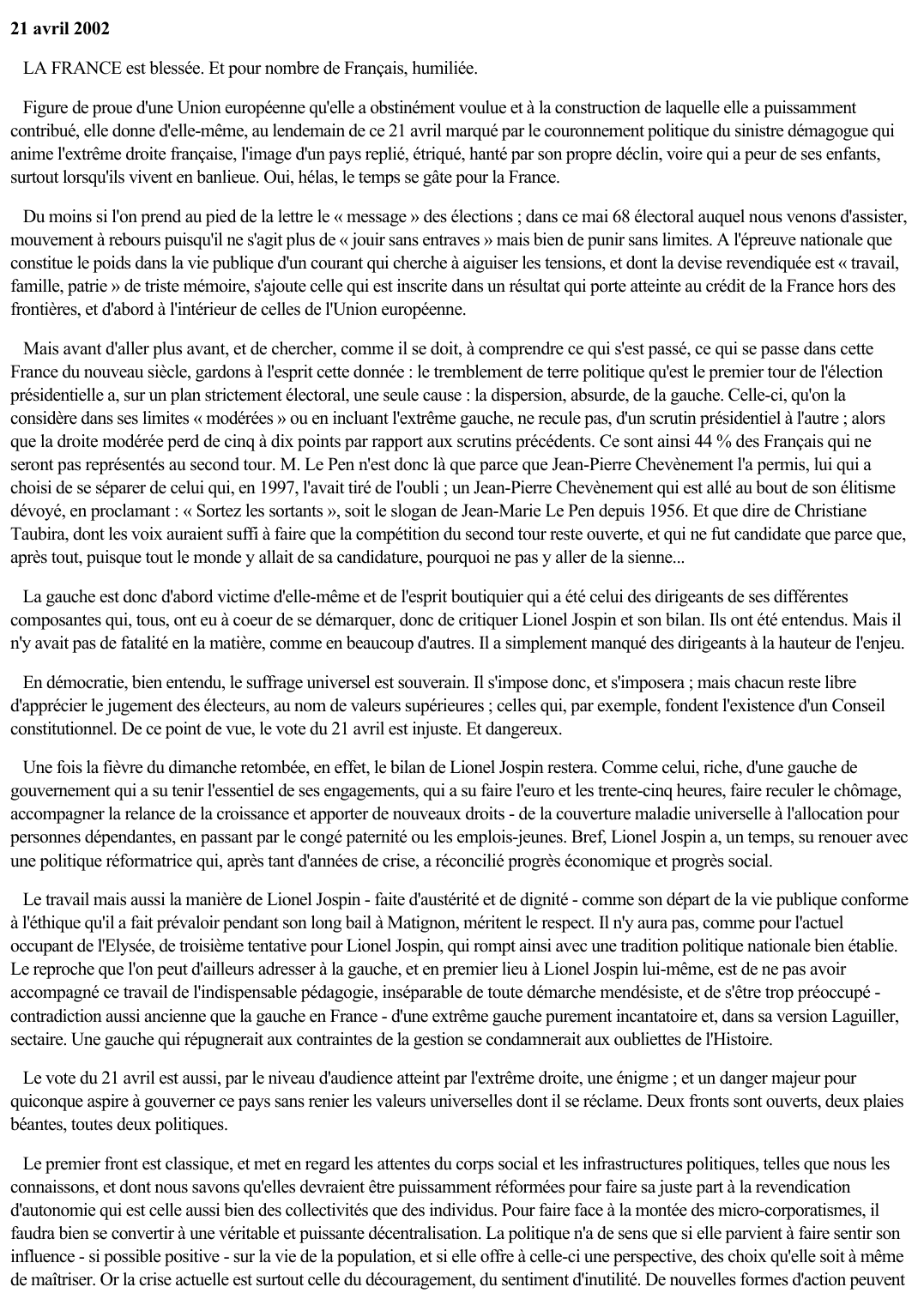La blessure
Publié le 10/12/2021

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : La blessure. Ce document contient 1523 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Ressources gratuites
21 avril 2002 LA FRANCE est blessée. Et pour nombre de Français, humiliée. Figure de proue d'une Union européenne qu'elle a obstinément voulue et à la construction de laquelle elle a puissamment contribué, elle donne d'elle-même, au lendemain de ce 21 avril marqué par le couronnement politique du sinistre démagogue qui anime l'extrême droite française, l'image d'un pays replié, étriqué, hanté par son propre déclin, voire qui a peur de ses enfants, surtout lorsqu'ils vivent en banlieue. Oui, hélas, le temps se gâte pour la France. Du moins si l'on prend au pied de la lettre le « message » des élections ; dans ce mai 68 électoral auquel nous venons d'assister, mouvement à rebours puisqu'il ne s'agit plus de « jouir sans entraves » mais bien de punir sans limites. A l'épreuve nationale que constitue le poids dans la vie publique d'un courant qui cherche à aiguiser les tensions, et dont la devise revendiquée est « travail, famille, patrie » de triste mémoire, s'ajoute celle qui est inscrite dans un résultat qui porte atteinte au crédit de la France hors des frontières, et d'abord à l'intérieur de celles de l'Union européenne. Mais avant d'aller plus avant, et de chercher, comme il se doit, à comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe dans cette France du nouveau siècle, gardons à l'esprit cette donnée : le tremblement de terre politique qu'est le premier tour de l'élection présidentielle a, sur un plan strictement électoral, une seule cause : la dispersion, absurde, de la gauche. Celle-ci, qu'on la considère dans ses limites « modérées » ou en incluant l'extrême gauche, ne recule pas, d'un scrutin présidentiel à l'autre ; alors que la droite modérée perd de cinq à dix points par rapport aux scrutins précédents. Ce sont ainsi 44 % des Français qui ne seront pas représentés au second tour. M. Le Pen n'est donc là que parce que Jean-Pierre Chevènement l'a permis, lui qui a choisi de se séparer de celui qui, en 1997, l'avait tiré de l'oubli ; un Jean-Pierre Chevènement qui est allé au bout de son élitisme dévoyé, en proclamant : « Sortez les sortants », soit le slogan de Jean-Marie Le Pen depuis 1956. Et que dire de Christiane Taubira, dont les voix auraient suffi à faire que la compétition du second tour reste ouverte, et qui ne fut candidate que parce que, après tout, puisque tout le monde y allait de sa candidature, pourquoi ne pas y aller de la sienne... La gauche est donc d'abord victime d'elle-même et de l'esprit boutiquier qui a été celui des dirigeants de ses différentes composantes qui, tous, ont eu à coeur de se démarquer, donc de critiquer Lionel Jospin et son bilan. Ils ont été entendus. Mais il n'y avait pas de fatalité en la matière, comme en beaucoup d'autres. Il a simplement manqué des dirigeants à la hauteur de l'enjeu. En démocratie, bien entendu, le suffrage universel est souverain. Il s'impose donc, et s'imposera ; mais chacun reste libre d'apprécier le jugement des électeurs, au nom de valeurs supérieures ; celles qui, par exemple, fondent l'existence d'un Conseil constitutionnel. De ce point de vue, le vote du 21 avril est injuste. Et dangereux. Une fois la fièvre du dimanche retombée, en effet, le bilan de Lionel Jospin restera. Comme celui, riche, d'une gauche de gouvernement qui a su tenir l'essentiel de ses engagements, qui a su faire l'euro et les trente-cinq heures, faire reculer le chômage, accompagner la relance de la croissance et apporter de nouveaux droits - de la couverture maladie universelle à l'allocation pour personnes dépendantes, en passant par le congé paternité ou les emplois-jeunes. Bref, Lionel Jospin a, un temps, su renouer avec une politique réformatrice qui, après tant d'années de crise, a réconcilié progrès économique et progrès social. Le travail mais aussi la manière de Lionel Jospin - faite d'austérité et de dignité - comme son départ de la vie publique conforme à l'éthique qu'il a fait prévaloir pendant son long bail à Matignon, méritent le respect. Il n'y aura pas, comme pour l'actuel occupant de l'Elysée, de troisième tentative pour Lionel Jospin, qui rompt ainsi avec une tradition politique nationale bien établie. Le reproche que l'on peut d'ailleurs adresser à la gauche, et en premier lieu à Lionel Jospin lui-même, est de ne pas avoir accompagné ce travail de l'indispensable pédagogie, inséparable de toute démarche mendésiste, et de s'être trop préoccupé - contradiction aussi ancienne que la gauche en France - d'une extrême gauche purement incantatoire et, dans sa version Laguiller, sectaire. Une gauche qui répugnerait aux contraintes de la gestion se condamnerait aux oubliettes de l'Histoire. Le vote du 21 avril est aussi, par le niveau d'audience atteint par l'extrême droite, une énigme ; et un danger majeur pour quiconque aspire à gouverner ce pays sans renier les valeurs universelles dont il se réclame. Deux fronts sont ouverts, deux plaies béantes, toutes deux politiques. Le premier front est classique, et met en regard les attentes du corps social et les infrastructures politiques, telles que nous les connaissons, et dont nous savons qu'elles devraient être puissamment réformées pour faire sa juste part à la revendication d'autonomie qui est celle aussi bien des collectivités que des individus. Pour faire face à la montée des micro-corporatismes, il faudra bien se convertir à une véritable et puissante décentralisation. La politique n'a de sens que si elle parvient à faire sentir son influence - si possible positive - sur la vie de la population, et si elle offre à celle-ci une perspective, des choix qu'elle soit à même de maîtriser. Or la crise actuelle est surtout celle du découragement, du sentiment d'inutilité. De nouvelles formes d'action peuvent réunir des foules, dès lors qu'elles donnent l'impression, fût-ce au prix de raisonnements rapides et parfois trop simples, qu'il s'agit de peser sur le cours des choses. Ainsi un débat essentiel pour l'avenir a lieu depuis plusieurs mois : il s'agit de la confrontation, au sein de la Commission de Bruxelles, entre « libéraux » et « régulateurs » ; autrement dit, comment armer l'Union européenne face à la mondialisation. Or ce débat a été absent de la campagne. S'il a surgi, c'est... à Barcelone, face à 300 000 manifestants. Peut-on suggérer plus clairement que le débat politique franco-français est largement vidé de son sens ? Le second front est plus lourd. Il est résumé dans le livre de l'historien Benjamin Stora, Le Transfert de mémoire, qui met en lumière une tendance de fond à l'oeuvre dans la société française : le transfert, en « métropole », d'une mémoire coloniale, avec un élément constitutif de celle-ci : la peur communautarisée du « petit blanc » et le sentiment d'abandon qui lui est lié ; l'angoisse identitaire face à l'islam, le refus de la diversité culturelle - et ethnique - de la France d'aujourd'hui adossé à la tradition jacobine d'assimilation. Le refus d'assumer cette nouvelle société a été amplifié par le choc du 11 septembre, puis par le transfert en France du conflit du Proche-Orient, avec son lot de glissements conduisant à l'enfermement identitaire. De ce point de vue, les propos du président du CRIF, Roger Cukierman, au quotidien Haaretz, proclamant que le score de Le Pen « est un message aux musulmans pour qu'ils se tiennent tranquilles », ajoutant que cela servirait à « réduire » l'antisémitisme illustre, de façon choquante et irresponsable, cette dérive. Pour la gauche, momentanément écartée si elle sait éviter les règlements de compte et rassembler ses forces, comme pour la droite désormais forte de son champion, une gauche et une droite « de gouvernement » qui croyaient pouvoir s'affronter comme si de rien n'était, l'enjeu est bien là, celui de la cohésion du pays, donc de l'intégration. Et maintenant ? Jacques Chirac va se succéder à lui-même. Ainsi le président qui suscite la plus faible adhésion de toute l'histoire de la Cinquième République, celui qui pendant sept ans a présidé à l'affaiblissement de la fonction présidentielle, sera le président le mieux élu de notre longue histoire politique. Ayant fait sa propre campagne, aussi consciencieusement que celle de Jean-Marie Le Pen, en martelant le thème de l'insécurité, Jacques Chirac est face à un choix capital. Il peut faire comme les siens, au soir du premier tour, qui ont rivalisé dans la surenchère droitière et sécuritaire, au risque une fois de plus de permettre à Le Pen d'expliquer que l' « original » vaut mieux que la copie, et d'entretenir ainsi le courant et toutes les dérives. Il peut aussi choisir de restaurer sa fonction, et son propre crédit. Dans ses premières paroles, il s'est placé au-delà de son camp. Au-dessus des calculs politiciens. Comme s'il était désormais conscient qu'il lui reviendra de représenter la droite et la gauche. Son histoire personnelle était jusqu'à présent celle d'une carrière politique, avec des moyens que la morale publique réprouve. Le voilà qui soudain tutoie l'Histoire. Et peut enfin jouer le rôle dont il a rêvé : être président d'une République qu'il faut réformer, pour la faire de nouveau aimer. C'est ce que nous souhaitons. Pour que ce beau pays qu'est la France, avec toutes les couleurs qui l'habitent et qui forgent déjà son avenir, garde le cap de la raison et du progrès. JEAN-MARIE COLOMBANI Le Monde du 23 avril 2002
21 avril 2002 LA FRANCE est blessée. Et pour nombre de Français, humiliée. Figure de proue d'une Union européenne qu'elle a obstinément voulue et à la construction de laquelle elle a puissamment contribué, elle donne d'elle-même, au lendemain de ce 21 avril marqué par le couronnement politique du sinistre démagogue qui anime l'extrême droite française, l'image d'un pays replié, étriqué, hanté par son propre déclin, voire qui a peur de ses enfants, surtout lorsqu'ils vivent en banlieue. Oui, hélas, le temps se gâte pour la France. Du moins si l'on prend au pied de la lettre le « message » des élections ; dans ce mai 68 électoral auquel nous venons d'assister, mouvement à rebours puisqu'il ne s'agit plus de « jouir sans entraves » mais bien de punir sans limites. A l'épreuve nationale que constitue le poids dans la vie publique d'un courant qui cherche à aiguiser les tensions, et dont la devise revendiquée est « travail, famille, patrie » de triste mémoire, s'ajoute celle qui est inscrite dans un résultat qui porte atteinte au crédit de la France hors des frontières, et d'abord à l'intérieur de celles de l'Union européenne. Mais avant d'aller plus avant, et de chercher, comme il se doit, à comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe dans cette France du nouveau siècle, gardons à l'esprit cette donnée : le tremblement de terre politique qu'est le premier tour de l'élection présidentielle a, sur un plan strictement électoral, une seule cause : la dispersion, absurde, de la gauche. Celle-ci, qu'on la considère dans ses limites « modérées » ou en incluant l'extrême gauche, ne recule pas, d'un scrutin présidentiel à l'autre ; alors que la droite modérée perd de cinq à dix points par rapport aux scrutins précédents. Ce sont ainsi 44 % des Français qui ne seront pas représentés au second tour. M. Le Pen n'est donc là que parce que Jean-Pierre Chevènement l'a permis, lui qui a choisi de se séparer de celui qui, en 1997, l'avait tiré de l'oubli ; un Jean-Pierre Chevènement qui est allé au bout de son élitisme dévoyé, en proclamant : « Sortez les sortants », soit le slogan de Jean-Marie Le Pen depuis 1956. Et que dire de Christiane Taubira, dont les voix auraient suffi à faire que la compétition du second tour reste ouverte, et qui ne fut candidate que parce que, après tout, puisque tout le monde y allait de sa candidature, pourquoi ne pas y aller de la sienne... La gauche est donc d'abord victime d'elle-même et de l'esprit boutiquier qui a été celui des dirigeants de ses différentes composantes qui, tous, ont eu à coeur de se démarquer, donc de critiquer Lionel Jospin et son bilan. Ils ont été entendus. Mais il n'y avait pas de fatalité en la matière, comme en beaucoup d'autres. Il a simplement manqué des dirigeants à la hauteur de l'enjeu. En démocratie, bien entendu, le suffrage universel est souverain. Il s'impose donc, et s'imposera ; mais chacun reste libre d'apprécier le jugement des électeurs, au nom de valeurs supérieures ; celles qui, par exemple, fondent l'existence d'un Conseil constitutionnel. De ce point de vue, le vote du 21 avril est injuste. Et dangereux. Une fois la fièvre du dimanche retombée, en effet, le bilan de Lionel Jospin restera. Comme celui, riche, d'une gauche de gouvernement qui a su tenir l'essentiel de ses engagements, qui a su faire l'euro et les trente-cinq heures, faire reculer le chômage, accompagner la relance de la croissance et apporter de nouveaux droits - de la couverture maladie universelle à l'allocation pour personnes dépendantes, en passant par le congé paternité ou les emplois-jeunes. Bref, Lionel Jospin a, un temps, su renouer avec une politique réformatrice qui, après tant d'années de crise, a réconcilié progrès économique et progrès social. Le travail mais aussi la manière de Lionel Jospin - faite d'austérité et de dignité - comme son départ de la vie publique conforme à l'éthique qu'il a fait prévaloir pendant son long bail à Matignon, méritent le respect. Il n'y aura pas, comme pour l'actuel occupant de l'Elysée, de troisième tentative pour Lionel Jospin, qui rompt ainsi avec une tradition politique nationale bien établie. Le reproche que l'on peut d'ailleurs adresser à la gauche, et en premier lieu à Lionel Jospin lui-même, est de ne pas avoir accompagné ce travail de l'indispensable pédagogie, inséparable de toute démarche mendésiste, et de s'être trop préoccupé - contradiction aussi ancienne que la gauche en France - d'une extrême gauche purement incantatoire et, dans sa version Laguiller, sectaire. Une gauche qui répugnerait aux contraintes de la gestion se condamnerait aux oubliettes de l'Histoire. Le vote du 21 avril est aussi, par le niveau d'audience atteint par l'extrême droite, une énigme ; et un danger majeur pour quiconque aspire à gouverner ce pays sans renier les valeurs universelles dont il se réclame. Deux fronts sont ouverts, deux plaies béantes, toutes deux politiques. Le premier front est classique, et met en regard les attentes du corps social et les infrastructures politiques, telles que nous les connaissons, et dont nous savons qu'elles devraient être puissamment réformées pour faire sa juste part à la revendication d'autonomie qui est celle aussi bien des collectivités que des individus. Pour faire face à la montée des micro-corporatismes, il faudra bien se convertir à une véritable et puissante décentralisation. La politique n'a de sens que si elle parvient à faire sentir son influence - si possible positive - sur la vie de la population, et si elle offre à celle-ci une perspective, des choix qu'elle soit à même de maîtriser. Or la crise actuelle est surtout celle du découragement, du sentiment d'inutilité. De nouvelles formes d'action peuvent réunir des foules, dès lors qu'elles donnent l'impression, fût-ce au prix de raisonnements rapides et parfois trop simples, qu'il s'agit de peser sur le cours des choses. Ainsi un débat essentiel pour l'avenir a lieu depuis plusieurs mois : il s'agit de la confrontation, au sein de la Commission de Bruxelles, entre « libéraux » et « régulateurs » ; autrement dit, comment armer l'Union européenne face à la mondialisation. Or ce débat a été absent de la campagne. S'il a surgi, c'est... à Barcelone, face à 300 000 manifestants. Peut-on suggérer plus clairement que le débat politique franco-français est largement vidé de son sens ? Le second front est plus lourd. Il est résumé dans le livre de l'historien Benjamin Stora, Le Transfert de mémoire, qui met en lumière une tendance de fond à l'oeuvre dans la société française : le transfert, en « métropole », d'une mémoire coloniale, avec un élément constitutif de celle-ci : la peur communautarisée du « petit blanc » et le sentiment d'abandon qui lui est lié ; l'angoisse identitaire face à l'islam, le refus de la diversité culturelle - et ethnique - de la France d'aujourd'hui adossé à la tradition jacobine d'assimilation. Le refus d'assumer cette nouvelle société a été amplifié par le choc du 11 septembre, puis par le transfert en France du conflit du Proche-Orient, avec son lot de glissements conduisant à l'enfermement identitaire. De ce point de vue, les propos du président du CRIF, Roger Cukierman, au quotidien Haaretz, proclamant que le score de Le Pen « est un message aux musulmans pour qu'ils se tiennent tranquilles », ajoutant que cela servirait à « réduire » l'antisémitisme illustre, de façon choquante et irresponsable, cette dérive. Pour la gauche, momentanément écartée si elle sait éviter les règlements de compte et rassembler ses forces, comme pour la droite désormais forte de son champion, une gauche et une droite « de gouvernement » qui croyaient pouvoir s'affronter comme si de rien n'était, l'enjeu est bien là, celui de la cohésion du pays, donc de l'intégration. Et maintenant ? Jacques Chirac va se succéder à lui-même. Ainsi le président qui suscite la plus faible adhésion de toute l'histoire de la Cinquième République, celui qui pendant sept ans a présidé à l'affaiblissement de la fonction présidentielle, sera le président le mieux élu de notre longue histoire politique. Ayant fait sa propre campagne, aussi consciencieusement que celle de Jean-Marie Le Pen, en martelant le thème de l'insécurité, Jacques Chirac est face à un choix capital. Il peut faire comme les siens, au soir du premier tour, qui ont rivalisé dans la surenchère droitière et sécuritaire, au risque une fois de plus de permettre à Le Pen d'expliquer que l' « original » vaut mieux que la copie, et d'entretenir ainsi le courant et toutes les dérives. Il peut aussi choisir de restaurer sa fonction, et son propre crédit. Dans ses premières paroles, il s'est placé au-delà de son camp. Au-dessus des calculs politiciens. Comme s'il était désormais conscient qu'il lui reviendra de représenter la droite et la gauche. Son histoire personnelle était jusqu'à présent celle d'une carrière politique, avec des moyens que la morale publique réprouve. Le voilà qui soudain tutoie l'Histoire. Et peut enfin jouer le rôle dont il a rêvé : être président d'une République qu'il faut réformer, pour la faire de nouveau aimer. C'est ce que nous souhaitons. Pour que ce beau pays qu'est la France, avec toutes les couleurs qui l'habitent et qui forgent déjà son avenir, garde le cap de la raison et du progrès. JEAN-MARIE COLOMBANI Le Monde du 23 avril 2002
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- En janvier 1976, lors de la parution de son roman, La Valse aux adieux, l'écrivain tchèque Milan Kundera déclarait : « Dans la vie, l'homme est continuellement coupé de son propre passé et de celui de l'humanité. Le roman permet de soigner cette blessure. » L'opinion de Kundera sur la fonction de l'oeuvre romanesque rejoint-elle votre expérience personnelle de lecteur ?
- En janvier 1976, lors de la parution de son roman La Vazlse aux Adieux, l'écrivain tchèque Milan Kundera déclarait: Dans la vie, l'homme est continuellement coupé de son propre passé et de celui de l'humanité. Le roman permet de soigner cette blessure. L'opinion de Kundera sur la fonction de l'oeuvre romanesque rejoint-elle votre expérience de lecteur ?
- Dans son essai critique Sur Racine, Roland Barthes qualifie Bérénice de « tragédie de l'aphasie » ; Jean Starobinski, quant à lui, souligne « que dans le théâtre français classique, et singulièrement chez Racine, les gestes tendent à disparaître au profit du langage, il faut ajouter au profit du regard. Les scènes chez Racine sont des « entrevues ». Les personnes du drame se parlent et s'entre-regardent mais les regards échangés ont valeur d'étreinte et de blessure... Ils troublent les
- GUISEFrançois Ier de Lorraine, deuxième duc de (1519-18 février 1563)Homme de guerreC'est à une blessure reçue lors du siège de Boulogne en 1545, qu'il doit d'être surnommé le Balafré.
- GUISE, François Ier de Lorraine, 2e duc de(17 février 1519-24 février 1563)Homme de guerreC'est à une blessure reçue lors du siège de Boulogne en 1545, qu'il doitd'être surnommé le Balafré.