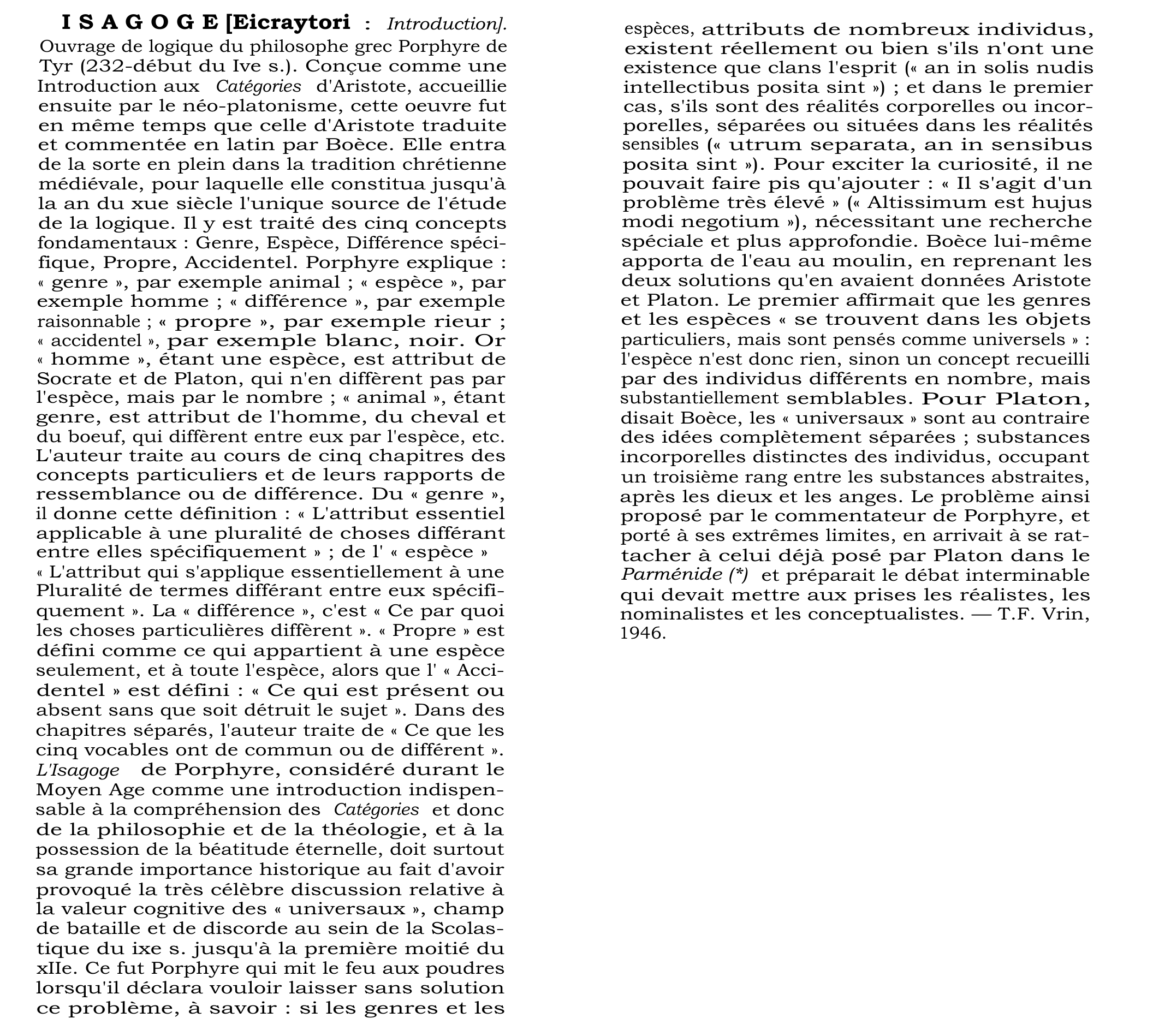ISAGOGE
Publié le 16/05/2020
Extrait du document
«
1 / 2
I S A G O G E [Eicraytori
:
Introduction].
Ouvrage de logique du philosophe grec Porphyre de
Tyr (232-début du Ive s.).
Conçue comme une
Introduction aux
Catégories
d'Aristote, accueillie
ensuite par le néo-platonisme, cette oeuvre fut
en même temps que celle d'Aristote traduite
et commentée en latin par Boèce.
Elle entra
de la sorte en plein dans la tradition chrétienne
médiévale, pour laquelle elle constitua jusqu'à
la an du xue siècle l'unique source de l'étude
de la logique.
Il y est traité des cinq concepts
fondamentaux : Genre, Espèce, Différence spéci-
fique, Propre, Accidentel.
Porphyre explique :
«
genre », par exemple animal ; « espèce », par
exemple homme ; « différence », par exemple
raisonnable ;
« propre », par exemple rieur ;
«
accidentel »,
par exemple blanc, noir.
Or
«
homme », étant une espèce, est attribut de
Socrate et de Platon, qui n'en diffèrent pas par
l'espèce, mais par le nombre ; « animal », étant
genre, est attribut de l'homme, du cheval et
du boeuf, qui diffèrent entre eux par l'espèce, etc.
L'auteur traite au cours de cinq chapitres des
concepts particuliers et de leurs rapports de
ressemblance ou de différence.
Du « genre »,
il
donne cette définition : « L'attribut essentiel
applicable à une pluralité de choses différant
entre elles spécifiquement » ; de l' « espèce »
«
L'attribut qui s'applique essentiellement à une
Pluralité de termes différant entre eux spécifi-
quement ».
La « différence », c'est « Ce par quoi
les choses particulières diffèrent ».
« Propre » est
défini comme ce qui appartient à une espèce
seulement, et à toute l'espèce, alors que l' « Acci-
dentel » est défini : « Ce qui est présent ou
absent sans que soit détruit le sujet ».
Dans des
chapitres séparés, l'auteur traite de « Ce que les
cinq vocables ont de commun ou de différent ».
L'Isagoge
de Porphyre, considéré durant le
Moyen Age comme une introduction indispen-
sable à la compréhension des
Catégories
et donc
de la philosophie et de la théologie, et à la
possession de la béatitude éternelle, doit surtout
sa grande importance historique au fait d'avoir
provoqué la très célèbre discussion relative à
la valeur cognitive des « universaux », champ
de bataille et de discorde au sein de la Scolas-
tique du ixe s.
jusqu'à la première moitié du
xIIe.
Ce fut Porphyre qui mit le feu aux poudres
lorsqu'il déclara vouloir laisser sans solution
ce problème, à savoir : si les genres et les
espèces,
attributs de nombreux individus,
existent réellement ou bien s'ils n'ont une
existence que clans l'esprit (« an in solis nudis
intellectibus posita sint ») ; et dans le premier
cas, s'ils sont des réalités corporelles ou incor-
porelles, séparées ou situées dans les réalités
sensibles
(« utrum separata, an in sensibus
posita sint »).
Pour exciter la curiosité, il ne
pouvait faire pis qu'ajouter : « Il s'agit d'un
problème très élevé » (« Altissimum est hujus
modi negotium »), nécessitant une recherche
spéciale et plus approfondie.
Boèce lui-même
apporta de l'eau au moulin, en reprenant les
deux solutions qu'en avaient données Aristote
et Platon.
Le premier affirmait que les genres
et les espèces « se trouvent dans les objets
particuliers, mais sont pensés comme universels » :
l'espèce n'est donc rien, sinon un concept recueilli
par des individus différents en nombre, mais
substantiellement
semblables.
Pour Platon,
disait Boèce, les « universaux » sont au contraire
des idées complètement séparées ; substances
incorporelles distinctes des individus, occupant
un troisième rang entre les substances abstraites,
après les dieux et les anges.
Le problème ainsi
proposé par le commentateur de Porphyre, et
porté à ses extrêmes limites, en arrivait à se rat-
tacher à celui déjà posé par Platon dans le
Parménide (*)
et préparait le débat interminable
qui devait mettre aux prises les réalistes, les
nominalistes et les conceptualistes.
— T.F.
Vrin,
1946.
2 / 2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓