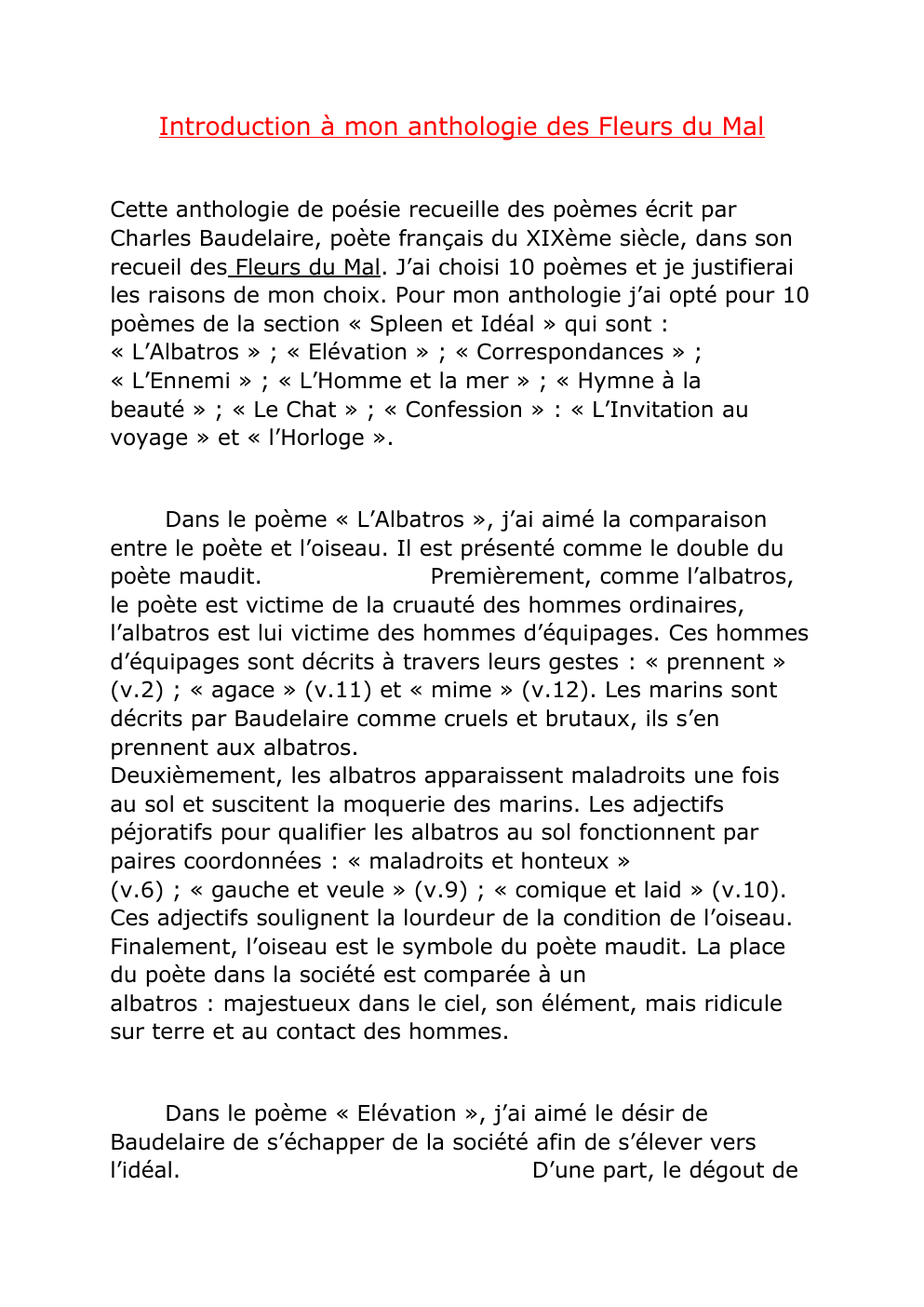Introduction à mon anthologie des Fleurs du Mal
Publié le 22/06/2024
Extrait du document
«
Introduction à mon anthologie des Fleurs du Mal
Cette anthologie de poésie recueille des poèmes écrit par
Charles Baudelaire, poète français du XIXème siècle, dans son
recueil des Fleurs du Mal.
J’ai choisi 10 poèmes et je justifierai
les raisons de mon choix.
Pour mon anthologie j’ai opté pour 10
poèmes de la section « Spleen et Idéal » qui sont :
« L’Albatros » ; « Elévation » ; « Correspondances » ;
« L’Ennemi » ; « L’Homme et la mer » ; « Hymne à la
beauté » ; « Le Chat » ; « Confession » : « L’Invitation au
voyage » et « l’Horloge ».
Dans le poème « L’Albatros », j’ai aimé la comparaison
entre le poète et l’oiseau.
Il est présenté comme le double du
poète maudit.
Premièrement, comme l’albatros,
le poète est victime de la cruauté des hommes ordinaires,
l’albatros est lui victime des hommes d’équipages.
Ces hommes
d’équipages sont décrits à travers leurs gestes : « prennent »
(v.2) ; « agace » (v.11) et « mime » (v.12).
Les marins sont
décrits par Baudelaire comme cruels et brutaux, ils s’en
prennent aux albatros.
Deuxièmement, les albatros apparaissent maladroits une fois
au sol et suscitent la moquerie des marins.
Les adjectifs
péjoratifs pour qualifier les albatros au sol fonctionnent par
paires coordonnées : « maladroits et honteux »
(v.6) ; « gauche et veule » (v.9) ; « comique et laid » (v.10).
Ces adjectifs soulignent la lourdeur de la condition de l’oiseau.
Finalement, l’oiseau est le symbole du poète maudit.
La place
du poète dans la société est comparée à un
albatros : majestueux dans le ciel, son élément, mais ridicule
sur terre et au contact des hommes.
Dans le poème « Elévation », j’ai aimé le désir de
Baudelaire de s’échapper de la société afin de s’élever vers
l’idéal.
D’une part, le dégout de
la société est un thème récurrent dans le poème.
Il est désigné
implicitement comme étant un agent causal du désir d’évasion
et du Spleen : « envole-toi bien loin de ces miasmes
morbides » (v.9).
La métaphore désigne la société comme
étouffante tels des miasmes.
D’autre part, on retrouve un désir d’évasion.
L’accumulation
des termes « montagne » ; « bois » ; « nuages » ; « mers »
(v.2) accentue le désir de libération, de s’envoler au-dessus de
tout.
Enfin, le poète est à la recherche de l’idéal.
L’idéal purifie, rend
l’être qui l’atteint meilleur et plus heureux.
: « purifier »
(v.10) ; « pure » et « divine » (v.11).
On retrouve le champ
lexical de la pureté qui souligne l’idée que l’idéal purifie.
Dans le poème « Correspondances », j’ai trouvé
surprenant les correspondances appelées aussi synesthésies,
qui désignent les rapports entre le monde matériel et le monde
spirituel.
Ce
poème est un parfait exemple du symbolisme baudelairien.
Par
le biais d’un dialogue entre l’homme et la nature, il expose
habilement les principes de la synesthésie, notamment au vers
8 : « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent ».
On
voit là une personnification des parfums, des couleurs et des
sons car ils se parlent.
Dans ce vers, on remarque une véritable
superposition des sens qui a pour effet de plonger le lecteur
dans la forêt du vers 3.
Baudelaire pense que la
nature détient le pouvoir de transporter l’esprit et les sens de
l’homme.
Dans le poème « L’Ennemi », j’ai aimé la façon dont le temps
est présenté comme l’ennemi que l’Homme doit craindre.
D’abord, le temps est personnifié dans ce sonnet voire allégorisé,
comme l’indique la présence de la majuscule au vers 12 : « Le
Temps mange la vie ».
Le temps occupe une position dominante car
« Le Temps » est sujet du verbe manger alors que « la vie » est
complément d’objet direct, cette syntaxe met en valeur la
supériorité du temps sur la vie.
De plus, le temps est redoutable dans le poème car il est décrit
comme un vampire.
On retrouve le champ lexical de la nourriture :
« fruits » (v.4) ; « aliments » (v.11) : « mange » (v.12) et
« ronge » (v.13).
Cela renforce l’idée que le temps est un vampire
qui se nourrit du sang du poète, de sa personne et de sa vie.
Enfin, le poète est angoissé face au passage du temps :
« pelle » (v.6) ; « terres » (v.7) ; « creuse » (v.8) et « tombeaux »
(v.8).
On retrouve le champ lexical de l’enterrement et de la mort
qui sert à renforcer l’idée que le poète serait angoissé.
Dans le poème « L’Homme et la mer », j’ai aimé les
correspondances entre l’Homme et la mer.
Premièrement, dès le titre ils sont associés et dans les deux
premières strophes, Baudelaire utilise le pronom « tu » car il
s’adresse à l’Homme puis dans les deux dernières strophes, il
passe au pronom « vous » pour s’adresser à l’Homme et la mer
qui sont alors réunis en ensemble fusionnel.
Deuxièmement, on observe une métaphore entre l’Homme et la
mer :....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Anthologie poetique des Fleurs du mal Charles Baudelaire
- Anthologie, les fleurs du mal de Charles Baudelaire
- Introduction de texte « L’Albatros », Les Fleurs du Mal de Baudelaire
- vénus anadyomène: Séquence 1 : Etude d’une œuvre intégrale – Les Fleurs du mal (1857) de Charles Baudelaire
- Les Fleurs du Mal lien avec tableaux de l'Europe du Nord: vin, voyage, femmes