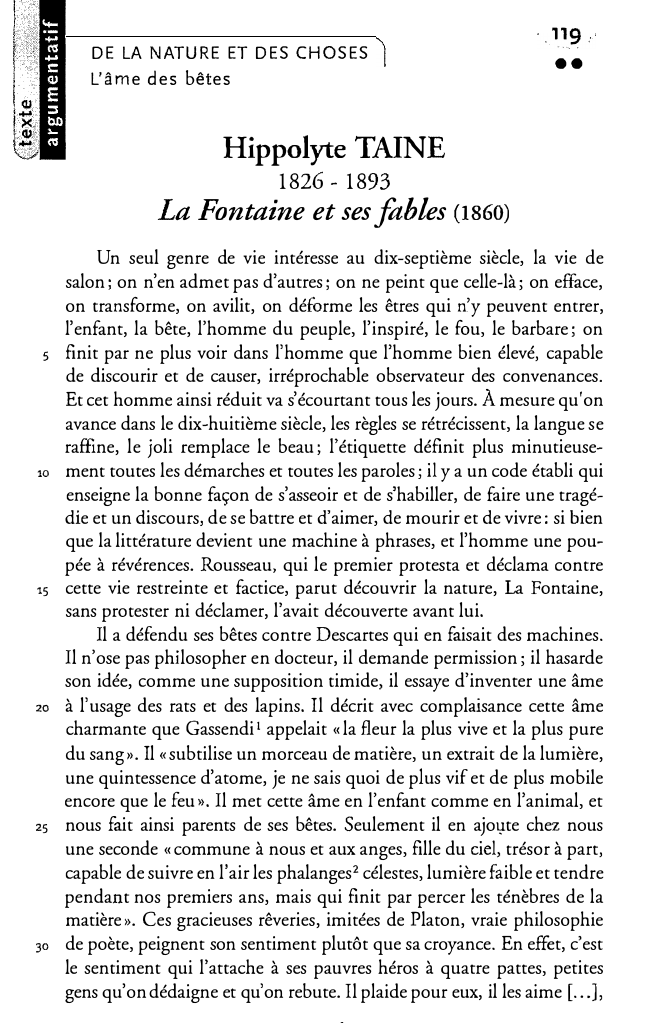Hippolyte TAINE 1826- 1893 La Fontaine et ses fables (1860) - commentaire
Publié le 07/07/2020

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Hippolyte TAINE 1826- 1893 La Fontaine et ses fables (1860) - commentaire. Ce document contient 2223 mots soit 4 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Philosophie.
« Hippolyte TAINE 1826- 1893 La Fontaine et ses fables (1860) Un seul genre de vie intéresse au dix-septième siècle, la vie de salon; on n'en admet pas d'autres; on ne peint que celle-là; on efface, on transforme, on avilit, on déforme les êtres qui n'y peuvent entrer, l'enfant, la bête, l'homme du peuple, l'inspiré, le fou, le barbare; on s finit par ne plus voir dans l'homme que l'homme bien élevé, capable de discourir et de causer, irréprochable observateur des convenances. Et cet homme ainsi réduit va s'écourtant tous les jours. À mesure qu'on avance dans le dix-huitième siècle, les règles se rétrécissent, la langue se raffine, le joli remplace le beau; l'étiquette définit plus minutieuse-10 ment toutes les démarches et toutes les paroles; il y a un code établi qui enseigne la bonne façon de s'asseoir et de s'habiller, de faire une tragédie et un discours, de se battre et d'aimer, de mourir et de vivre: si bien que la littérature devient une machine à phrases, et l'homme une poupée à révérences. Rousseau, qui le premier protesta et déclama contre 15 cette vie restreinte et factice, parut découvrir la nature, La Fontaine, sans protester ni déclamer, l'avait découverte avant lui. Il a défendu ses bêtes contre Descartes qui en faisait des machines. Il n'ose pas philosopher en docteur, il demande permission; il hasarde son idée, comme une supposition timide, il essaye d'inventer une âme 20 à l'usage des rats et des lapins. Il décrit avec complaisance cette âme charmante que Gassendi 1 appelait « la fleur la plus vive et la plus pure du sang». Il «subtilise un morceau de matière, un extrait de la lumière, une quintessence d'atome, je ne sais quoi de plus vif et de plus mobile encore que le feu». Il met cette âme en l'enfant comme en l'animal, et 25 nous fait ainsi parents de ses bêtes. Seulement il en ajoute chez nous une seconde « commune à nous et aux anges, fille du ciel, trésor à part, capable de suivre en l'air les phalanges2 célestes, lumière faible et tendre pendant nos premiers ans, mais qui finit par percer les ténèbres de la matière». Ces gracieuses rêveries, imitées de Platon, vraie philosophie 30 de poète, peignent son sentiment plutôt que sa croyance. En effet, c'est le sentiment qui l'attache à ses pauvres héros à quatre pattes, petites gens qu'on dédaigne et qu'on rebute. Il plaide pour eux, il les aime [...], à force de naturel, il comprenait la nature, et voyait l'âme où elle est, c'est-à-dire partout. 35 Nous avons fait comme lui, à force de science et d'expérience. Depuis deux cents ans les êtres qu'on séparait au dix-septième siècle se sont rejoints, et les choses ont repris leur parenté naturelle. Elles sortent les unes des autres, celles d'en haut de celles d'en bas, en sorte que 1a plus noble prend sa substance et sa nourriture dans la plus basse, et 40 qu'ensemble elles forment une chaîne dont on ne peut détacher aucun anneau. I. Philosophe et savant du XVIIe siècle. - 2. Formations compactes. ...»
«
DE
LA NATURE ET DES CHOSES
L'âme des bêtes
Hippolyte TAINE
1826-1893
La Fontaine et ses fables (1860) n
g .
••
Un seul genre de vie intéresse au dix-septième siècle, la vie de
salon; on n'en admet pas d'autres; on ne peint que celle-là; on efface,
on transforme, on avilit, on déforme les êtres qui n'y peuvent entrer,
l'enfant, la bête, l'homme du peuple, l'inspiré, le fou, le barbare; on
s �ma~
par ne plus voir dans l'homme que l'homme bien élevé, capable
de discourir et de causer, irréprochable observateur des convenances.
Et cet homme ainsi réduit va s' écourtant tous les jours.
À mesure qu'on
avance dans le dix-huitième siècle, les règles se rétrécissent, la langue se
raffine, le joli remplace le beau; l'étiquette dé�ma} plus minutieuse-
10 ment toutes les démarches et toutes les paroles; il y a un code établi qui
enseigne la bonne façon de s'asseoir et de s'habiller, de faire une tragé
die et un discours, de se battre et d'aimer, de mourir et de vivre: si bien
que la littérature devient une machine à phrases, et l'homme une pou
pée à révérences.
Rousseau, qui le premier protesta et déclama contre
15 cette vie restreinte et factice, parut découvrir la nature, La Fontaine,
sans protester ni déclamer, l'avait découverte avant lui.
Il a défendu ses bêtes contre Descartes qui en faisait des machines.
Il n'ose pas philosopher en docteur, il demande permission; il hasarde
son idée, comme une supposition timide, il essaye d'inventer une âme
20 à l'usage des rats et des lapins.
Il décrit avec complaisance cette âme
charmante que Gassendi I
appelait « la fleur la plus vive et la plus pure
du sang».
Il «subtilise un morceau de matière, un extrait de la lumière,
une quintessence d'atome, je ne sais quoi de plus vif et de plus mobile
encore que le feu».
Il met cette âme en l'enfant comme en l'animal, et
25 nous fait ainsi parents de ses bêtes.
Seulement il en ajotJte chez nous
une seconde « commune à nous et aux anges, �hhR du ciel, trésor à part,
capable de suivre en l'air les phalanges 2
célestes, lumière faible et tendre
pendarit nos premiers ans, mais qui �ma} par percer les ténèbres de la
matière».
Ces gracieuses rêveries, imitées de Platon, vraie philosophie
30 de poète, peignent son sentiment plutôt que sa croyance.
En effet, c'est
le sentiment qui l'attache à ses pauvres héros à quatre pattes, petites
gens qu'on dédaigne et qu'on rebute.
Il plaide pour eux, il les aime [ ...
],
196.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire littéraire les deux amis Fables La Fontaine
- La Fontaine, Fables, Livre VII, « La Cour du Lion ». Commentaire
- L'oeuvre de Taine DE PERSONIS PLATONICIS (1853)LA FONTAINE ET SES FABLES
- LA BELETTE ENTRÉE DANS UN GRENIER (FABLES DE LA FONTAINE) - COMMENTAIRE
- Le vieux chat et la jeune souris - LA FONTAINE, Fables, XII, 5 - commentaire