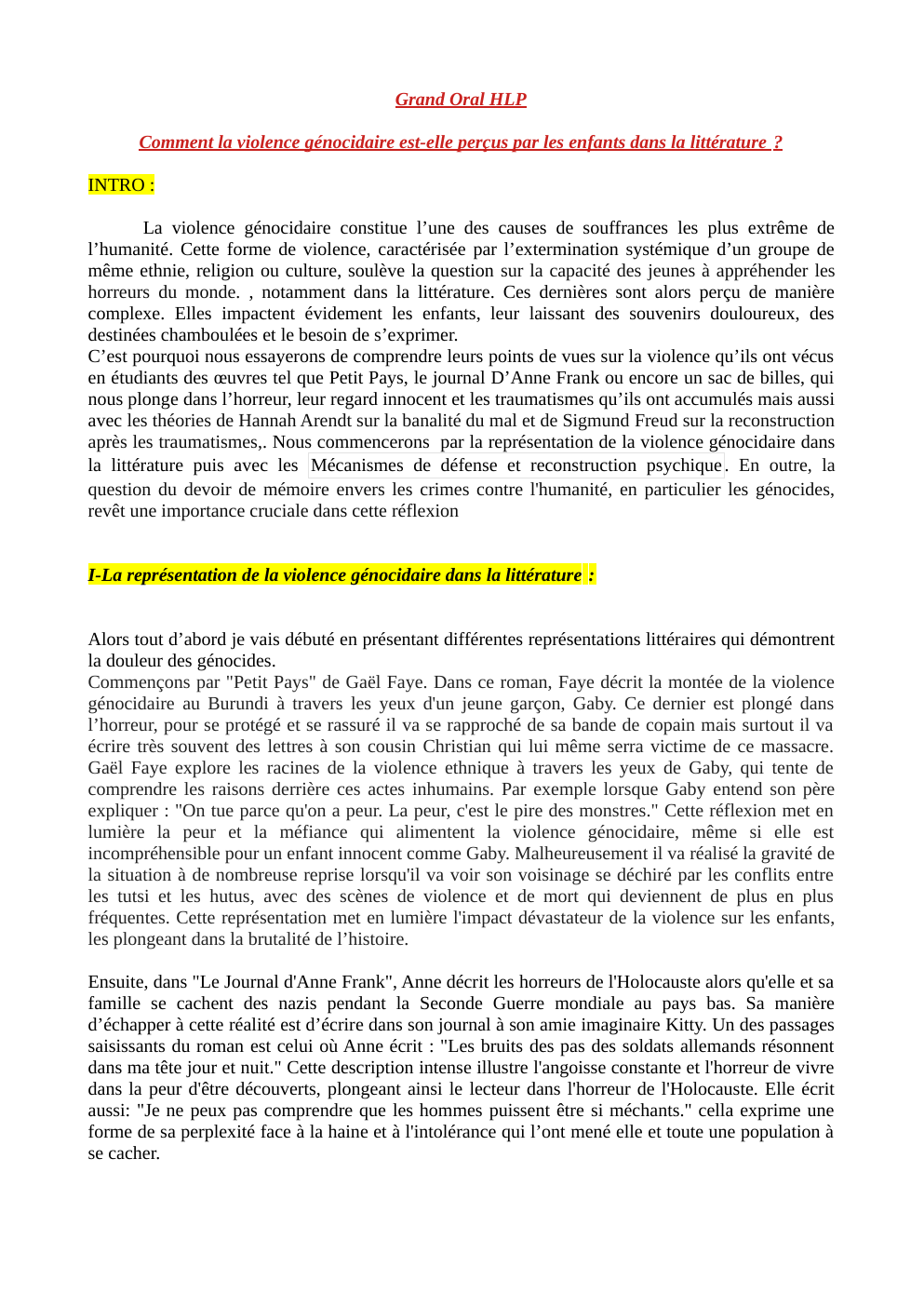Grand Oral HLP Comment la violence génocidaire est-elle perçus par les enfants dans la littérature ?
Publié le 23/04/2025
Extrait du document
«
Grand Oral HLP
Comment la violence génocidaire est-elle perçus par les enfants dans la littérature ?
INTRO :
La violence génocidaire constitue l’une des causes de souffrances les plus extrême de
l’humanité.
Cette forme de violence, caractérisée par l’extermination systémique d’un groupe de
même ethnie, religion ou culture, soulève la question sur la capacité des jeunes à appréhender les
horreurs du monde.
, notamment dans la littérature.
Ces dernières sont alors perçu de manière
complexe.
Elles impactent évidement les enfants, leur laissant des souvenirs douloureux, des
destinées chamboulées et le besoin de s’exprimer.
C’est pourquoi nous essayerons de comprendre leurs points de vues sur la violence qu’ils ont vécus
en étudiants des œuvres tel que Petit Pays, le journal D’Anne Frank ou encore un sac de billes, qui
nous plonge dans l’horreur, leur regard innocent et les traumatismes qu’ils ont accumulés mais aussi
avec les théories de Hannah Arendt sur la banalité du mal et de Sigmund Freud sur la reconstruction
après les traumatismes,.
Nous commencerons par la représentation de la violence génocidaire dans
la littérature puis avec les Mécanismes de défense et reconstruction psychique .
En outre, la
question du devoir de mémoire envers les crimes contre l'humanité, en particulier les génocides,
revêt une importance cruciale dans cette réflexion
I-La représentation de la violence génocidaire dans la littérature :
Alors tout d’abord je vais débuté en présentant différentes représentations littéraires qui démontrent
la douleur des génocides.
Commençons par "Petit Pays" de Gaël Faye.
Dans ce roman, Faye décrit la montée de la violence
génocidaire au Burundi à travers les yeux d'un jeune garçon, Gaby.
Ce dernier est plongé dans
l’horreur, pour se protégé et se rassuré il va se rapproché de sa bande de copain mais surtout il va
écrire très souvent des lettres à son cousin Christian qui lui même serra victime de ce massacre.
Gaël Faye explore les racines de la violence ethnique à travers les yeux de Gaby, qui tente de
comprendre les raisons derrière ces actes inhumains.
Par exemple lorsque Gaby entend son père
expliquer : "On tue parce qu'on a peur.
La peur, c'est le pire des monstres." Cette réflexion met en
lumière la peur et la méfiance qui alimentent la violence génocidaire, même si elle est
incompréhensible pour un enfant innocent comme Gaby.
Malheureusement il va réalisé la gravité de
la situation à de nombreuse reprise lorsqu'il va voir son voisinage se déchiré par les conflits entre
les tutsi et les hutus, avec des scènes de violence et de mort qui deviennent de plus en plus
fréquentes.
Cette représentation met en lumière l'impact dévastateur de la violence sur les enfants,
les plongeant dans la brutalité de l’histoire.
Ensuite, dans "Le Journal d'Anne Frank", Anne décrit les horreurs de l'Holocauste alors qu'elle et sa
famille se cachent des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale au pays bas.
Sa manière
d’échapper à cette réalité est d’écrire dans son journal à son amie imaginaire Kitty.
Un des passages
saisissants du roman est celui où Anne écrit : "Les bruits des pas des soldats allemands résonnent
dans ma tête jour et nuit." Cette description intense illustre l'angoisse constante et l'horreur de vivre
dans la peur d'être découverts, plongeant ainsi le lecteur dans l'horreur de l'Holocauste.
Elle écrit
aussi: "Je ne peux pas comprendre que les hommes puissent être si méchants." cella exprime une
forme de sa perplexité face à la haine et à l'intolérance qui l’ont mené elle et toute une population à
se cacher.
Enfin, dans "Un sac de billes" de Joseph Joffo, les frères Joffo racontent leur fuite de Paris occupé
par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale vers la zone libre.
L’une des premières scène de
violence se passe cette fois si au cœur de la famille, le père met une gifle au plus grand des frères
pour le préparer aux actes violents des nazis .Cette illustration poignante démontre la terreur et la
confrontation à une réalité affreuse, les plongeant ainsi dans l'horreur de la guerre.
Par la suite
similairement aux deux œuvres précédentes on observe leur incompréhension face à l'absurdité et la
cruauté de l'antisémitisme nazi qui a motivé les actes inhumains commis pendant la Shoah par
exemple Joseph écrit: "Ils détestent les Juifs, et ça suffit pour justifier leur haine."
Dans l'ensemble, ces œuvres offrent des perspectives uniques sur l’histoire violente et les
conséquences dévastatrices sur les jeunes individus, qui sont plongés dans l'horreur et qui porteront
les cicatrices de ces traumatismes toute leur vies, malheureusement leur tentative de fuir ces
affreuses étapes de vies ils se retrouvent obligés de s’y confrontés malgré leur incompréhension
face à la cruauté du monde.
Deuxième partie : Mécanismes de défense et reconstruction psychique
Dans les œuvres littéraires que dont nous avons parlé précédamment, la théorie de la banalité du
mal de Hannah Arendt trouve une résonance particulière.
Cette théorie suggère que les actes
monstrueux peuvent être perpétrés non seulement par des individus démoniaques, mais aussi par
des personnes ordinaires, simplement en suivant les ordres ou en se conformant à un système
immoral.
Les enfants, en tant que témoins innocents de ces atrocités, sont confrontés à la difficulté
de comprendre comment des adultes peuvent commettre de tels actes inhumains.
Dans "Un Sac de
Billes", par exemple, les frères Joseph et Maurice Joffo sont confrontés à la cruauté des nazis, dont
les actions semblent incompréhensibles pour des enfants innocents.
Cette incompréhension alimente
leur sentiment de terreur et de désarroi face à un monde où le mal semble banalisé et normalisé.
En effet Les enfants, en raison de leur innocence et de leur manque d'expérience, peuvent avoir du
mal à comprendre la nature véritablement atroce des violences génocidaires.
Dans "Petit Pays",
Gabriel, le jeune protagoniste, est confronté à la brutalité de la guerre civile au Burundi sans
vraiment comprendre les motivations derrière ces actes de violence.
De même, dans "Le Journal
d'Anne Frank", Anne et sa famille sont contraints de se cacher pendant l'holocauste, sans pouvoir
saisir pleinement la portée de la haine et de la discrimination dont ls sont victimes en tant que Juifs.
Cette incompréhension peut entraîner chez les enfants un sentiment de confusion, d'angoisse et de
perte d'innocence alors qu'ils tentent de donner un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Grand oral sujet Hlp: comment la science-fiction tente d’anticiper les dérives possibles de nos sociétés actuelles
- Questions Grand Oral : SES : LES EFFETS D’UNE SOCIALISATION DIFFERENCIE SELON LE RANG SOCIAL ? HLP : POURQUOI EST-CE DIFFICILE DE SE CONNAITREE SOI MEME ?
- grand oral maths modèle malthusien
- Grand oral NSI: la voiture autonome la voiture de demain ?
- grand oral le surbooking