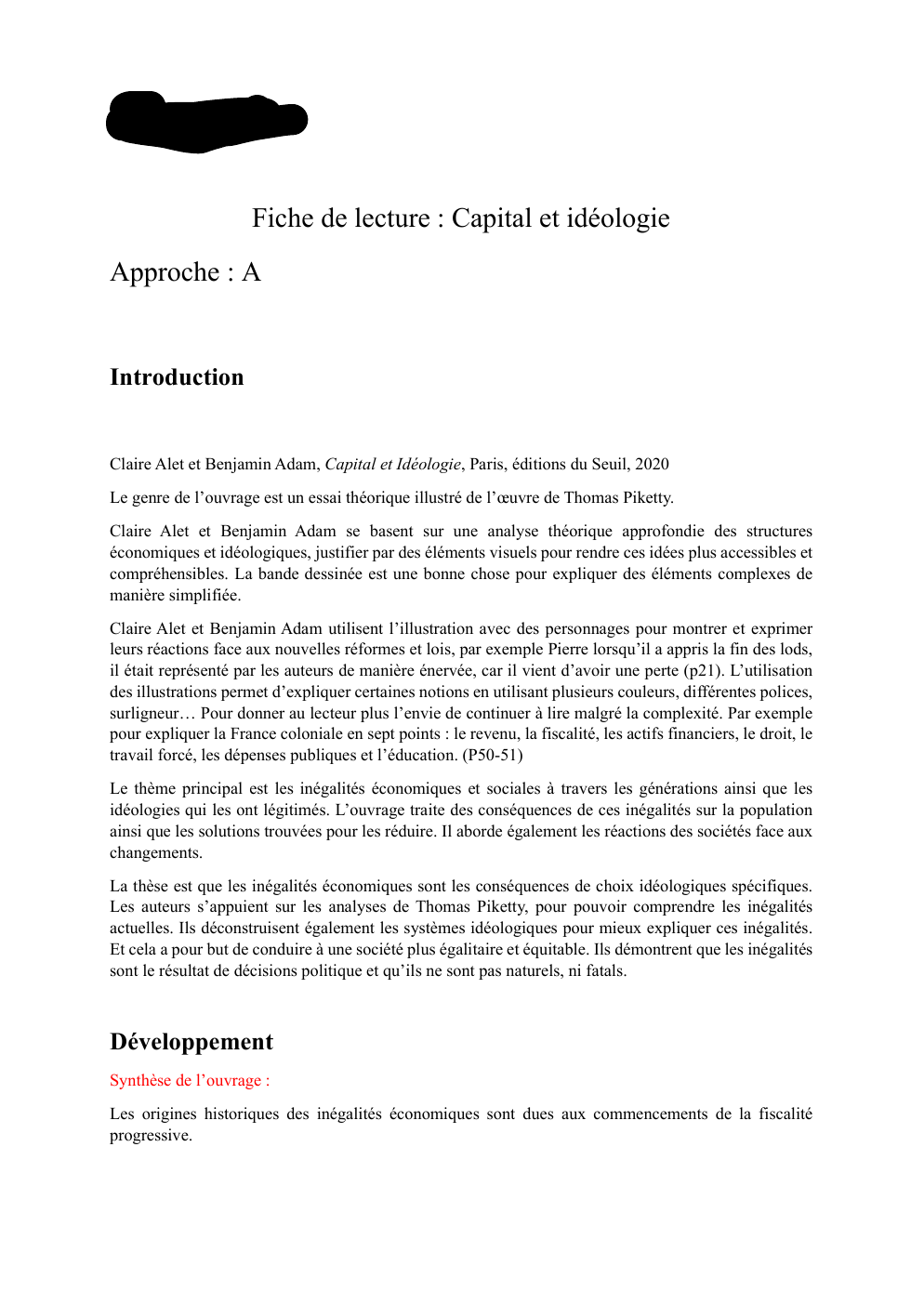fiche de lecture ses: Claire Alet et Benjamin Adam, Capital et Idéologie
Publié le 04/02/2025
Extrait du document
«
Fiche de lecture : Capital et idéologie
Approche : A
Introduction
Claire Alet et Benjamin Adam, Capital et Idéologie, Paris, éditions du Seuil, 2020
Le genre de l’ouvrage est un essai théorique illustré de l’œuvre de Thomas Piketty.
Claire Alet et Benjamin Adam se basent sur une analyse théorique approfondie des structures
économiques et idéologiques, justifier par des éléments visuels pour rendre ces idées plus accessibles et
compréhensibles.
La bande dessinée est une bonne chose pour expliquer des éléments complexes de
manière simplifiée.
Claire Alet et Benjamin Adam utilisent l’illustration avec des personnages pour montrer et exprimer
leurs réactions face aux nouvelles réformes et lois, par exemple Pierre lorsqu’il a appris la fin des lods,
il était représenté par les auteurs de manière énervée, car il vient d’avoir une perte (p21).
L’utilisation
des illustrations permet d’expliquer certaines notions en utilisant plusieurs couleurs, différentes polices,
surligneur… Pour donner au lecteur plus l’envie de continuer à lire malgré la complexité.
Par exemple
pour expliquer la France coloniale en sept points : le revenu, la fiscalité, les actifs financiers, le droit, le
travail forcé, les dépenses publiques et l’éducation.
(P50-51)
Le thème principal est les inégalités économiques et sociales à travers les générations ainsi que les
idéologies qui les ont légitimés.
L’ouvrage traite des conséquences de ces inégalités sur la population
ainsi que les solutions trouvées pour les réduire.
Il aborde également les réactions des sociétés face aux
changements.
La thèse est que les inégalités économiques sont les conséquences de choix idéologiques spécifiques.
Les auteurs s’appuient sur les analyses de Thomas Piketty, pour pouvoir comprendre les inégalités
actuelles.
Ils déconstruisent également les systèmes idéologiques pour mieux expliquer ces inégalités.
Et cela a pour but de conduire à une société plus égalitaire et équitable.
Ils démontrent que les inégalités
sont le résultat de décisions politique et qu’ils ne sont pas naturels, ni fatals.
Développement
Synthèse de l’ouvrage :
Les origines historiques des inégalités économiques sont dues aux commencements de la fiscalité
progressive.
À la suite de la révolution industrielle, les inégalités ont augmenté, les pays européens aux débuts du
XXe siècle ont dû imposer des taux plus élevés aux revenus les plus élevés.
C’est ce qu’on appelle «
l’impôt progressif » qui était représenté comme une clé pour diminuer les inégalités : « Il n’augmente
que dans les tranches de richesse les plus élevées, c’est un impôt plus redistributif : les plus hauts revenus
sont davantage mis à contribution, pour le bien de toute la société » (p10).
Ce système était mis en place
dans les pays tels que l’Allemagne et le Royaume-Uni, il visait à redistribuer de manière plus équitable
en augmentent les contributions fiscales aux revenus les plus élevés pour pouvoir financer les services
publics essentiels tels que l’éducation, la santé ainsi que les infrastructures.
L’impôt effraie les personnes
dont le revenu est élevé, certain demandent le but de payer pour les autres, de plus il passe d’impôt
proportionnel, qui consiste à appliquer le même taux quel que soit le niveau de richesse, à un impôt plus
égalitaire : « Je suis inquiet.
Ce projet d’impôt progressif, c’est enfin, si on va dans cette direction, qui
sait où ça s’arrêtera ? Ce que je veux dire, c’est : pourquoi au juste, devrions-nous payer pour les autres
? » (P12).
Les réformes et conséquences de l’abolition de l’esclavage ont un rapport avec le début des inégalités
économique.
En effet, l’esclavage représentait une forme extrême d’inégalité économique par exemple
à Saint-Domingue en 1794 « La proportion d’esclaves s’élève à 90 % de la population totale » (p29).
Les sociétés esclavagistes étaient basées autour de l’exploitation des personnes dépourvus de tous les
droits, qui étaient privés de leurs droits ainsi que de leurs ressources.
Cette idéologie démontre comment
les inégalités dans des systèmes économiques basées sur l’exploitation étaient banalisées et normalisées
: « Le projet politique et idéologique est sans ambiguïté : il repose sur la propriété d’êtres humains par
d’autres êtres humains » (p29).
Par la suite, l’abolition de l’esclavage a eu un grand impact dans la lutte
contre ces inégalités extrêmes, cela a permis une grande avancée vers l’égalité.
Au Royaume-Uni en
1833, « l’abolition rime avec compensation », en effet à la fin de l’esclavagisme, on voulait indemniser
les esclaves ou exproprier les propriétaires sans compensation.
Cependant, cela allait provoquer des
conflits dans la société : « Exproprier les propriétaires sans compensation, ou pire, indemniser les
esclaves eux-mêmes pour les souffrances endurées, risquait, de l’avis général de dynamiser tout le
système de propriété.
» (P35).
Donc, pour éviter les problèmes, on utilise l’argument pandorien.
Celuici consiste : « Pour éviter tout risque, surtout, ne changeons rien » (p36).
En Haïti par exemple, la révolte
des esclaves a conduit à l’indépendance, mais le nouvel état devait payer une dette publique imposée
par les puissances coloniales en compensation des pertes économiques causées par l’abolition de
l’esclavage : « Pris à la gorge par les canons, les futurs Haïtiens acceptent.
La somme demandée par la
France est monumentale : 150 millions de francs-ors soit l’équivalent actuel de 40 milliards d’euros »
(p33).
Les versements de cette dette commencent en 1832, celle-ci aura des effets très importants sur
l’économie haïtienne, cela explique le développement très retardé du pays et la maintenance aux niveaux
des inégalités économiques qui n’a pas diminué.
De plus dans notre société, existe des mécanismes qui maintiennent le niveau d’inégalité, par exemple
les structures sociales et économiques mises en place après la révolution.
« Août 1789.
L’abolition des privilèges a été votée ! Demandez les dernières nouvelles ! Pierre a rendezvous avec son frère » (p19).
L’abolition des privilèges était une grande étape dans la réduction des
inégalités sociales en France.
La révolution française a aboli les privilèges de la noblesse ainsi que du
clergé « Dans ces sociétés, dites ternaires, les inégalités étaient justifiées par l’idée d’une
complémentarité entre les trois groupe sociaux » (p18).
L’Ancien Régime était divisé en trois ordres
clergé, noblesse et le tiers état.
Cependant le clergé et la noblesse représenté « moins de 2 % des Français
» (p18) mais « contrôlent la majorité des ressources et des biens » (p18).
En abolissant les droits tels
que les corvées, qui étaient des taches imposées aux paysans sans rémunération : « En plus, il bénéficie
de corvées : les paysans qui exploitent ses terres lui doivent des journées de travail gratuit » (p17).
Les révolutionnaires avaient pour but de réduire les inégalités et détruire une société injuste où la
noblesse et le clergé détenaient le pouvoir et les richesses.
Cependant, malgré cette abolition, l’égalité
instaurée par la Révolution n’a pas mené à une réelle égalité en termes de répartition des richesses.
Les
structures économiques qui ont été mises en place après la Révolution ont souvent renforcé les inégalités.
Par exemple durant la convention entre 1793-1794 le clergé et la noblesse perd tout et les paysans étaient
désormais propriétaires de leurs terres.
Cela n’a duré que 1 an puisqu’entre 1795-1799 « tous, est remis
à plat » (p23) en effet durant le directoire le clergé et la noblesse ont repris leurs propriétés : « Comme
beaucoup de propriétaires d’avant 1789, Pierre récupère progressivement ce qu’il avait perdu » (p23).
Pas seulement la répartition des terres était inégalitaire et cela a renforcé les inégalités, car malgré
l’abolition des privilèges pour les nobles, ils ont pu conserver leur pouvoir économique, grâces à leurs
différents domaines et ainsi que les leurs richesses accumulées auparavant.
La Révolution française a
été l’avènement de la société propriétariste, celle-ci « considère que le droit de propriété est la pierre
angulaire du système social » (p21).
Dans cette nouvelle société, la propriété des terres, de biens était
un rôle central dans la structure sociale.
La Révolution qui avait pour but de réduire les inégalités et
mettre en place une société plus inégalitaire, a au contraire mis en avant l’idée que la liberté individuelle
:« La propriété acquiert un nouveau statut de droit naturel et imprescriptible, parmi ceux définis dans
l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (p20), était liée au droit de posséder
des biens.
Cela a consolidé l’idée qu’avoir des propriétés était comme un pilier de la nouvelle société.
Les politiques économiques et l’accumulation de richesse maintiennent les inégalités et la colonisation
a été l’un des principaux mécanismes.
En effet au XIXe siècle, l’Europe a accumulé une immense
richesse grâce à la colonisation.
L’Europe « au XVIe siècle, ils étaient en guerre 95 % du temps ! »
(p39), pour les financer, ils ont augmenté les impôts et déployer une capacité administrative et fiscale.
Ils mettent en place également l’état moderne, ainsi pour alimenter toutes ces conquêtes le bois est
indispensable ce qui provoque une menace de déforestation dans le continent : « Mais l’unique énergie
qui alimente toute cette conquête est le bois : et à la fin du XVIIIe siècle, la déforestation menace le
continent » (p39).
La colonisation aura pour but de pallier les pénuries.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture de travail salarié et capital de Karl Marx
- Fiche de lecture: Hors de moi de Claire Marin
- HGGSP : Fiche de Lecture article Wagner
- fiches de lecture FICHE N°1 : SIDDARTHA METAMORPHOSES DU MOI
- fiche de lecture 1984 d'Orwell