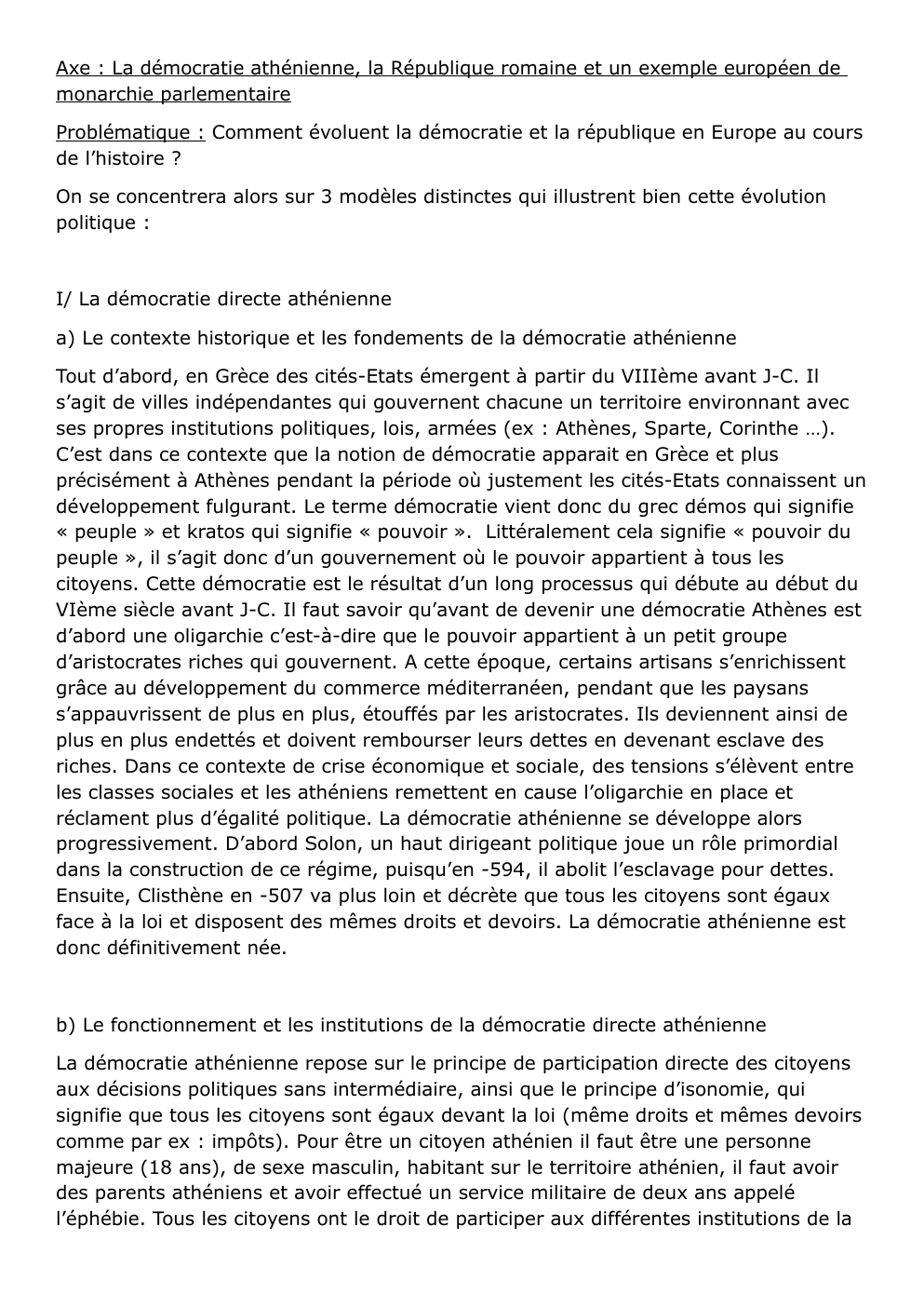exposé sur l'évolution des systèmes politiques
Publié le 13/03/2025
Extrait du document
«
Axe : La démocratie athénienne, la République romaine et un exemple européen de
monarchie parlementaire
Problématique : Comment évoluent la démocratie et la république en Europe au cours
de l’histoire ?
On se concentrera alors sur 3 modèles distinctes qui illustrent bien cette évolution
politique :
I/ La démocratie directe athénienne
a) Le contexte historique et les fondements de la démocratie athénienne
Tout d’abord, en Grèce des cités-Etats émergent à partir du VIIIème avant J-C.
Il
s’agit de villes indépendantes qui gouvernent chacune un territoire environnant avec
ses propres institutions politiques, lois, armées (ex : Athènes, Sparte, Corinthe …).
C’est dans ce contexte que la notion de démocratie apparait en Grèce et plus
précisément à Athènes pendant la période où justement les cités-Etats connaissent un
développement fulgurant.
Le terme démocratie vient donc du grec démos qui signifie
« peuple » et kratos qui signifie « pouvoir ».
Littéralement cela signifie « pouvoir du
peuple », il s’agit donc d’un gouvernement où le pouvoir appartient à tous les
citoyens.
Cette démocratie est le résultat d’un long processus qui débute au début du
VIème siècle avant J-C.
Il faut savoir qu’avant de devenir une démocratie Athènes est
d’abord une oligarchie c’est-à-dire que le pouvoir appartient à un petit groupe
d’aristocrates riches qui gouvernent.
A cette époque, certains artisans s’enrichissent
grâce au développement du commerce méditerranéen, pendant que les paysans
s’appauvrissent de plus en plus, étouffés par les aristocrates.
Ils deviennent ainsi de
plus en plus endettés et doivent rembourser leurs dettes en devenant esclave des
riches.
Dans ce contexte de crise économique et sociale, des tensions s’élèvent entre
les classes sociales et les athéniens remettent en cause l’oligarchie en place et
réclament plus d’égalité politique.
La démocratie athénienne se développe alors
progressivement.
D’abord Solon, un haut dirigeant politique joue un rôle primordial
dans la construction de ce régime, puisqu’en -594, il abolit l’esclavage pour dettes.
Ensuite, Clisthène en -507 va plus loin et décrète que tous les citoyens sont égaux
face à la loi et disposent des mêmes droits et devoirs.
La démocratie athénienne est
donc définitivement née.
b) Le fonctionnement et les institutions de la démocratie directe athénienne
La démocratie athénienne repose sur le principe de participation directe des citoyens
aux décisions politiques sans intermédiaire, ainsi que le principe d’isonomie, qui
signifie que tous les citoyens sont égaux devant la loi (même droits et mêmes devoirs
comme par ex : impôts).
Pour être un citoyen athénien il faut être une personne
majeure (18 ans), de sexe masculin, habitant sur le territoire athénien, il faut avoir
des parents athéniens et avoir effectué un service militaire de deux ans appelé
l’éphébie.
Tous les citoyens ont le droit de participer aux différentes institutions de la
cité.
On retrouve d’abord l’Ecclésia qui représente l’assemblée des citoyens.
Tous les
citoyens peuvent y participer c’est-à-dire environ 40 000 personnes même si
seulement 5 à 6000 y participent régulièrement.
L’Ecclésia se réunit trois ou quatre
fois par mois sur la colline de la Pnyx pour voter les lois, décider de la guerre ou de la
paix ainsi que pour voter l'ostracisme (exclusion de tout citoyen contrevenant aux
règles démocratiques).
Chaque citoyen a le droit d’y débattre et de proposer une loi.
Il y a ensuite la Boulè qui est un conseil populaire composé de 500 citoyens tirés au
sort pour une durée d’un an.
La Boulè examine les propositions de lois, les prépare et
donne son accord pour leur vote.
Les magistrats sont environ 600, certains sont tirés
au sort d’autres élus par l’ecclésia pour une durée d’un an.
Ils font exécuter les
décisions.
Parmi ces magistrats, 10 stratèges sont aussi élus et dirigent les armées
(ils ont le pouvoir militaire).
On retrouve enfin l'Héliée, un tribunal de 6 000 juges
tirés au sort, qui sont chargés de rendre la justice.
Enfin, pour que les plus pauvres
puissent participer à la vie politique, l’homme politique Périclès décide de faire verser
une petite somme d'argent, le misthos, aux citoyens qui participent aux institutions
politiques.
c) Les limites de cette démocratie
Athènes est une démocratie imparfaite car les citoyens représentent seulement 10%
des 300 000 habitants que contient la cité.
Les femmes de citoyens qui représentent
10% de la population ne possèdent pas le statut de citoyennes, elles ne peuvent que
le transmettre à leur fils.
Elles n’ont aucun droit politique, elles sont soumises à
l’autorité masculine et leur rôle est principalement domestique.
Les étrangers que l’on
appelle métèques (18% de la population) sont aussi exclu du droit à la citoyenneté.
Ils peuvent travailler, faire des affaires mais pas participer à la vie politique.
Enfin, les
esclaves ne peuvent pas être citoyens puisqu’ils ne sont même pas libres.
Même s’il y
a une égalité citoyenne, il n’y a aucune égalité sociale, au contraire il y a de grandes
inégalités.
Par ailleurs l’égalité citoyenne n’est même pas réellement respectée
puisque la vie politique est dominée par les plus riches et les orateurs (personnes
éloquentes qui savent parler en public et convaincre) qui obtiennent le plus de votes
pour accéder aux magistratures et qui sont souvent élus plusieurs fois car ils arrivent
à influencer l’assemblée en leur faveur.
Par exemple Périclès, un fin stratège et un
bon orateur a été élu 10 fois.
De plus les plus pauvres mêmes s’ils étaient indemnisés
par le misthos, ils avaient moins de temps pour s’investir pleinement dans les
institutions puisqu’ils devaient travailler.
II/ La république romaine : un modèle oligarchique représentatif
a) La mise en place de la république romaine et son organisation
Pendant la même période que la démocratie athénienne, au VIème siècle avant J-C se
développe aussi un autre système politique avec un rayonnement tout aussi
important : La république Romaine.
Le mot « république » vient d’ailleurs du latin res
publica qui signifie «la chose publique », c’est-à-dire que le pouvoir est une affaire
collective dont l’objectif est de servir l’intérêt général.
En effet, Rome qui à l’origine
est une cité modeste fondée en 753 avant J-C et soumise à un régime monarchique
devient une République en –509 lorsque le roi étrusque Tarquin le Superbe est chassé
du pouvoir par les romains.
Les institutions de cette république sont alors
progressivement mises en place pendant que Rome étend sa domination dans toute
l’Italie.
On retrouve principalement 3 grandes institutions : tout d’abord les comices
qui sont les assemblées des citoyens qui votent les lois, la guerre et la paix et qui
élisent les magistrats.
Ensuite les magistrats administrent la république et proposent
les lois aux comices.
Il y a plusieurs niveaux de magistrats qui ont chacun des rôles
différents.
Ils doivent suivre ce qu’on appelle la carrière des honneurs.
C’est-à-dire
qu’ils ne peuvent pas accéder à une fonction sans avoir exercer la précédente.
Les
principaux magistrats sont les consuls qui dirigent le gouvernement et l’armée.
Enfin,
il y a le Sénat, c’est une assemblée composée d’anciens magistrats issus des familles
riches qui siègent à vie.
L’ensemble de ces institutions se regroupent sur le forum
donc la place publique située à Rome.
Ils dirigent les politiques extérieures, contrôlent
les dépenses de l’Etat et donnent des avis aux magistrats.
La république romaine est
en fait une sorte de synthèse de trois formes politiques.
On retrouve des mécanismes
monarchiques avec des consuls qui exercent un commandement proche d’un pouvoir
royal, des mécanismes aussi oligarchiques puisque le Sénat est composé d’une élite
aristocratique qui est privilégiée et qui a plus de pouvoirs que les simples citoyens, et
enfin des mécanismes démocratiques avec une participation de tous les citoyens dans
le vote et les décisions
b) Un système politique inégalitaire
Tout d’abord il est Au sein même des citoyens, il existe d’importantes inégalités.
Ils
sont divisés en deux catégories : Les plébéiens qui constituent la majorité de la
population (artisans, paysans…) et les patriciens sont issus de vieilles familles
aristocratiques plus riches.
Les patriciens soutiennent le système oligarchique sur
lequel repose en grande partie la république romaine, ce qui leur confère l’avantage
de régner sur les hautes sphères du pouvoir.
En effet, au départ les patriciens étaient
les seuls à avoir accès aux magistratures importantes tandis que les plébéiens étaient
exclus des institutions dirigeantes.
Cette inégalité a donc entraîné une révolte de la
part des plébéiens qui aboutit en -449 à la rédaction de la loi des Douze Tables qui
affaiblit la domination des patriciens et renforce le rôle des tribuns de la plèbe qui
sont des magistrats élus par les plébéiens.
Ces tribuns ont désormais le droit de
bloquer les décisions des autres magistrats.
Malgré une progression, les inégalités
entre les citoyens persistent toujours puisque les plus....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Exposé 3 – La démocratie et les élections : les partis politiques, vraiment utiles ? Quel est rôle de la représentation aujourd’hui et quelle est la place des partis politiques ?
- Deux lycéens préparent un exposé sur l'influence des écrivains sur l'évolution de la société. L'un pense que les mots sont sans effets face au pouvoir ou à la violence. L'autre affirme que les écrits ou les discours peuvent être plus fort que l'autorité. Présentez leur dialogue.
- Les systèmes politiques promus par Aristote dans La Politique, par Machiavel dans Le Prince, par Hobbes dans Le Corps politique et par Rousseau dans Le Contrat social vous semblent-ils rationnels ?
- Analyse de l'évolution des connexions entre les médias et les partis politiques à travers l'exemple de la France
- L'évolution des partis politiques entre enjeux collectifs et aspirations individuelles.