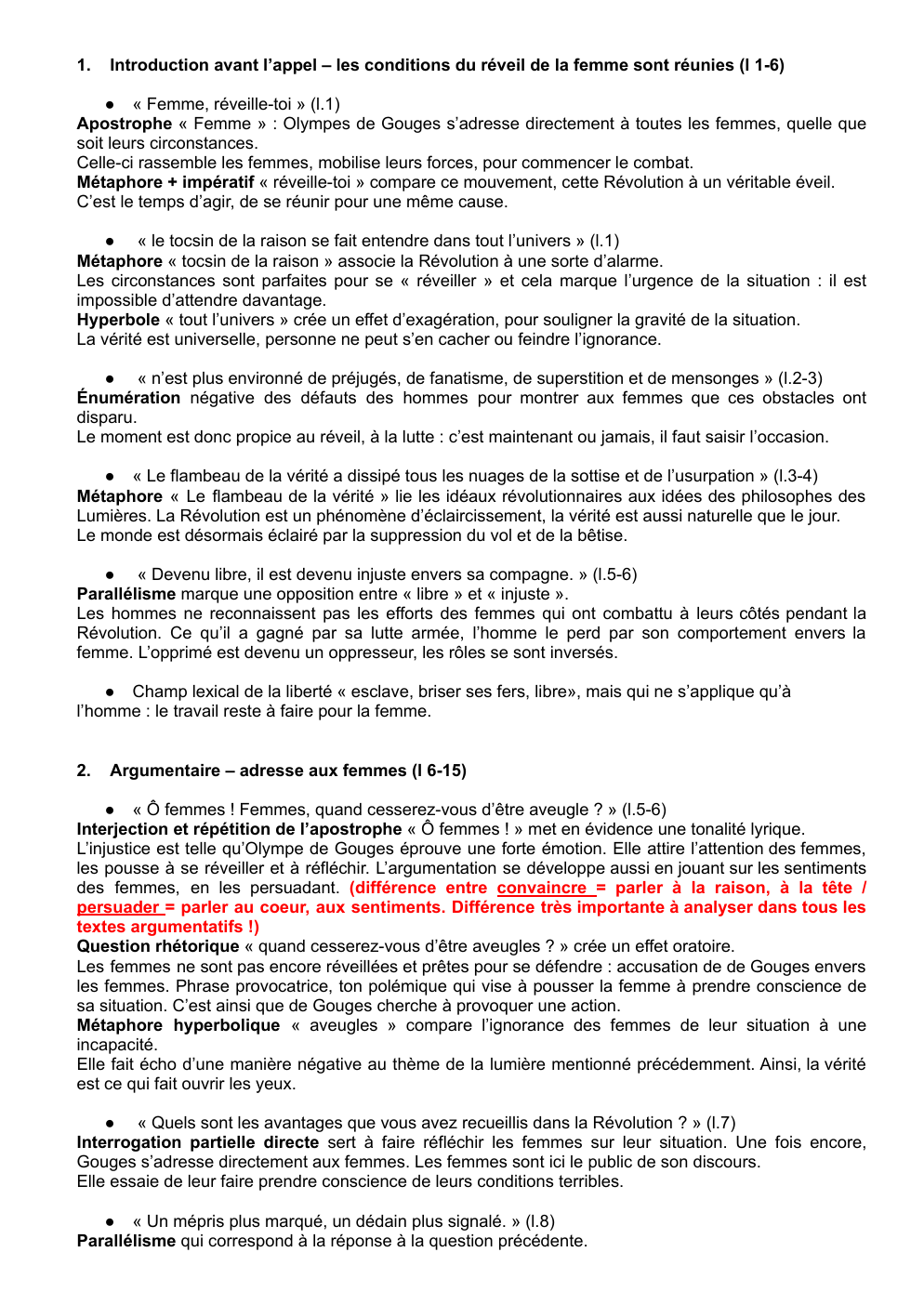Explication linéaire francais DDFC
Publié le 26/02/2025
Extrait du document
«
1.
Introduction avant l’appel – les conditions du réveil de la femme sont réunies (l 1-6)
● « Femme, réveille-toi » (l.1)
Apostrophe « Femme » : Olympes de Gouges s’adresse directement à toutes les femmes, quelle que
soit leurs circonstances.
Celle-ci rassemble les femmes, mobilise leurs forces, pour commencer le combat.
Métaphore + impératif « réveille-toi » compare ce mouvement, cette Révolution à un véritable éveil.
C’est le temps d’agir, de se réunir pour une même cause.
● « le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers » (l.1)
Métaphore « tocsin de la raison » associe la Révolution à une sorte d’alarme.
Les circonstances sont parfaites pour se « réveiller » et cela marque l’urgence de la situation : il est
impossible d’attendre davantage.
Hyperbole « tout l’univers » crée un effet d’exagération, pour souligner la gravité de la situation.
La vérité est universelle, personne ne peut s’en cacher ou feindre l’ignorance.
● « n’est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges » (l.2-3)
Énumération négative des défauts des hommes pour montrer aux femmes que ces obstacles ont
disparu.
Le moment est donc propice au réveil, à la lutte : c’est maintenant ou jamais, il faut saisir l’occasion.
● « Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l’usurpation » (l.3-4)
Métaphore « Le flambeau de la vérité » lie les idéaux révolutionnaires aux idées des philosophes des
Lumières.
La Révolution est un phénomène d’éclaircissement, la vérité est aussi naturelle que le jour.
Le monde est désormais éclairé par la suppression du vol et de la bêtise.
● « Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne.
» (l.5-6)
Parallélisme marque une opposition entre « libre » et « injuste ».
Les hommes ne reconnaissent pas les efforts des femmes qui ont combattu à leurs côtés pendant la
Révolution.
Ce qu’il a gagné par sa lutte armée, l’homme le perd par son comportement envers la
femme.
L’opprimé est devenu un oppresseur, les rôles se sont inversés.
● Champ lexical de la liberté « esclave, briser ses fers, libre», mais qui ne s’applique qu’à
l’homme : le travail reste à faire pour la femme.
2.
Argumentaire – adresse aux femmes (l 6-15)
● « Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugle ? » (l.5-6)
Interjection et répétition de l’apostrophe « Ô femmes ! » met en évidence une tonalité lyrique.
L’injustice est telle qu’Olympe de Gouges éprouve une forte émotion.
Elle attire l’attention des femmes,
les pousse à se réveiller et à réfléchir.
L’argumentation se développe aussi en jouant sur les sentiments
des femmes, en les persuadant.
(différence entre convaincre = parler à la raison, à la tête /
persuader = parler au coeur, aux sentiments.
Différence très importante à analyser dans tous les
textes argumentatifs !)
Question rhétorique « quand cesserez-vous d’être aveugles ? » crée un effet oratoire.
Les femmes ne sont pas encore réveillées et prêtes pour se défendre : accusation de de Gouges envers
les femmes.
Phrase provocatrice, ton polémique qui vise à pousser la femme à prendre conscience de
sa situation.
C’est ainsi que de Gouges cherche à provoquer une action.
Métaphore hyperbolique « aveugles » compare l’ignorance des femmes de leur situation à une
incapacité.
Elle fait écho d’une manière négative au thème de la lumière mentionné précédemment.
Ainsi, la vérité
est ce qui fait ouvrir les yeux.
● « Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution ? » (l.7)
Interrogation partielle directe sert à faire réfléchir les femmes sur leur situation.
Une fois encore,
Gouges s’adresse directement aux femmes.
Les femmes sont ici le public de son discours.
Elle essaie de leur faire prendre conscience de leurs conditions terribles.
● « Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé.
» (l.8)
Parallélisme qui correspond à la réponse à la question précédente.
Elle évoque que les femmes sont encore ignorées.
Elle essaie aussi de les persuader.
Le mots mépris et
dédain s’opposent au terme avantages, pour bien souligner que la femme est la grande perdante de la
Révolution.
C’est presque ici un raisonnement par l’absurde (cf.
document complémentaire sur
l’argumentation.
Document TRÈS IMPORTANT !!!)
● « Dans les siècles de corruption vous n’avez régné que sur la faiblesse des hommes.
Votre
empire est détruit ; que vous reste-t-il donc ? » ( l.8-10)
Présent passif “est détruit”.
Phrase très courte, incisive, comme un coup de poing.
Les femmes n’ont
plus rien, elles ont encore moins qu’avant désormais, ce que met en avant la question rhétorique qui
suit.
● « qu’auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du Législateur des noces
de Cana ?» (l.11-12)
Périphrase « Législateur des noces de Cana » désigne le Christ qui, lors de cet épisode de L'Evangile
répète à sa mère, la Vierge Marie : «Que me veux-tu, femme ?» Cette question est insolente et exprime
une critique à l'égard du christianisme, considéré comme un système d'oppression pour les femmes.
● « Craignez-vous que nos Législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps
accrochée aux branches de la politique » (l.13-14)
Répétition « Législateurs » fait écho au « Législateur » précédent.
Métaphore « accrochés aux branches » assimile les Législateurs à des singes.
Métaphore des Législateurs comparés à des singes « accrochés aux branches » : opposition entre la
majuscule qui grandit et la métaphore animale qui amoindrit, pour dénoncer l’orgueil des législateurs, qui
en fait n’ont rien compris
● « femmes, qu’y a-t-il de commun entre vous et nous ? Tout, auriez-vous à répondre » (l.15)
Question rhétorique : Olympes de Gouges se place dans la tête du Législateur.
La réponse à cette
question est « rien », selon le législateur.
De gouges met en relief la séparation entre les hommes et les
femmes, impliquant que ces deux ne forment pas une équipe.
vous = les femmes / nous = les hommes
➔ un terme d’union « commun », rendu négatif par l’opposition vous/nous
« Tout » crée un effet de rupture.
Elle répond pour les femmes d’une manière forte comme un coup de
poing.
3.
Appel à la lutte (L 16-22)
● « S’ils s’obstinaient, dans leur faiblesse » (l.16)
Proposition subordonnée circonstancielle de condition : de Gouges envisage l’argumentation des
hommes.
Elle prépare les femmes en leur donnant des armes pour anticiper les réactions et
raisonnements des hommes.
« leur faiblesse » est associé aux hommes, pour la 2e fois dans le texte.
L’oppression masculine est considérée comme une faiblesse, les hommes craignent le pouvoir féminin.
C’est un jeu provocant avec l’expression “sexe faible”, qui désigne généralement les femmes.
retourne la situation pour montrer que l’homme n’est pas faible lorsque la femme a des droits, il est
faible quand il a peur d’elle
● « réunissez-vous sous les étendards de la philosophie » (l.18)
Allégorie : il s’agit d’une référence aux Lumières.
La philosophie est comparée à une armée avec ses
drapeaux.
Cela évoque l’idée de l’union qui fait la force mais aussi un appel à la solidarité de toutes les
femmes = marque du caractère révolutionnaire de de Gouges, il n’y a pas d’opposition entre la femme
noble et la femme du peuple (cf.
Adresse à la Reine) + philosophie en écho à « la raison » de la ligne
précédente : les révolutionnaires qui se réclament des Lumières mais continuent à opprimer les femmes
n’ont en fait rien compris.
● « opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité ;
réunissez-vous sous les étendards de la philosophie ; déployez tout l’énergie de votre caractère»
(l.18-19)
Impératif qui agit comme un fort conseil, presque un ordre.
Il s’agit donc d’un appel aux femmes, Olympes de Gouges les guide dans ce combat.
On passe du
constat à l’action.
L’impératif marque ici le temps de l’action, enfin arrivé.
● « vous verrez » (l.19)
Futur de l’indicatif révèle une issue positive de cette lutte.
Phrase prémonitoire, dans le but de rassurer
les femmes sur l’issue de leur combat
● « ces orgueilleux, nos serviles adorateurs rampant à vos pieds » (l.19-20)
l’absence de partage rend l’homme esclave (servile vient du latin servus = l’esclave).
Homme en position
contradictoire : tant qu’il refuse l’égalité de la femme, il est aveugle lui aussi car il ne se rend pas compte
qu’il est esclave (image du serpent avec le S sifflant de « servile » + l’allitération en R « adoRateur
Rampant »)
● « Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir ;
vous n’avez qu’à le vouloir.
» (l.21-22)
Lien entre « pouvoir » et « vouloir ».
Mot de la fin = vouloir -> veut faire passer les femmes du désir à
l’action.
« vous » : adresse aux femmes sans s’inclure dans le groupe, car elle se considère comme
l’avant-garde éclairée.
Elle guide les femmes vers la libération.
DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
FICHE NOTIONS : littérature d’idée et argumentation....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- francais 6 synthèse épitre dédicatoire DDFC
- Explication linéaire Ma bohême Rimbaud
- etude linéaire préambule et arcticle 1-4 DDFC
- Explication linéaire n°2 : Molière, Le Malade imaginaire, Acte III, scène 3
- explication linéaire Merleau ponty: Les champs perceptif donne une ubiquité spatiotemporelle a l’homme