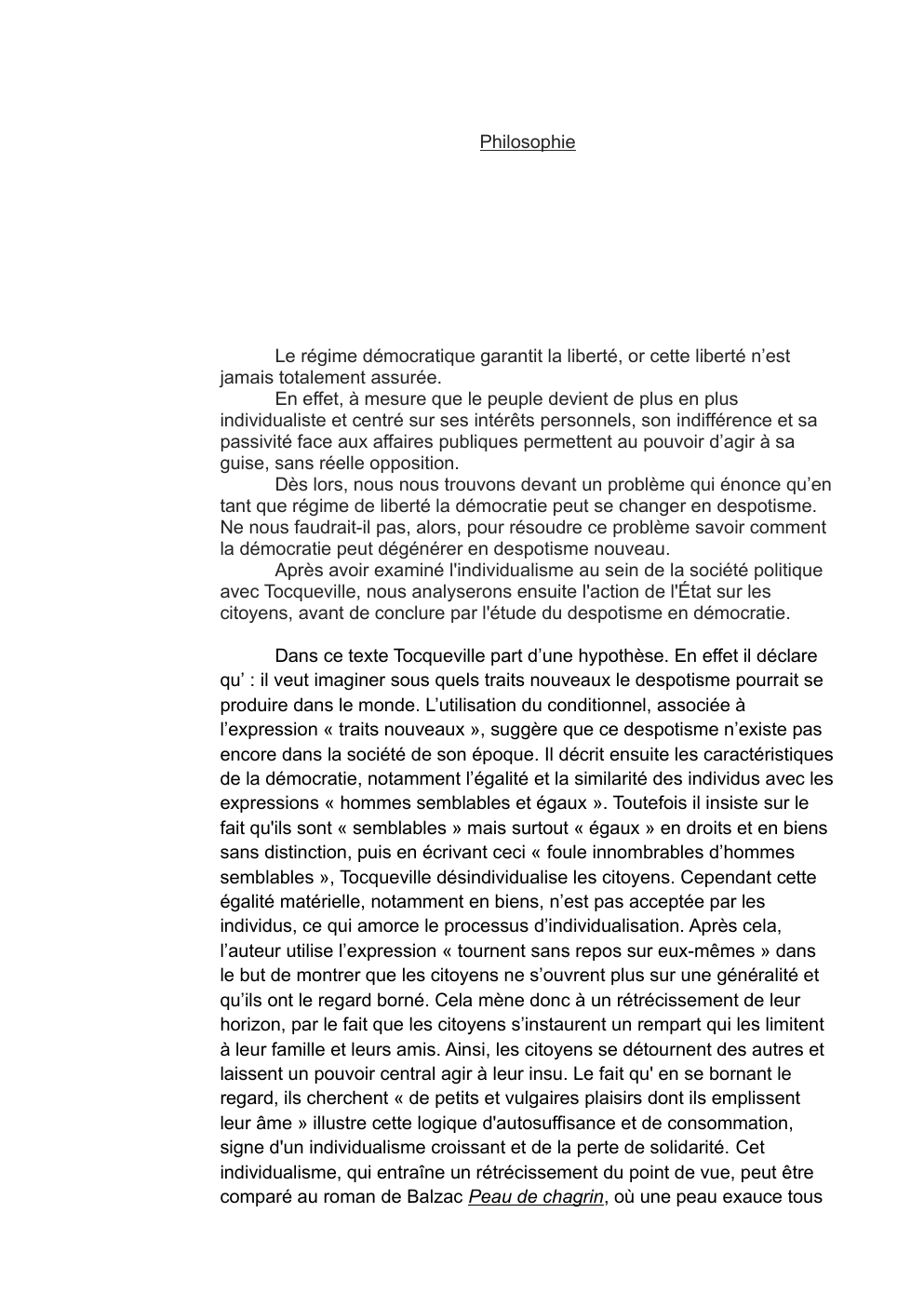Explication de texte Alexis de Tocqueville
Publié le 03/03/2025
Extrait du document
«
Philosophie
Le régime démocratique garantit la liberté, or cette liberté n’est
jamais totalement assurée.
En effet, à mesure que le peuple devient de plus en plus
individualiste et centré sur ses intérêts personnels, son indifférence et sa
passivité face aux affaires publiques permettent au pouvoir d’agir à sa
guise, sans réelle opposition.
Dès lors, nous nous trouvons devant un problème qui énonce qu’en
tant que régime de liberté la démocratie peut se changer en despotisme.
Ne nous faudrait-il pas, alors, pour résoudre ce problème savoir comment
la démocratie peut dégénérer en despotisme nouveau.
Après avoir examiné l'individualisme au sein de la société politique
avec Tocqueville, nous analyserons ensuite l'action de l'État sur les
citoyens, avant de conclure par l'étude du despotisme en démocratie.
Dans ce texte Tocqueville part d’une hypothèse.
En effet il déclare
qu’ : il veut imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se
produire dans le monde.
L’utilisation du conditionnel, associée à
l’expression « traits nouveaux », suggère que ce despotisme n’existe pas
encore dans la société de son époque.
Il décrit ensuite les caractéristiques
de la démocratie, notamment l’égalité et la similarité des individus avec les
expressions « hommes semblables et égaux ».
Toutefois il insiste sur le
fait qu'ils sont « semblables » mais surtout « égaux » en droits et en biens
sans distinction, puis en écrivant ceci « foule innombrables d’hommes
semblables », Tocqueville désindividualise les citoyens.
Cependant cette
égalité matérielle, notamment en biens, n’est pas acceptée par les
individus, ce qui amorce le processus d’individualisation.
Après cela,
l’auteur utilise l’expression « tournent sans repos sur eux-mêmes » dans
le but de montrer que les citoyens ne s’ouvrent plus sur une généralité et
qu’ils ont le regard borné.
Cela mène donc à un rétrécissement de leur
horizon, par le fait que les citoyens s’instaurent un rempart qui les limitent
à leur famille et leurs amis.
Ainsi, les citoyens se détournent des autres et
laissent un pouvoir central agir à leur insu.
Le fait qu' en se bornant le
regard, ils cherchent « de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent
leur âme » illustre cette logique d'autosuffisance et de consommation,
signe d'un individualisme croissant et de la perte de solidarité.
Cet
individualisme, qui entraîne un rétrécissement du point de vue, peut être
comparé au roman de Balzac Peau de chagrin, où une peau exauce tous
les vœux, mais se rétrécit à chaque souhait formulé.Tocqueville continue
en détaillant cette tendance à l’isolement avec l’expression « chacun
d’eux», soulignant que les individus « retiré à l’écart », exprimant une
ablation à la collectivité et rappelant qu’ils « tournent sans repos sur euxmêmes ».
Un individu par rapport au reste de la société devient alors
«étranger » à la chose publique mais aussi «à la destinée de tous les
autres » ce qui par conséquent l’individualise une fois de plus.
D’autre part
il limite sa vision de l’humanité à « ses enfants et ses amis », réduisant
ainsi sa notion d’espèce humaine à un cercle très restreint soit le cercles
familial, qui représente pour lui « toute l’espèce humaine ».
En opposant
sa famille au reste « de ses concitoyens », il montre qu’il est
physiquement proches des autres citoyens ( qui un terme un peu
superficiel car il ne les connaît pas bien) :« à côté d’eux », « il les
touche », mais qu’ils ne partagent aucune proximité réelle, « ne les voient
pas » et « ne les sentent point ».
Ici Tocqueville joue l’association
antithétique des sens et de la défaillance de ceux-ci comme dans
l’expression « il les touche mais ne les sent point » afin de mettre en
lumière cette absence de proximité.
Tout cela traduit donc un manque
d’échange de sentiments et d’empathie.Cette atomisation sociale, puisque
les citoyens sont dispersés comme des atomes, conduit à une société
composée uniquement de familles nucléaires, où les liens sociaux se
dissolvent progressivement, laissant l’individu vivre « en lui-même et pour
lui seul ».
Cette isolation ne touche plus seulement l’individu, mais aussi
ses proches, comme le suggère l'incertitude exprimée par
Tocqueville :« S’il lui reste encore une famille ».
Cependant, l'incertitude
évoquée précédemment laisse place à une certitude déjà existante : « on
peut dire qu’il n’a déjà plus de patrie » qui révèle la perte de tout sentiment
patriotique et d’amour de sa nation, soulignant que l’individualisme a
conduit à une rupture des liens sociaux et à l’érosion du lien national.
Après avoir mis en évidence la manière dont le peuple se comporte
économiquement, socialement, politiquement… Il examine l’emprise du
pouvoir sur le peuple.
Tocqueville commence immédiatement par instaurer un rapport de
puissance déséquilibré avec l’expression « Au-dessus de ceux-là »,
mettant ainsi en lumière l’asymétrie entre les individus et le pouvoir qu'il
décrit comme étant « immense et tutélaire ».
L’adjectif «immense »
souligne la disproportion entre la sphère d’action des citoyens, limitée à
leur famille et leurs amis, et la puissance qui domine tout.
Ce pouvoir est
également présenté de manière anonyme avec l’utilisation du déterminant
indéfini « un », accentuant son omniprésence et sa capacité à intervenir
partout sans être réellement identifié.
Nous pouvons donc utiliser
l’analogie du parapluie: « le pouvoir immense et tutélaire » protège les
citoyens, tout en les surplombant.
Selon Tocqueville, ce pouvoir veille à la
sécurité des individus, mais au prix de leur liberté, comme le rappelle sa
citation : « Un peuple qui est prêt à sacrifier sa liberté pour sa sécurité ne
mérite ni l’une ni l’autre » (De la démocratie en Amérique).
Ensuite, une
forme de paternalisme émerge à travers l'expression « assurer leur
jouissance », ce qui implique que, par conséquent, ce pouvoir choisit
comment les citoyens doivent prendre du plaisir .
Ce pouvoir agit donc en
tant que figure paternelle en infantilisant et déresponsabilisant les
individus.
Toutefois, ce pouvoir semble protecteur, visant le bonheur des
gens et agissant comme un « père ».
Cependant il représente également
une forme d’intrusion chez les gens, qui eux, ne s’en rendent pas
comptent, il souhaite ainsi « veiller sur leur sort », ce qui indique que ce
pouvoir est soucieux.
Cette intrusion est invisible pour ces derniers, qui ne
se rendent pas compte qu’ils sont sous surveillance constante puisqu’une
surveillance discrète est plus précise.
Ce pouvoir est décrit avec une
énumération d’adjectifs qualificatifs : il est « absolu », une caractéristique
du despotisme, fort mais pas nécessairement autoritaire ; il est « détaillé
», prenant en compte toutes les existences et surveillant les individus à
tous les étages ; il est «régulier», s’exerçant selon des lois pour ne pas en
abuser ; il est « prévoyant », anticipant les besoins de la société, qu’il
s’agisse de l’économie (emplois) ou de la défense (service militaire) ; et il
est « doux »,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse texte: Alexis de TOCQUEVILLE, De la Démocratie en Amérique, II, chap. 2 (1840).
- Explication de texte philosophique extrait tiré de La psychanalyse du feu, Bachelard
- Explication de texte : Locke, Second Traité du Gouvernement civil
- Explication de texte de Esthétique de Hegel
- explication de texte Kant: le bonheur n'est pas un concept de la raison, mais un idéal de l'imagination.