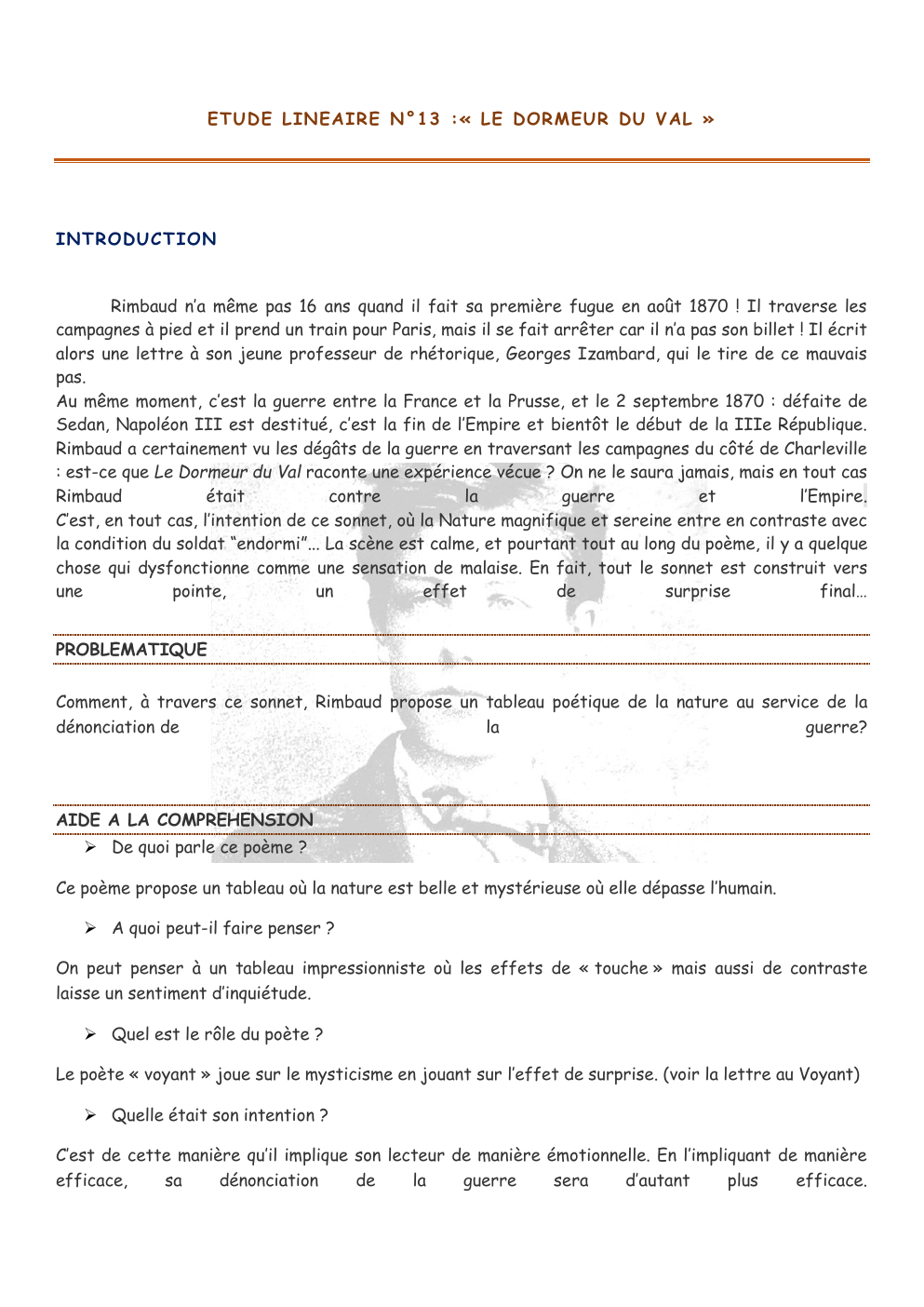ETUDE LINEAIRE N°13 :« LE DORMEUR DU VAL »
Publié le 29/03/2025
Extrait du document
«
ETUDE LINEAIRE N°13 :« LE DORMEUR DU VAL »
INTRODUCTION
Rimbaud n’a même pas 16 ans quand il fait sa première fugue en août 1870 ! Il traverse les
campagnes à pied et il prend un train pour Paris, mais il se fait arrêter car il n’a pas son billet ! Il écrit
alors une lettre à son jeune professeur de rhétorique, Georges Izambard, qui le tire de ce mauvais
pas.
Au même moment, c’est la guerre entre la France et la Prusse, et le 2 septembre 1870 : défaite de
Sedan, Napoléon III est destitué, c’est la fin de l’Empire et bientôt le début de la IIIe République.
Rimbaud a certainement vu les dégâts de la guerre en traversant les campagnes du côté de Charleville
: est-ce que Le Dormeur du Val raconte une expérience vécue ? On ne le saura jamais, mais en tout cas
Rimbaud
était
contre
la
guerre
et
l’Empire.
C’est, en tout cas, l’intention de ce sonnet, où la Nature magnifique et sereine entre en contraste avec
la condition du soldat “endormi”...
La scène est calme, et pourtant tout au long du poème, il y a quelque
chose qui dysfonctionne comme une sensation de malaise.
En fait, tout le sonnet est construit vers
une
pointe,
un
effet
de
surprise
final…
PROBLEMATIQUE
Comment, à travers ce sonnet, Rimbaud propose un tableau poétique de la nature au service de la
dénonciation de
la
guerre?
AIDE A LA COMPREHENSION
De quoi parle ce poème ?
Ce poème propose un tableau où la nature est belle et mystérieuse où elle dépasse l’humain.
A quoi peut-il faire penser ?
On peut penser à un tableau impressionniste où les effets de « touche » mais aussi de contraste
laisse un sentiment d’inquiétude.
Quel est le rôle du poète ?
Le poète « voyant » joue sur le mysticisme en jouant sur l’effet de surprise.
(voir la lettre au Voyant)
Quelle était son intention ?
C’est de cette manière qu’il implique son lecteur de manière émotionnelle.
En l’impliquant de manière
efficace,
sa
dénonciation
de
la
guerre
sera
d’autant
plus
efficace.
PREMIER MOUVEMENT : UN DECOR TROMPEUR ?
C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.
- L’ouverture du poème par le présentatif “c’est” montre une volonté de description picturale.
Ce
premier quatrain fonctionne d’ailleurs comme un tableau car on retrouve le présentatif au 4ème vers
qui englobe une vue d’ensemble.
-
Le poète va s’adresser à l’imaginaire du lecteur.
Dès lors, le poème donne à voir une paysage
idyllique, mais aussi ambigu avec le mot “trou” qui parait peu poétique.
C’est indication de lieu
renvoie un endroit isolé.
-
Pourtant, dans cette première strophe, la gaité l’emporte : la nature est
personnifiée (“chante une rivière” ; “accrochant follement” ; la montagne fière”) ce qui donne
une impression de fête et d’une nature harmonieuse.
-
La personnification des éléments naturels met également en avant la vie comme si toute la
nature était un être vivant.
On perçoit aussi une forme de liberté propre à la nature avec
l’adverbe « follement »
-
Le tableau est également celui d’un paysage lumineux avec le champ lexical de la lumière :
“D’argent” (rejet qui met en valeur la lumière) ; “Luit” ; “soleil” ; “rayons”.
Les deux
enjambements des vers 3 et 4 participent d’ailleurs à mettre en valeur cette lumière
omniprésente.
-
Cette métaphore permet, en plus de renforcer la lumière du tableau, d’évoquer la nature
comme un tout, avec des éléments qui fusionnent, donc une image d’harmonie.
-
Toutefois, l’emploi dans la métaphore du verbe « mousse » laisse un paraitre une réalité par
touche (cf.
à un tableau impressionniste).
On peut l’interpréter comme une réalité insaisissable
voire trompeuse.
Ainsi donc, dans cette première strophe, Rimbaud dresse un cadre verdoyant et agréable qui ne laisse
pas supposer le caractère engagé du poème mais qui laisse poindre quelques ombres.
Tout est dépeint
pour faire rentrer le lecteur dans ce tableau.
Les différents procédés : métaphores, enjambements,
personnifications convergent à rendre ce tableau vivant comme une hypotypose.
2 E ME MOUVEMENT : L’OMBRE DE LA MORT
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
-
Certains éléments de la première strophe pouvaient paraître surprenants dans cette nature
sauvage notamment les nombreuses personnifications mais aussi le CDN « haillons »
introduisant une image liée à la nature humaine cette fois-ci.
-
Ce que confirme le premier alexandrin de la 2ème strophe qui ouvre avec un personnage : « Un
soldat jeune ».
L’adjectif antéposé « jeune » marque un décalage (on dirait davantage « un
jeune soldat ».
Ce décalage amène alors à la question peut se poser de savoir ce que fait un
soldat dans un écrin de verdure ?
-
L’évocation de ce personnage peut également faire référence à la guerre notamment francoprussienne (1870-1871)
-
Un long enjambement qui se termine par un rejet tout comme dans le premier quatrain donne la
réponse : il « dort ».
-
Il semble en effet par le champ lexical du corps goûter au plaisir de ce cadre apaisant comme
l’indique les descriptions réalistes avec les adjectifs « ouverte, nue »
-
La métaphore « baignant dans le frais cresson bleu » connote d’une certaine froideur
cependant par l’adjectif « frais » renforcé par la couleur « bleu »
-
Le champ lexical de sommeil parait très présent dans cette strophe avec « baignant, dort,
étendu et lit »
-
Suite au rejet, l’inquiétude apparait davantage avec l’adjectif « pâle » pour décrire le soldat
mais aussi sa position horizontale « étendu ».
De même, la métaphore « son lit vert » résonne
avec l’expression « lit de mort ».
-
L’emploi de l’adjectif « jeune » porte toute l’ambiguité, ce jeune homme devrait être plein de
vie.
Or, il se trouve allongé « tête nue » (sans casque) où la métaphore de la pluie éclaire son
corps.
Cette métaphore rappelle celle de la première « qui mousse de rayons » où la nature a sa
propre vitalité, où elle met tous les sens en éveil comme si on pouvait entendre mais aussi
toucher la lumière qui se dépose sur le soldat.
-
Le pronom « où » revient trois fois dans les deux premiers quatrains, pour désigner d’abord le
trou de verdure, puis la rivière, et enfin le lit vert : ce sont autant de cercles concentriques
qui nous emmènent progressivement auprès du dormeur.
-
On remarquera aussi la rime « nue » et « nue » c’est-à-dire les nuages comme si l’âme montait
au paradis, entre la terre et le ciel
-
Cette strophe suscite donc bien l’inquiétude par la position de ce soldat auréolé de nature
comme le confirme l’emploi récurrent des allitérations en « l ».
Il est baigné dans le lit de la
rivière, dans une nature liquide.
Les
pieds
dans
les
glaïeuls,
Sourirait
un
enfant
malade,
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
il
il
dort.
fait
Souriant
comme
un
somme
:
-
Avec ce tercet, on est à un point de basculement qu’on appelle depuis Pétrarque : la volta.
-
L’évocation des glaïeuls est riche de sens : l’origine du mot signifie « petite glaive » donc petit
couteau.
Cette fleur est à la fois symbole de victoire, de courage) (les gladiateurs se
rendaient dans l’arène avec) mais aussi de mort, d’honnêteté.
Or, ici, elles sont aux pieds du
soldat.
On pourrait penser à une ironie amère car le soldat n’est pas dans une posture
glorieuse.
L’ombre de la mort ne fait que s’accentuer.
-
En effet, les indices sont en opposition et oscillent sans cesse entre le positif et le négatif : le
dormeur sourit, mais c’est le sourire d’un enfant malade.
La comparaison est inquiétante, mais
elle est atténuée par le conditionnel : il n’est pas vraiment malade.
Pourtant Rimbaud insiste
sur ce sourire, avec un participe présent (pour une action considérée dans sa durée).
C’est un
sourire
figé
:
comme
le
rictus
de
la
mort.
- L’adjectif « frais » est devenu « froid » : c’est une gradation (une augmentation en
intensité).
La chaleur n’est évoquée que par contraste, justement pour son absence.
Rimbaud
joue sur le double sens du mot : la nature est accueillante, mais le corps reste froid.
-
Le dernier vers commence avec une apostrophe (une adresse directe), où la Nature devient
réellement une allégorie avec la majuscule : « berce-le chaudement ».
On reconnaît le motif
traditionnel de la vierge à l’enfant.
La Nature est comme une mère, voire même, comme la
Vierge Marie, une Sainte.
Le dormeur est alors comme le christ, dont le destin sera de mourir
sur la croix.
-
Il est....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ETUDE LINEAIRE MANON LESCAUT Le coup de foudre
- etude lineaire "Vénus Anadyomène" de Rimbaud
- Etude lineaire de Wajdi Mouawad (Incendies)
- etude lineaire Arias
- Arthur Rimbaud, « Le Dormeur du val » (1870) - (lecture analytique)