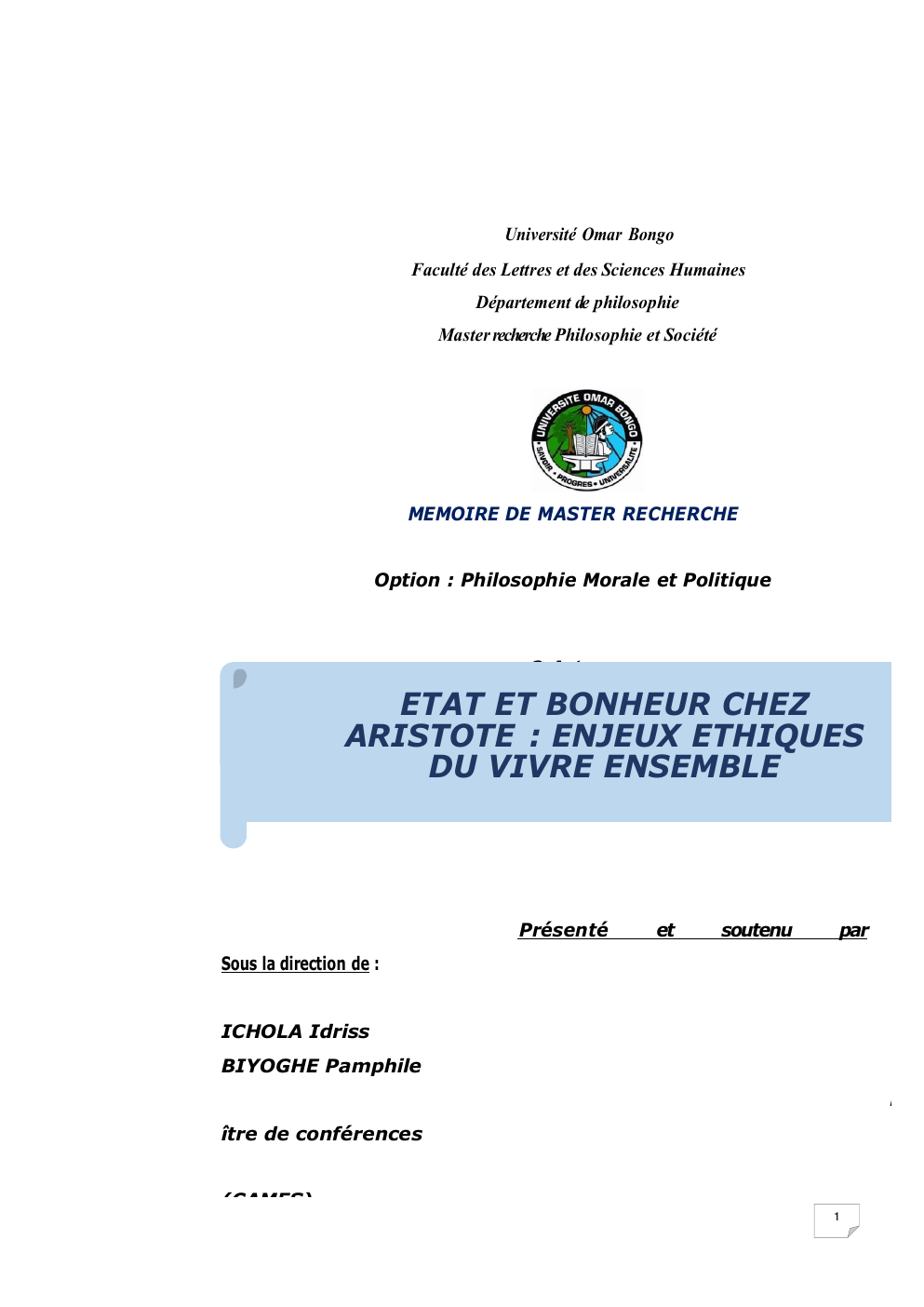ETAT ET BONHEUR CHEZ ARISTOTE : ENJEUX ETHIQUES DU VIVRE ENSEMBLE
Publié le 20/11/2023
Extrait du document
«
Sujet
ETAT ET BONHEUR CHEZ
ARISTOTE : ENJEUX ETHIQUES
DU VIVRE ENSEMBLE
SOMMAIRE
DEDICACE
REMERCIEMENTS
INTRODUCTIONS
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE DE LA PENSEE POLITIQUE D’ARISTOTE
I-
ETAT ET BONNHEUR CHEZ ARISTOTE
DEUXIEME PARTIE : THESES ARISTOTELICIENNES
II-
DU RAPPORT ENTRE ETAT ET BONHEUR CHEZ ARISTOTE
TROISIEMES PARTIES : ELEMENTS DE REPONSES
III-
ENJEUX ETHIQUES DU VIVRE ENSEMBLE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
INDEX DES NOTIONS
INDEX DES AUTEURS
TABLES DES MATIERES
DEDICACE
4
A la mémoire d’Aristote grâce aux idées duquel nous avons pu réaliser ce travail ainsi qu’aux
Etats du monde qui, nous l’espérons humblement, trouveront dans ce travail, les éléments
d’une gestion vertueuse des organes politiques dont ils ont la charge.
REMERCIEMENTS
5
Principalement à l’endroit de notre directeur de mémoire, le professeur Pamphile BIYOGHE
pour son apport technique.
Apport qui a facilité la réalisation de ce mémoire.
A notre co-directeur M.
MAKAYA MAKAYA Rodrigue pour ses orientations.
À toutes les personnes qui ont contribué
positivement à façonner notre être.
En tête desquels, les auteurs de nos jours : ICHOLA WABI et
HOUNVENOU K.
Marie, lesquels ont pris soins de nous, ont veillé à notre éducation et nous ont
envoyé à l’école.
À l’Etat gabonais qui a rendu possible cet apprentissage à travers les différents
établissements par lesquels nous sommes passés.
Aux enseignants qui ont participé à notre formation
intellectuelle, de la maternelle à l’université, en passant par le lycée.
Aux auteurs d’ouvrages décisifs
que nous avons pu lire ! Aux différents parents, amis et connaissances qui ont de quelque manière
motivés notre entreprise, mais puisqu’à tout honneur, tout seigneur ! Nous voulons honorés certains
enseignants qui ont influencés décisivement notre carrière ; parmi lesquels, le professeur certifié de
philosophie KOWET Sylvanius au lycée Joseph AMBOUROUE AVARO de Port-Gentil, grâce
auquel et à l’injonction duquel nous avons embrassés les études de philosophie.
Aux enseignants du
département de philosophie de l’université Omar BONGO chez lesquels nous avions puisés tout ce qui
nous a paru utile à notre formation intellectuelle et morale ; parmi lesquels, l’influence de feux les
professeurs Gilbert NZUE-NGUEMA, MOUKALA NDOUMOU et Chrysostome MONDJO à la
mémoire desquels nous voulons observer une minute de silence bien entendu avec la permission du
jury.
Aux docteurs Thierry EKHOGA, MASSIMA LOUWOUNGOU, Gildas NZOKOU, Cyril
MIKALA, Dominique ETOUGHE MBA, MOUTOUMBOU Roland.
Aux professeurs Jean Rodrigue
Elysée EYENE-MBA, Christ Olivier PAGA, NDONG MEYE.
Aux étudiants inspirants de notre
département qui par leur travail, ont créé une saine émulation dans notre processus d’apprentissage,
parmi lesquels notre promotionnaire METHOGO M’OBOUNOU ASSOUMOU Christ.
A La section
handball du département de philosophie ainsi qu’à celle de l’université qui ont favorisé notre
épanouissement estudiantin par la pratique du sport.
Aux étudiants photographes de l’université Omar
BONGO.
A l’agence national des bourses du Gabon (ANBG) qui en dépit du retard avec lequel
l’allocation de bourse nous a été accordée, a toutefois constitué une aide décisive au travers de laquelle
nous avions puisé les forces nécessaires pour poursuivre nos études et mener à terme ce travail.
A M.
RAFIOU, M.
Eloi, M.
Jean ainsi que sa merveilleuse épouse Danielle BOUNGUENZA.
À Simone
MOUELE.
À notre très cher et tendre grande sœur Oufath ICHOLA.
À mes grandes sœurs et grand
frères ICHOLA Inoussa ICHOLA moussa, ICHOLA Chérifath, ICHOLA Osseni, ICHOLA
Soubédath.
A mes amis, FOUITY NZIGOU Khen, LENDOYE RINGUE Yvan Arnaud, NKALA
Ernest Junior, TSIKA Alain Hearly Janel, NZIGOU Hans, et BONGO LOUNDOU Georslène Gilvia;
Allogho tandresse à toutes ces personnes oubliés ; de qui nous avions reçu, grâce auxquelles ce travail
a pu être réaliser, à vous tous, nous disons merci !
INTRODUCTION
6
Le vocable philosophie procède doublement du grec « philéin1 » et « sophia2 », il possède
chacun pour ses composants respectifs, le double sens de « désirer », « aimer » ; « sagesse »,
« savoir » et serait par essence un désir de connaitre afin de bien vivre, un règne par la
connaissance et en tant que tel, permettrait d’être libre et heureux s’il en est, c’est sans
rappeler le mot de Descartes qui considère l’homo sapiens comme « maitre et possesseur de la
nature3 ».
Mais puisqu’il s’agit d’un désir, d’un amour pour la sagesse ou la connaissance,
c’est aussi la lucidité de distinguer le « philosophos » du « sophos » qui est repérable chez
Pythagore qui aurait par modestie renoncé à se dire sage pour se contenter d’être un amoureux
de la sagesse.
C’est encore cette approche qui transparaît chez Socrate, père de la philosophie
« tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien4 » qui à juste titre est d’avantage conscient de son
ignorance que de son savoir.
La philosophie n’est donc pas à proprement parler détention de
savoir mais quête du savoir.
Sagesse qui a inéluctablement permis de rompre avec les
réponses mythico-religieuses à la question du pourquoi qui, quant à elle, révèle les mystères
du cosmos et donna lieu à ce qu’il est convenu d’appeler selon Ernest Renan « le miracle
grec5 ».
La démarche, fut l’étonnement, la critique, la dialectique.
En clair, la recherche de
l’objectivité.
Kant n’est pas en reste puisque dans les lumières, il nous exhorte à sortir de la
minorité pour la majorité en ayant le courage de nous servir de notre propre entendement.
C’est sans rompre avec cette tradition dominante de la philosophie officielle que penser le
rapport entre Etat et bonheur nous a paru nécessaire et actuel pour à peu près deux raisons
fondamentales : la première en est que chaque homme qui s’élève au rang des humanités, en
menant une vie distincte d’une simple plante ou de celle d’autres animaux, en déployant ce
qu’il a de propre, c’est-à-dire sa raison ; durant son séjour terrestre s’interroge ou
s’interrogera sur la question existentielle et sempiternelle du bonheur ; tout en s’efforçant
autant que faire se peu d’être heureux.
Tant le bonheur s’il existe, apparaît comme la fin de
l’activité humaine, puisqu’il semble que c’est en vue de ce dernier que nous faisons tout ce
que nous entreprenons, lequel justement donnerait sens à toute l’entreprise humaine.
C’est aussi ce qu’a semblé confirmer cette fameuse pensée d’après laquelle on
demanda à un étudiant ce qu’il souhaitait devenir.
Plutôt que d’indiquer un corps de métier à
l’instar de tous ses collègues, tels qu’enseignant, avocat, médecin, ce dernier répondit contre
toute attente qu’il désirait être heureux ! On lui fit remarquer qu’il ne comprenait pas le sens
de la question, il répliqua qu’eux, plutôt ne comprenaient pas le sens de la vie.
Réponse
séduisante et bouleversante qui tant à consolider le bonheur comme la fin de la vie.
Mais étant donné que l’homme d’une certaine façon est toujours et déjà en société, il
nous a paru judicieux de mettre en relation l’Etat et le bonheur pour livrer une réflexion plus
ou moins complète.
Si tant est que c’est à l’Etat, pouvoir suprême, à travers la politique mise
en place que revient de créer un climat propice au bonheur.
Cependant force est de constater
que le bonheur tant souhaité par les individus en particulier et les peuples en général est loin
d’être satisfait, l’Etat est parfois même tenu pour responsable des malheurs collectifs et
individuels.
Position qui laisse envisager un déni même de l’existence du bonheur et une
1
Gérard DUROZOI André ROUSSEL, dictionnaire de philosophie P272
Ibid
3
Descartes, Discours de la méthode (1637), 6e partie, Bibliothèque de la Pléiade, Ed.
Gallimard, 1966, p.168
D’après
4
Socrate
5
Miracle grec
2
7
remise en question de l’essence de l’Etat.
D’où il nous apparaît non moins pertinent
d’examiner à nouveau frais le lien entre Etat et bonheur.
Tout ceci pourrait sans doute
s’expliquer au fait que le bonheur s’il existe, confronte à des illusions, notamment en posant
le problème de l’adéquation entre les moyens et la fin réelle que se propose l’activité
humaine.
L’actualité de ce rapport se donne à voir à travers la crise de la société dans sa
globalité.
Le constat est alarmant, lorsque qu’on considère le taux de dépression chronique, de
suicide, la montée des influenceurs à travers le coaching et techniques en développement
personnel, la prolifération des organismes internationaux pour assurer le mieux-être et le bien
vivre, l’audience et l’adhésion croissante aux religions du salut, le rappel constant des peuples
à de meilleures conditions de vies, l’appel à des politiques devant promouvoir le bonheur.
Les
tentatives récentes de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Après le rare bonheur de trouver une compagne qui nous soit bien assortie, l'état le moins malheureux de la vie est sans doute de vivre seul. »
- CHAMFORT conclut ainsi son Éloge de Molière (1766) : N'existerait-il pas un point de vue d'où Molière découvrirait une nouvelle carrière dramatique ? Répandre l'esprit de société fut le but qu'il se proposa. Arrêter ses funestes effets serait-il un dessein moins digne d'un sage ? Verrait-il sans porter la main sur ses crayons l'abus que nous avons fait de la société et de la philosophie, le mélange ridicule des conditions, cette jeunesse qui a perdu toute morale à quinze ans, toute se
- Aristote (~384-~322 av. J.-C.): LE BONHEUR ET LA VERTU
- vivre ensemble
- L’Etat doit-il intervenir dans le bonheur de chacun, au risque d’empiéter sur ses libertés ?