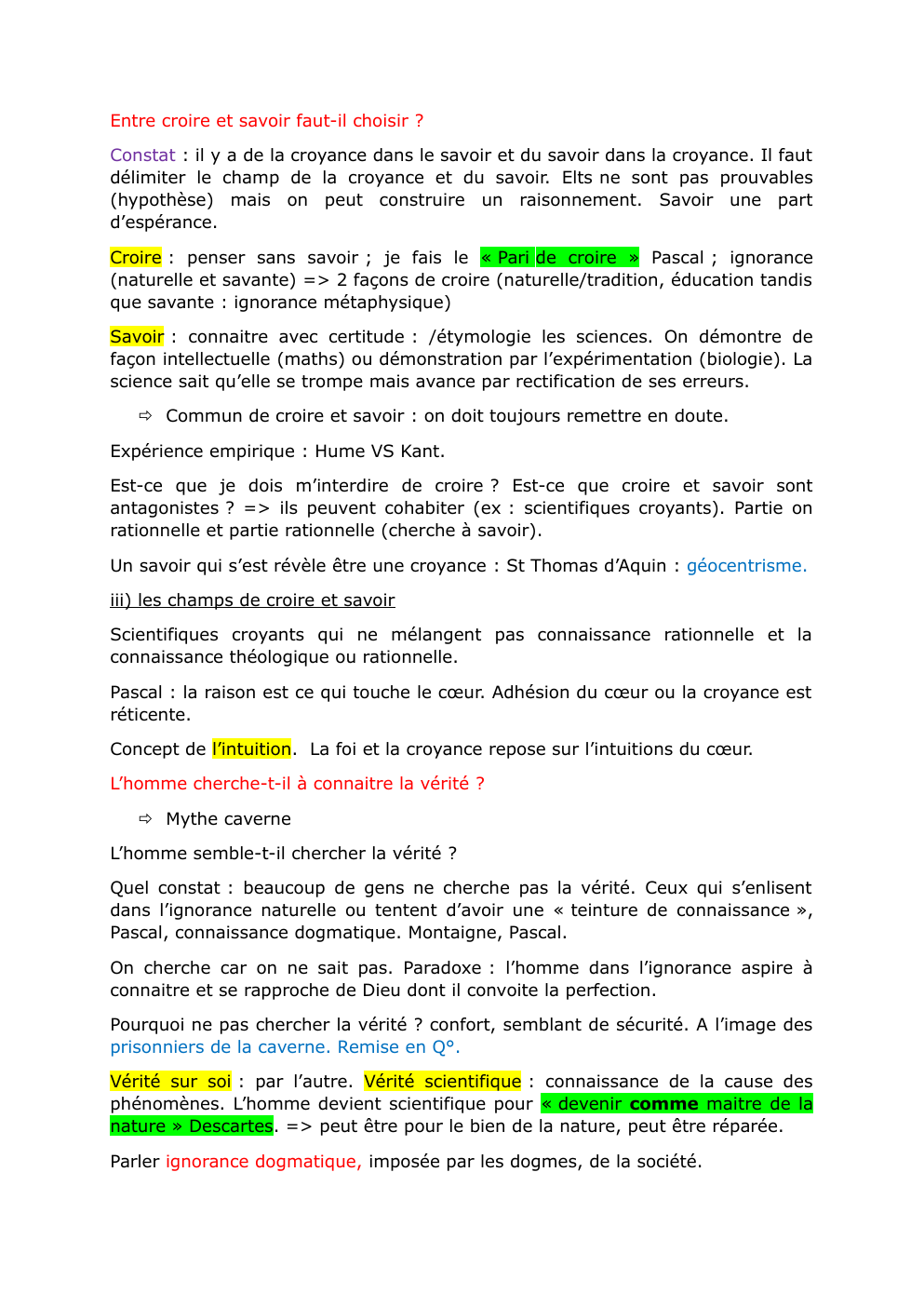Entre croire et savoir faut-il choisir ?
Publié le 28/03/2025
Extrait du document
«
Entre croire et savoir faut-il choisir ?
Constat : il y a de la croyance dans le savoir et du savoir dans la croyance.
Il faut
délimiter le champ de la croyance et du savoir.
Elts ne sont pas prouvables
(hypothèse) mais on peut construire un raisonnement.
Savoir une part
d’espérance.
Croire : penser sans savoir ; je fais le « Pari de croire » Pascal ; ignorance
(naturelle et savante) => 2 façons de croire (naturelle/tradition, éducation tandis
que savante : ignorance métaphysique)
Savoir : connaitre avec certitude : /étymologie les sciences.
On démontre de
façon intellectuelle (maths) ou démonstration par l’expérimentation (biologie).
La
science sait qu’elle se trompe mais avance par rectification de ses erreurs.
Commun de croire et savoir : on doit toujours remettre en doute.
Expérience empirique : Hume VS Kant.
Est-ce que je dois m’interdire de croire ? Est-ce que croire et savoir sont
antagonistes ? => ils peuvent cohabiter (ex : scientifiques croyants).
Partie on
rationnelle et partie rationnelle (cherche à savoir).
Un savoir qui s’est révèle être une croyance : St Thomas d’Aquin : géocentrisme.
iii) les champs de croire et savoir
Scientifiques croyants qui ne mélangent pas connaissance rationnelle et la
connaissance théologique ou rationnelle.
Pascal : la raison est ce qui touche le cœur.
Adhésion du cœur ou la croyance est
réticente.
Concept de l’intuition.
La foi et la croyance repose sur l’intuitions du cœur.
L’homme cherche-t-il à connaitre la vérité ?
Mythe caverne
L’homme semble-t-il chercher la vérité ?
Quel constat : beaucoup de gens ne cherche pas la vérité.
Ceux qui s’enlisent
dans l’ignorance naturelle ou tentent d’avoir une « teinture de connaissance »,
Pascal, connaissance dogmatique.
Montaigne, Pascal.
On cherche car on ne sait pas.
Paradoxe : l’homme dans l’ignorance aspire à
connaitre et se rapproche de Dieu dont il convoite la perfection.
Pourquoi ne pas chercher la vérité ? confort, semblant de sécurité.
A l’image des
prisonniers de la caverne.
Remise en Q°.
Vérité sur soi : par l’autre.
Vérité scientifique : connaissance de la cause des
phénomènes.
L’homme devient scientifique pour « devenir comme maitre de la
nature » Descartes.
=> peut être pour le bien de la nature, peut être réparée.
Parler ignorance dogmatique, imposée par les dogmes, de la société.
Des hommes en quête de vérité : les philosophes qui reconnaissent de ne pas
savoir.
(ignorance savante).
Paradoxe : Descartes : l’homme est un être de raison.
Qu’est ce que connaitre la vérité ? détacher des illusions, apparences, dogmes.
Comment chercher ? par la raison (esclave de Ménon)
Est-ce qu’accéder à la vérité est un but dans la vie ou renoncer comme les
sceptiques ?
Pour ceux qui n’ont pas la force et le courage intellectuel : le philosophe est un
guide.
Parler de la quête de raison (La République de Platon).
Pourquoi l’homme transforme -t-il la nature ?
-> Serait-ce que l’homme veut façonner la nature à son image ?
Rapport a la nature naturel (homme commun)=/ philosophe nature rationnel.
« Marquer le monde du sceau de son intériorité » Hegel.
Pourquoi : cause=/ Pour quoi : but.
Homme de conscience, être en soi pour soi, être réflexif.
Transforme : avec des artéfacts : faire passer une forme dans.
On projette une
idée dans la forme.
Ex : on détruit toujours pour reconstruire selon un modèle
différent.
L’homme transforme car il est en évolution.
Pourquoi la nature ? mettre
la nature à son image ; elle devient un matériau à transformer.
Des lors que
l’homme sort de la nature pour devenir de la cuture : il déforeste.
Sédentarisation : construction de maisons...
Nature transformée par l’homme par
besoins= paysage.
Les besoins de l’homme changent.
L’homme conscient liberté,
finitude, différence, désirs, le monde qu’il veut construire (Hegel=> citations).
Veut laisser une trace (Ho Politique, Mitterrand/ ex).
Plus un homme craint la
mort, plus il construit.
S’approprier une nature selon Hegel radicalement étrangère (renouer le
lien).
Il a besoin de la liberté pour créer.
Ct l’homme parvient-il à transformer la nature ? => en ft d’un modèle et veut
laisser sa trace ainsi.
L’homme le plus faible de la nature mais qui a la propension à la dominer (veut y
faire sa place => sédentarisation, politique ou mercantile (marché et affaires),
sauvegarde de la nature (paradoxalement délimitée par l’homme (parc
animalier)).
Dès que l’homme se retire de la nature, elle reprend ses droits
(églises bombardée, arbres).
Descartes : « l’homme est comme maitre et possesseur de la nature ».
L’homme ne peut rien faire de la nature sans lui obéir.
=> homme est un être de
raison, de compréhension, il cherche à comprendre.
L’illusion qui réconforte est-elle préférable à la vérité qui dérange ?
Illusion : reflète l’ignorance naturelle.
L’ignorance naturelle peut cependant être dépassée.
On parle alors d’ignorance
savante.
Sceptisme : doctrine qui affirme que seule est valable l’opinion
personnelle, car la vérité ne peut pas être atteinte.
Il vaut mieux mettre son
jugement en épochè (le mettre de coté).
Mythe de la caverne : l’illusion est certes réconfortante mais si une fois face a la
vérité, (celui qui revient dans la caverne), on peut se sentir troublés, il ne faut
pas se laisser dépasser par ses sentiments.
Si on veut atteindre la connaissance
des choses, il faut alors mener un chemin initiatique, qui peut être compliqué,
mais il est plus compliqué à commencer qu’a finir.
Prendre conscience de soi est ce devenir étranger à soi-même ?
On maitrise alors son corps, son état d’âme.
=> c’est alors devenir un être en soi
pour soi, on prend conscience de soi.
Capable de dire JE : on se tient debout
devant soi, on se sait exister.
Rapport de médiateté et immédiateté (la conscience de soi n’est pas possible
pour tous) ; mais elle présente des avantages => la liberté.
« notre conscience
témoigne de notre liberté », Bergson.
« Nous n’avons aucune idée du moi », Humes, traité de la nature humaine.
Selon
Humes, le moi n’est qu’une illusion.
Il privilégie l’expérimentation (a posteriori).
L’homme est esprit et corps : sa nature est double on parle du dualisme.
L’esprit = qui permet la réflexion.
Esprit peut se distinguer en
entendement (comprendre) et raison (raisonner : ratio (logique de la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Deligere oportet quem velis diligere / Il faut choisir qui on veut aimer
- Paul Valéry donne aux écrivains ce conseil: Entre deux mots il faut choisir le moindre. Vous rapprocherez cette boutade de la définition qu'André Gide propose du classicisme: C'est l'art de la litote. Vous vous demanderez quel aspect du classicisme et, d'une façon générale, quelles positions littéraires sont ainsi définis ?
- Commentez cette phrase d'Henry de Montherlant : « C'est quand nous croyons devoir innover qu'il faut savoir s'étayer sur le passé. »
- « Pour connaître quelqu'un vraiment, il ne faut pas le connaître seulement comme ami, ou en dehors du travail ; il faut le connaître lorsqu'il est ton chef, lorsque tu en dépends-; là tu peux apprécier un homme et savoir exactement ce qu'il vaut. » Ainsi témoigne un ouvrier. Travailler deux heures parjour, Collectif ADRET Editions du Seuil Votre expérience vous permet-elle de dire dans quelle mesure un rapport hiérarchique est révélateur des qualités humaines ?
- Paul Valéry donne aux écrivains ce conseil : « Entre deux mots il faut choisir le moindre. » Vous rapprocherez cette boutade de la définition qu'André Gide propose du classicisme : « C'est l'art de la litote. » Vous vous demanderez quel aspect du classicisme et, d'une façon générale, quelles positions littéraires sont ainsi définis.