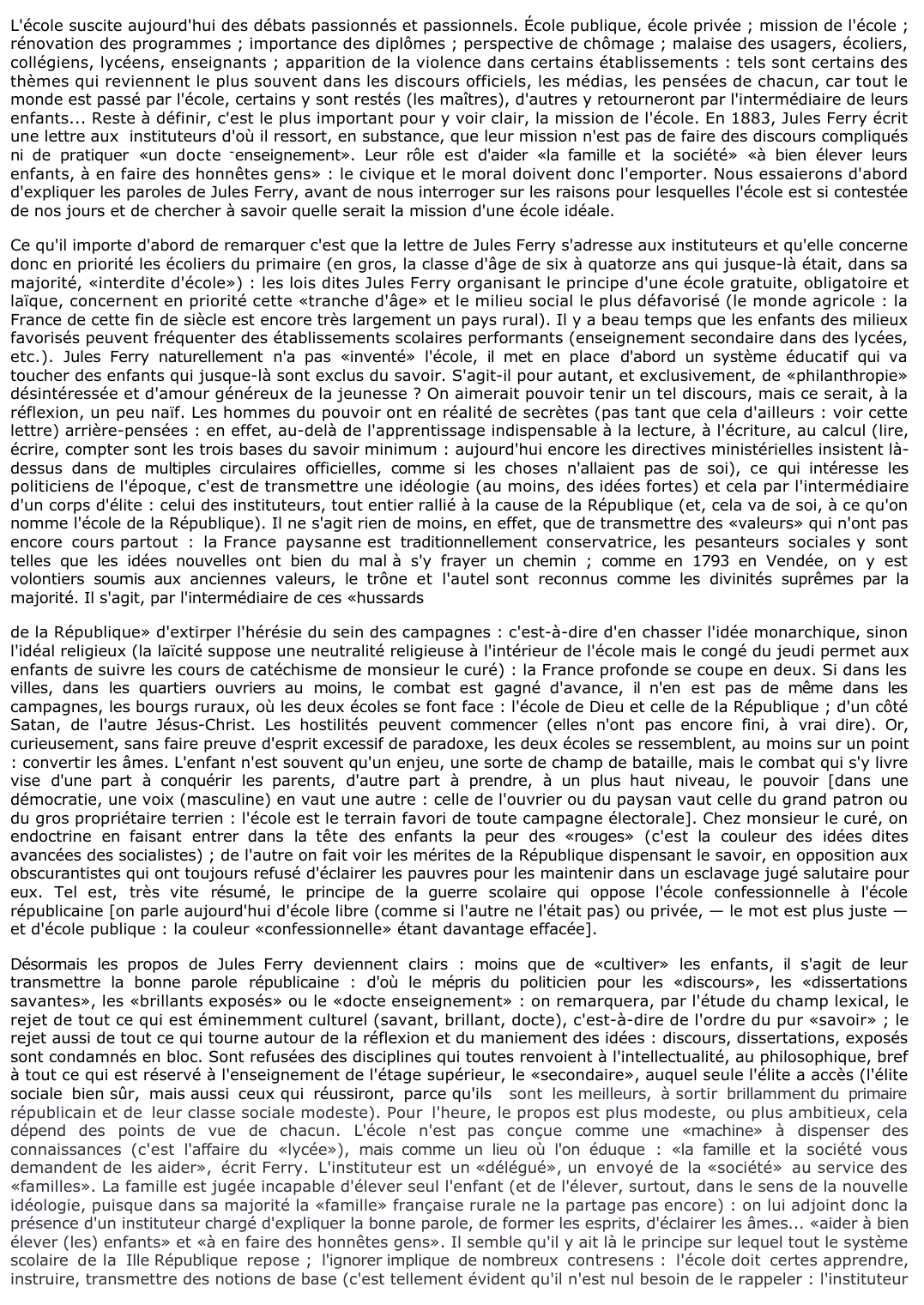En 1883, Jules Ferry, adressant une lettre aux instituteurs, écrit :«Que vous demande-t-on ? Des discours ? Des dissertations savantes ? De brillants exposés, un docte enseignement ? Non ! La famille et la société vous demandent de les aider à bien élever leurs enfants, à en faire des honnêtes gens.»
Publié le 15/05/2020

Extrait du document
«
L'école suscite aujourd'hui des débats passionnés et passionnels.
École publique, école privée ; mission de l'école ;rénovation des programmes ; importance des diplômes ; perspective de chômage ; malaise des usagers, écoliers,collégiens, lycéens, enseignants ; apparition de la violence dans certains établissements : tels sont certains desthèmes qui reviennent le plus souvent dans les discours officiels, les médias, les pensées de chacun, car tout lemonde est passé par l'école, certains y sont restés (les maîtres), d'autres y retourneront par l'intermédiaire de leursenfants...
Reste à définir, c'est le plus important pour y voir clair, la mission de l'école.
En 1883, Jules Ferry écritune lettre aux instituteurs d'où il ressort, en substance, que leur mission n'est pas de faire des discours compliquésni de pratiquer «un docte -enseignement».
Leur rôle est d'aider «la famille et la société» «à bien élever leurs enfants, à en faire des honnêtes gens» : le civique et le moral doivent donc l'emporter.
Nous essaierons d'abordd'expliquer les paroles de Jules Ferry, avant de nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'école est si contestéede nos jours et de chercher à savoir quelle serait la mission d'une école idéale.
Ce qu'il importe d'abord de remarquer c'est que la lettre de Jules Ferry s'adresse aux instituteurs et qu'elle concernedonc en priorité les écoliers du primaire (en gros, la classe d'âge de six à quatorze ans qui jusque-là était, dans samajorité, «interdite d'école») : les lois dites Jules Ferry organisant le principe d'une école gratuite, obligatoire etlaïque, concernent en priorité cette «tranche d'âge» et le milieu social le plus défavorisé (le monde agricole : laFrance de cette fin de siècle est encore très largement un pays rural).
Il y a beau temps que les enfants des milieuxfavorisés peuvent fréquenter des établissements scolaires performants (enseignement secondaire dans des lycées,etc.).
Jules Ferry naturellement n'a pas «inventé» l'école, il met en place d'abord un système éducatif qui vatoucher des enfants qui jusque-là sont exclus du savoir.
S'agit-il pour autant, et exclusivement, de «philanthropie»désintéressée et d'amour généreux de la jeunesse ? On aimerait pouvoir tenir un tel discours, mais ce serait, à laréflexion, un peu naïf.
Les hommes du pouvoir ont en réalité de secrètes (pas tant que cela d'ailleurs : voir cettelettre) arrière-pensées : en effet, au-delà de l'apprentissage indispensable à la lecture, à l'écriture, au calcul (lire,écrire, compter sont les trois bases du savoir minimum : aujourd'hui encore les directives ministérielles insistent là-dessus dans de multiples circulaires officielles, comme si les choses n'allaient pas de soi), ce qui intéresse lespoliticiens de l'époque, c'est de transmettre une idéologie (au moins, des idées fortes) et cela par l'intermédiaired'un corps d'élite : celui des instituteurs, tout entier rallié à la cause de la République (et, cela va de soi, à ce qu'onnomme l'école de la République).
Il ne s'agit rien de moins, en effet, que de transmettre des «valeurs» qui n'ont pasencore cours partout : la France paysanne est traditionnellement conservatrice, les pesanteurs sociales y sonttelles que les idées nouvelles ont bien du mal à s'y frayer un chemin ; comme en 1793 en Vendée, on y estvolontiers soumis aux anciennes valeurs, le trône et l'autel sont reconnus comme les divinités suprêmes par lamajorité.
Il s'agit, par l'intermédiaire de ces «hussards
de la République» d'extirper l'hérésie du sein des campagnes : c'est-à-dire d'en chasser l'idée monarchique, sinonl'idéal religieux (la laïcité suppose une neutralité religieuse à l'intérieur de l'école mais le congé du jeudi permet auxenfants de suivre les cours de catéchisme de monsieur le curé) : la France profonde se coupe en deux.
Si dans lesvilles, dans les quartiers ouvriers au moins, le combat est gagné d'avance, il n'en est pas de même dans lescampagnes, les bourgs ruraux, où les deux écoles se font face : l'école de Dieu et celle de la République ; d'un côtéSatan, de l'autre Jésus-Christ.
Les hostilités peuvent commencer (elles n'ont pas encore fini, à vrai dire).
Or,curieusement, sans faire preuve d'esprit excessif de paradoxe, les deux écoles se ressemblent, au moins sur un point: convertir les âmes.
L'enfant n'est souvent qu'un enjeu, une sorte de champ de bataille, mais le combat qui s'y livrevise d'une part à conquérir les parents, d'autre part à prendre, à un plus haut niveau, le pouvoir [dans unedémocratie, une voix (masculine) en vaut une autre : celle de l'ouvrier ou du paysan vaut celle du grand patron oudu gros propriétaire terrien : l'école est le terrain favori de toute campagne électorale].
Chez monsieur le curé, onendoctrine en faisant entrer dans la tête des enfants la peur des «rouges» (c'est la couleur des idées ditesavancées des socialistes) ; de l'autre on fait voir les mérites de la République dispensant le savoir, en opposition auxobscurantistes qui ont toujours refusé d'éclairer les pauvres pour les maintenir dans un esclavage jugé salutaire poureux.
Tel est, très vite résumé, le principe de la guerre scolaire qui oppose l'école confessionnelle à l'écolerépublicaine [on parle aujourd'hui d'école libre (comme si l'autre ne l'était pas) ou privée, — le mot est plus juste —et d'école publique : la couleur «confessionnelle» étant davantage effacée].
Désormais les propos de Jules Ferry deviennent clairs : moins que de «cultiver» les enfants, il s'agit de leurtransmettre la bonne parole républicaine : d'où le mépris du politicien pour les «discours», les «dissertationssavantes», les «brillants exposés» ou le «docte enseignement» : on remarquera, par l'étude du champ lexical, lerejet de tout ce qui est éminemment culturel (savant, brillant, docte), c'est-à-dire de l'ordre du pur «savoir» ; lerejet aussi de tout ce qui tourne autour de la réflexion et du maniement des idées : discours, dissertations, exposéssont condamnés en bloc.
Sont refusées des disciplines qui toutes renvoient à l'intellectualité, au philosophique, brefà tout ce qui est réservé à l'enseignement de l'étage supérieur, le «secondaire», auquel seule l'élite a accès (l'élitesociale bien sûr, mais aussi ceux qui réussiront, parce qu'ils sont les meilleurs, à sortir brillamment du primaire républicain et de leur classe sociale modeste).
Pour l'heure, le propos est plus modeste, ou plus ambitieux, celadépend des points de vue de chacun.
L'école n'est pas conçue comme une «machine» à dispenser desconnaissances (c'est l'affaire du «lycée»), mais comme un lieu où l'on éduque : «la famille et la société vousdemandent de les aider», écrit Ferry.
L'instituteur est un «délégué», un envoyé de la «société» au service des«familles».
La famille est jugée incapable d'élever seul l'enfant (et de l'élever, surtout, dans le sens de la nouvelleidéologie, puisque dans sa majorité la «famille» française rurale ne la partage pas encore) : on lui adjoint donc laprésence d'un instituteur chargé d'expliquer la bonne parole, de former les esprits, d'éclairer les âmes...
«aider à bienélever (les) enfants» et «à en faire des honnêtes gens».
Il semble qu'il y ait là le principe sur lequel tout le systèmescolaire de la Ille République repose ; l'ignorer implique de nombreux contresens : l'école doit certes apprendre,instruire, transmettre des notions de base (c'est tellement évident qu'il n'est nul besoin de le rappeler : l'instituteur.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans une lettre de novembre 1883, Jules Ferry décrit à l'instituteur son rôle concernant l'enseignement de la morale.
- L'auteur de la Lettre sur la comédie du Misanthrope écrit: Molière n'a pas voulu faire une comédie pleine d'incidents, mais une pièce seulement où il pût parler contre les moeurs du siècle. En passant en revue les caractères et les portraits tracés dans le Misanthrope, vous direz ce que cette pièce nous apprend sur la société du 17e siècle ?
- Commentaire littéraire Le père Goriot : en quoi le discours de Madame de Beauséant visant à instruire Rastignac et l’aider pour ses aspirations est à la fois celui d’une connaisseuse aguerrie du monde qui l’entoure, et aussi celui d’une femme blessée par cette société, tout en portant notre regard sur le stratagème proposé
- Thierry Maulnier écrit dans son Racine (p. 70, Gallimard, édit.) : « Montrer sur la scène des monstres ou des meurtres, montrer du sang, montrer de brillants costumes ou des foules ou des batailles, tout cela est bon pour des primitifs, des romantiques ou des enfants. La grandeur et la gloire de l'homme sont d'avoir cessé de montrer parce qu'il a appris à dire. L'art le plus affiné et le plus complexe est nécessairement l'art où le langage - honneur des hommes, dit le poète - a la plac
- Dans la Préface de La Mare au diable (1851), Georges Sand écrit : Nous ne voulons pas dénier aux artistes le droit de sonder les plaies de la société