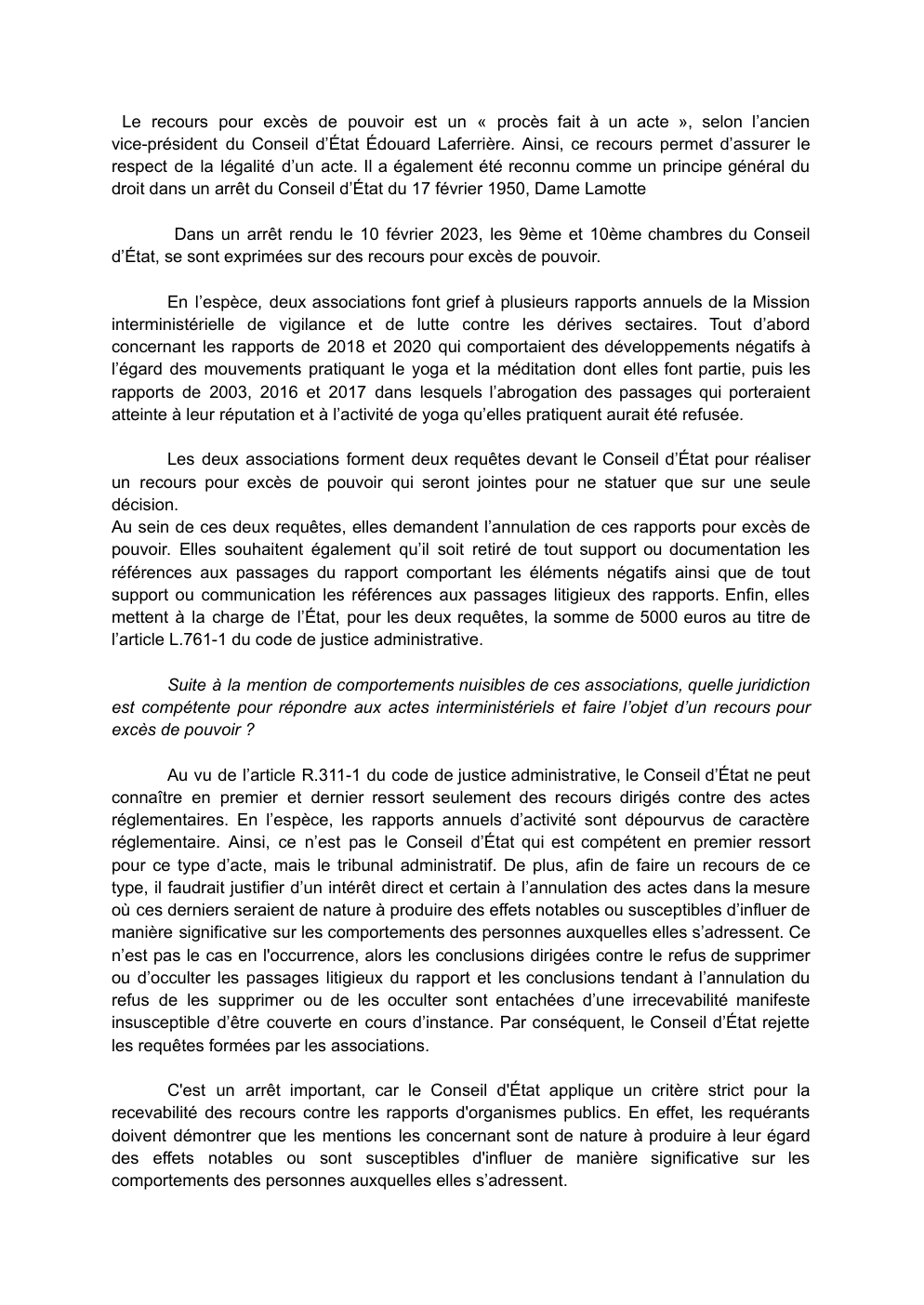droit administratif
Publié le 09/02/2025
Extrait du document
«
Le recours pour excès de pouvoir est un « procès fait à un acte », selon l’ancien
vice-président du Conseil d’État Édouard Laferrière.
Ainsi, ce recours permet d’assurer le
respect de la légalité d’un acte.
Il a également été reconnu comme un principe général du
droit dans un arrêt du Conseil d’État du 17 février 1950, Dame Lamotte
Dans un arrêt rendu le 10 février 2023, les 9ème et 10ème chambres du Conseil
d’État, se sont exprimées sur des recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, deux associations font grief à plusieurs rapports annuels de la Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
Tout d’abord
concernant les rapports de 2018 et 2020 qui comportaient des développements négatifs à
l’égard des mouvements pratiquant le yoga et la méditation dont elles font partie, puis les
rapports de 2003, 2016 et 2017 dans lesquels l’abrogation des passages qui porteraient
atteinte à leur réputation et à l’activité de yoga qu’elles pratiquent aurait été refusée.
Les deux associations forment deux requêtes devant le Conseil d’État pour réaliser
un recours pour excès de pouvoir qui seront jointes pour ne statuer que sur une seule
décision.
Au sein de ces deux requêtes, elles demandent l’annulation de ces rapports pour excès de
pouvoir.
Elles souhaitent également qu’il soit retiré de tout support ou documentation les
références aux passages du rapport comportant les éléments négatifs ainsi que de tout
support ou communication les références aux passages litigieux des rapports.
Enfin, elles
mettent à la charge de l’État, pour les deux requêtes, la somme de 5000 euros au titre de
l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Suite à la mention de comportements nuisibles de ces associations, quelle juridiction
est compétente pour répondre aux actes interministériels et faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir ?
Au vu de l’article R.311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’État ne peut
connaître en premier et dernier ressort seulement des recours dirigés contre des actes
réglementaires.
En l’espèce, les rapports annuels d’activité sont dépourvus de caractère
réglementaire.
Ainsi, ce n’est pas le Conseil d’État qui est compétent en premier ressort
pour ce type d’acte, mais le tribunal administratif.
De plus, afin de faire un recours de ce
type, il faudrait justifier d’un intérêt direct et certain à l’annulation des actes dans la mesure
où ces derniers seraient de nature à produire des effets notables ou susceptibles d’influer de
manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s’adressent.
Ce
n’est pas le cas en l'occurrence, alors les conclusions dirigées contre le refus de supprimer
ou d’occulter les passages litigieux du rapport et les conclusions tendant à l’annulation du
refus de les supprimer ou de les occulter sont entachées d’une irrecevabilité manifeste
insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Par conséquent, le Conseil d’État rejette
les requêtes formées par les associations.
C'est un arrêt important, car le Conseil d'État applique un critère strict pour la
recevabilité des recours contre les rapports d'organismes publics.
En effet, les requérants
doivent démontrer que les mentions les concernant sont de nature à produire à leur égard
des effets notables ou sont susceptibles d'influer de manière significative sur les
comportements des personnes auxquelles elles s’adressent.
De plus, l'arrêt indique que le Conseil d'État n’est pas compétent en premier ressort pour
des actes qui ne sont ni des actes réglementaires, ni des circulaires, ni des instructions de
portée générale au sens de l'article R.
311-1 du code de justice administrative.
Ainsi, il convient d’invoquer la qualification juridique des rapports de la Mivilude (I), puis nous
étudierons les conditions de recevabilité des recours devant le Conseil d’État (II).
I - Qualification juridique des rapports de la mivilude
Des rapports de nature non contraignante (A) peuvent faire l’objet d’une qualification portant
sur la catégorie de droit souple (B).
A - Des rapports de nature non contraignante
Les rapports annuels de la Miviludes, bien que importants pour la prévention des risques,
n'ont pas de caractère contraignant et n'influencent pas directement les droits et obligations
des individus.
Le Conseil d'État a d'abord rejeté les requêtes des associations demandant
l'annulation de ces rapports, estimant qu'ils ne présentent ni caractère réglementaire ni force
obligatoire.
Ainsi, ces rapports ne produisent pas d’effet direct sur les droits et obligations
des individus, ce qui les rend non-contraignants.
Le Conseil d’État a également précisé que
ces rapports ne sont pas des actes réglementaires, puisqu'ils ne créent aucune nouvelle
obligation juridique et ne sont ni des circulaires, ni des instructions de portée générale,
excluant ainsi tout recours pour excès de pouvoir.
L'article R.
311-1 du Code de justice
administrative précise que le Conseil d'État est compétent pour connaître des recours contre
les actes réglementaires, les circulaires et les instructions de portée générale, mais les
rapports de la Miviludes n'entrent pas dans cette catégorie, car ils ne créent pas de
nouvelles obligations juridiques et n'ont pas de caractère contraignant direct.
De plus, bien
qu’ils relatent des informations et mettent en garde contre certains risques, ces rapports ne
confèrent aucun pouvoir exécutoire ni effet contraignant aux entités auxquelles ils se
réfèrent, et leur impact reste essentiellement informatif et préventif, sans dimension
coercitive.
En s’appuyant sur la jurisprudence de l'arrêt Société Fairvesta International (CE,
Ass., 21 mars 2016), où il a été précisé qu’un acte administratif produisant un impact
notable, sans caractère contraignant, peut néanmoins faire l’objet d’un recours, le Conseil
d’État a réaffirmé que les rapports de la Miviludes ne créent aucune obligation juridique
directe et ne peuvent, de ce fait, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
B - Une qualification portant sur la catégorie de droit souple
Dans l’arrêt rendu le 10 février 2023, le Conseil d'État qualifie les rapports de la Miviludes de
documents relevant du « droit souple ».
Le droit souple désigne l’ensemble des règles dont
la portée juridique est discutée, par opposition au droit classique.
Il est constitué d’outils et
de dispositifs qui s’apparentent à des règles ayant pour objet de modifier ou d’orienter des
comportements sans créer de contraintes.
Le Conseil d’État estime qu’un acte de droit souple doit remplir trois conditions : tout
d’abord, il faut qu’il ait pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de ses
destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion, il faut également que
l’acte ne crée pas des droits ou des obligations pour ses destinataires, et enfin, il faut qu’il ait
un degré de formalisation et de structuration qui les apparente....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire d’arrêt Droit administratif Commentaire d’arrêt : doc 2 , T.C. 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot
- Jacques CHEVALLIER: Le droit administratif, droit de privilège ?
- Droit Administratif - Cours
- L'introduction du droit administratif
- Td droit administratif sur la Constitution