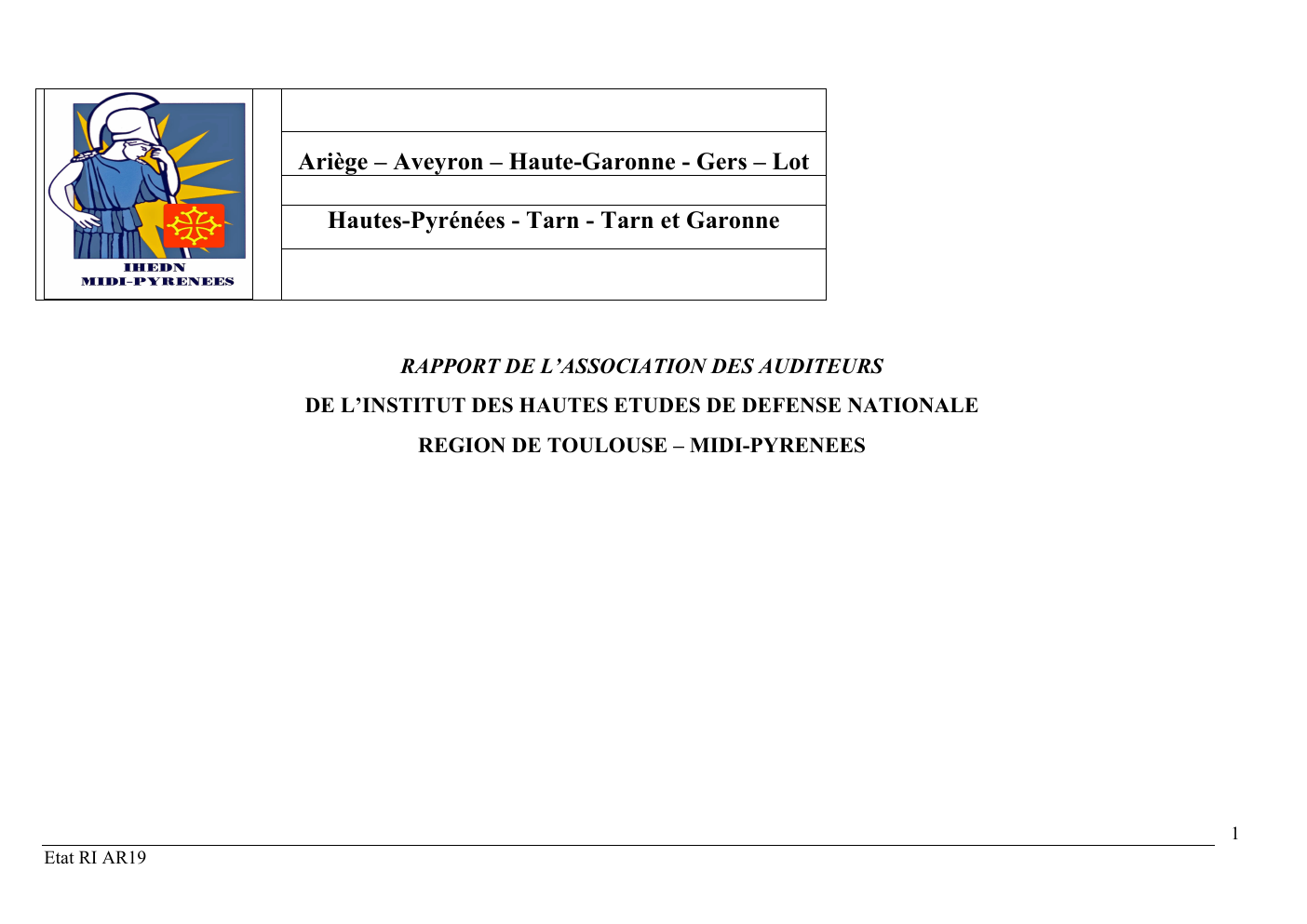Droit
Publié le 31/01/2025
Extrait du document
«
RAPPORT DE L’ASSOCIATION DES AUDITEURS
DE L’INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE
REGION DE TOULOUSE – MIDI-PYRENEES
1
Etat RI AR19
L’Etat dans les relations internationales
Cycle d’études 2009-2010
Rapporteur : Jean-François HURSTEL
Groupe de travail de Toulouse (Samedi)
2
Etat RI AR19
Liste des membres de l’AR 19 Midi-Pyrénées qui ont contribué à la réflexion sur le sujet proposé et à la rédaction du présent rapport :
Rapporteur Général : Jean-François HURSTEL
Groupe de travail du Tarn :
Georges AIX - Bernard CALASTRENG - Thierry de COURTIVRON (correspondant 8ème RPIMa) - Jean-Claude DEBART - Jean DECOUARD - Jean-Louis
DELJARRY - Jean-Pierre DUSSAIX (Rapporteur) - Pierre ESCANDE (Rapporteur adjoint) - Eric LESUEUR - Jean-Jacques GROS - Pascal ICHES - Ronan
LEAUSTIC - Jean-François MAZALEYRAT - Julien PRATT (correspondant 8ème RPIMa) - Philippe SAINT-JEAN - Jean-Michel VAZZOLER - Michel
VIDAL - Pierre-Alain VILLARD (Président).
Groupe de travail de Toulouse (Samedi) :
Marc BEAUVOIS - Jean BOURDEL - Bernard BOUSQUET - Gérard BRAULT-NOBLE - Thierry DARNEY (Secrétaire) - Christian DAUCH - MichelJoseph DURAND - Pierre FAUCOUP - Guy FRANCO - David de GAINZA - Philippe GELLE - Olivier de GENTIL BAICHIS (Secrétaire) – Jean-François
HURSTEL (Rapporteur) - François LAPLANE - Jean-Pierre MARICHY - Christelle MATHEU - Eric MAUGARD - Jean SARDA - Anne-Marie
SAUTEREAU (Présidente) - Marie-Françoise VOIDROT - Anne-Catherine WELTE.
3
Etat RI AR19
4
Etat RI AR19
Table des matières
Introduction ..............................................................................................................................
8
Quelques généralités préalables .................................................................................................
8
Première partie : Les effets négatifs de la mondialisation post étatique...........................
11
A Ambiguïté de la mondialisation.........................................................................................
11
1
Les effets positifs de la mondialisation.
.....................................................................
11
2
Ne doivent pas en dissimuler les risques.
..................................................................
11
B Ambiguïté de l’évolution de l’Etat ...................................................................................
12
1
Certains acteurs nouveaux manifestent une démocratisation du système international.
12
2
D’autres révèlent la résurgence de nouvelles féodalités ..........................................
16
3
Et les défaillances de l’Etat peuvent affaiblir l’organisation internationale.
........
17
C Insuffisance des substituts de l’Etat.................................................................................
17
1
Faiblesses des organisations internationales :...........................................................
17
2
Insuffisante concrétisation de la « communauté internationale » : .......................
18
Deuxième partie : Redéfinition du rôle international de l’Etat .........................................
19
A Pérennité de la puissance Etatique.
.................................................................................
19
1
Résistances de l’Etat face à la mondialisation :........................................................
19
2
Recours à l’Etat face à l’aggravation des crises .......................................................
20
B L’adaptation de l’Etat à l’évolution de ses fonctions .....................................................
20
1
Modérer les « résistances » traditionnelles de l’Etat-Nation...................................
21
2
Préciser les nouvelles fonctions de l’Etat ..................................................................
22
3
Restructurer l’organisation interétatique de l’ordre international........................
22
Troisième partie : Concrétisation du rôle de l’Etat par une politique internationale plus réaliste : 23
A.
Conditions internes de la crédibilité de l’Etat.
.........................................................
23
1.
Revenir aux valeurs fondamentales : Recréer du lien et garantir de la protection23
2.
Réaffirmer sa puissance et favoriser le retour « du politique » ..............................
25
B.
orientations dans les relations internationales : .......................................................
26
1.
S’investir sur les problématiques de long terme : ....................................................
26
2.
Tenir compte des approches culturelles :..................................................................
30
3.
S’adapter aux nouvelles conditions des Relations Internationales.........................
31
Quatrième partie : Nécessité de clarifier le cadre de l’Union Européenne.......................
34
A.
Renoncer aux illusions ................................................................................................
34
1.
Abandonner le messianisme par l’exemple : ............................................................
34
5
Etat RI AR19
2.
Admettre « la fin du temps des chimères » :.............................................................
34
B.
Tenir compte des réalités............................................................................................
35
1.
« Exister pour compter » :..........................................................................................
35
2.
Tenir compte des réalités sécuritaires :.....................................................................
35
C.
Développer des synergies avec nos voisins européens orientaux ............................
36
Conclusions .............................................................................................................................
36
Eléments de Bibliographie.....................................................................................................
38
Annexe : Les organes de la Gouvernance mondiale ................................................................
40
6
Etat RI AR19
Thème de travail
L’ETAT DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES
A la fin du XXème siècle, l’Etat était considéré par certains comme un héritage du passé, que la mondialisation et l’autonomie croissante des sociétés civiles ne
tarderaient pas à rejeter en dehors de l’histoire.
Les relations internationales étaient alors envisagées dans une approche sociologique, intégrant l’ensemble des
rapports sociaux dans chacune de leurs dimensions, civiles, économiques, politiques.
L’idée d’une gouvernance globale, marquée par une fluidité de relations
entre des groupes multiples se substituait alors à une fragmentation territoriale et nationale considérée comme dépassée.
Avec le recul du temps, cette analyse apparaît de nature essentiellement idéologique, portée par un idéal d’universalisme, de développement de valeurs
communes comme les droits de l’homme, de protection de « biens communs » comme l’environnement.
Cette mondialisation positive reposant sur l’effacement
des frontières, la transparence des sociétés, la conscience collective d’une solidarité entre les groupes, n’a cependant pas trouvé d’écho immédiat dans la société
internationale.
Le début du XXIème siècle n’est pas marqué par une disparition des frontières, mais bien davantage par leur multiplication et leur renforcement.
Multiplication, car la disparition du bloc soviétique s’est traduite par des revendications de minorités soudées par une langue, une religion, voire des frustrations
communes, et désireuses de se constituer en Etat.
Certaines y sont parvenues comme au Kosovo, d’autres sont à l’origine de conflits parfois violents comme en
Tchétchénie, en Abkhazie ou en Ossétie du Sud.
Renforcement des frontières aussi, car les Etats ont été confrontés à des facettes négatives de la mondialisation.
L’immigration clandestine comme la menace
terroriste ont incité les autorités publiques à renforcer leurs prérogatives et les contrôles des frontières.
La crise financière et économique a également suscité
un interventionnisme nouveau, par le contrôle du secteur bancaire et la mise en œuvre de plans de relance.
Non seulement l’institution étatique n’est pas actuellement remise en cause, mais elle est même considérée comme une solution à bien des problèmes.
C’est
ainsi que la défaillance des Etats constitue une menace pour la sécurité internationale, comme en témoigne le développement de la piraterie dans le Golfe
d’Aden, contre laquelle la Somalie se révèle incapable de lutter.
Ce sont alors des forces navales étatiques qui interviennent, cependant que la communauté
internationale s’efforce dans d’autres situations de reconstruire les Etats, de les aider à créer des services publics, de leur donner les moyens d’exercer leur
autorité sur leur territoire et à l’égard de leur population.
De la même manière, les Etats faillis, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus en mesure d’assurer le
paiement d’une dette publique souvent colossale, bénéficient-ils d’une aide internationale qui, en apurant leur situation financière, va leur donner les moyens de
rétablir le fonctionnement de leurs services publics.
Les auditeurs sont donc invités à réfléchir sur l’institution étatique et sur son rôle dans la société internationale.
L’Etat y joue évidemment un rôle stabilisateur
en assurant l’organisation paisible d’une collectivité sur un espace donné.
A ce titre, il concourt au fonctionnement harmonieux de la société internationale,
notamment par le développement d’une coopération pacifique.
Mais l’Etat peut aussi apparaître comme un élément déstabilisateur, lorsqu’il rencontre des
difficultés qu’il ne peut résoudre seul.
Sa faiblesse pose alors un problème à l’ensemble de la communauté internationale dont la sécurité risque d’être menacée.
Au cœur d’un double mouvement de stabilisation et de déstabilisation, l’Etat peut ainsi être étudié à travers des prismes multiples.
7
Etat RI AR19
Introduction
Toute réflexion sur le rôle actuel de l’Etat dans le Relations Internationales implique d’abord le rappel de quelques généralités, d’une part sur l’émergence
historique de l’institution étatique et sa reconnaissance dans ce qu’il est convenu d’appeler « l’ordre westphalien et d’autre part sur la définition et l’évolution
du concept.
Sur ces bases, on pourrait admettre que, face aux effets négatifs d’une mondialisation qui tend à privilégier la seule notion d’un marché faisant peu cas des
valeurs humanistes et conduit ainsi à un affaiblissement de l’Etat sans lui donner de véritable successeur, il devient nécessaire de redéfinir ce que pourrait être le
nouveau rôle international de l’Etat.
Mais pour crédibiliser celui-ci, il convient que les états qui, comme la France, entendent jouer pleinement un rôle dans les
Relations Internationales élaborent une politique internationale plus réaliste dont on pourrait esquisser les grands principes tout en soulignant que dans le
contexte contemporain, il est également indispensable de clarifier les rapports entre les Etats Nations et l’Union Européenne qui, sans les remplacer, devrait
mieux coordonner leurs actions en vue de promouvoir les valeurs qui les inspirent.
Quelques généralités préalables
L’émergence de l’Etat sur le plan interne aboutit, partout en Europe, à la monarchie absolue.
L’évolution du monde européen du Moyen Age aux Temps Modernes (du Xème au XVIème siècle) a été marquée par la naissance progressive de l’Etat sur le
plan interne et l’affirmation de son rôle sur le plan international, sanctionné par les Traités de Westphalie (1648) qui définissent les bases de l’ordre européen
jusqu’au XX° siècle : c’est l’ordre westphalien.
Puis c’est la reconnaissance du rôle éminent des Etats sur le plan international.
L’ordre Westphalien qui sanctionnait un état de fait progressivement établi, était fondé sur trois principes corrélatifs : celui de l’autonomie religieuse des états
(cujus regio ejus religio) celui de la souveraineté des états impliquant leur indépendance internationale et celui de l’égalité....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Cours droit constitutionnel
- Révisions droit Programme de première
- Cours L3 Droit
- PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DROITS DE LA DÉFENSE C.E. 5 mai 1944, Dame Veuve TROMPIER-GRAVIER, Rec. 133
- droit des biens: Cass. 3e civ., 23 janv. 2002, n° 99-18.102, publié