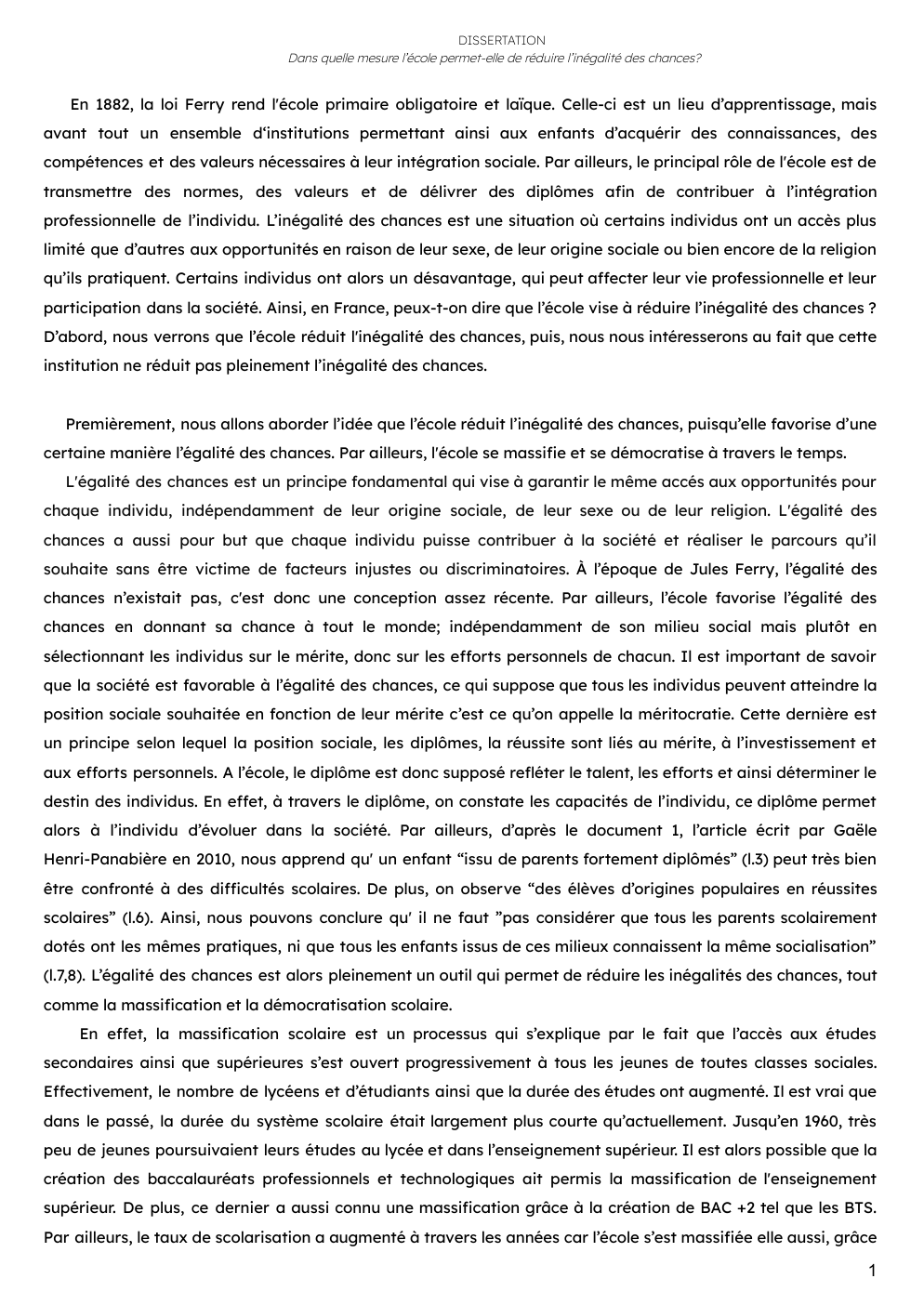Dissertation " Dans quelle mesure l’école permet-elle de réduire l’inégalité des chances? "
Publié le 11/04/2025
Extrait du document
«
DISSERTATION
Dans quelle mesure l’école permet-elle de réduire l’inégalité des chances?
En 1882, la loi Ferry rend l'école primaire obligatoire et laïque.
Celle-ci est un lieu d’apprentissage, mais
avant tout un ensemble d‘institutions permettant ainsi aux enfants d’acquérir des connaissances, des
compétences et des valeurs nécessaires à leur intégration sociale.
Par ailleurs, le principal rôle de l'école est de
transmettre des normes, des valeurs et de délivrer des diplômes afin de contribuer à l’intégration
professionnelle de l’individu.
L’inégalité des chances est une situation où certains individus ont un accès plus
limité que d’autres aux opportunités en raison de leur sexe, de leur origine sociale ou bien encore de la religion
qu’ils pratiquent.
Certains individus ont alors un désavantage, qui peut affecter leur vie professionnelle et leur
participation dans la société.
Ainsi, en France, peux-t-on dire que l’école vise à réduire l’inégalité des chances ?
D’abord, nous verrons que l’école réduit l'inégalité des chances, puis, nous nous intéresserons au fait que cette
institution ne réduit pas pleinement l’inégalité des chances.
Premièrement, nous allons aborder l’idée que l’école réduit l’inégalité des chances, puisqu’elle favorise d’une
certaine manière l’égalité des chances.
Par ailleurs, l'école se massifie et se démocratise à travers le temps.
L'égalité des chances est un principe fondamental qui vise à garantir le même accés aux opportunités pour
chaque individu, indépendamment de leur origine sociale, de leur sexe ou de leur religion.
L'égalité des
chances a aussi pour but que chaque individu puisse contribuer à la société et réaliser le parcours qu’il
souhaite sans être victime de facteurs injustes ou discriminatoires.
À l’époque de Jules Ferry, l’égalité des
chances n’existait pas, c'est donc une conception assez récente.
Par ailleurs, l’école favorise l’égalité des
chances en donnant sa chance à tout le monde; indépendamment de son milieu social mais plutôt en
sélectionnant les individus sur le mérite, donc sur les efforts personnels de chacun.
Il est important de savoir
que la société est favorable à l’égalité des chances, ce qui suppose que tous les individus peuvent atteindre la
position sociale souhaitée en fonction de leur mérite c’est ce qu’on appelle la méritocratie.
Cette dernière est
un principe selon lequel la position sociale, les diplômes, la réussite sont liés au mérite, à l’investissement et
aux efforts personnels.
A l’école, le diplôme est donc supposé refléter le talent, les efforts et ainsi déterminer le
destin des individus.
En effet, à travers le diplôme, on constate les capacités de l’individu, ce diplôme permet
alors à l’individu d’évoluer dans la société.
Par ailleurs, d’après le document 1, l’article écrit par Gaële
Henri-Panabière en 2010, nous apprend qu' un enfant “issu de parents fortement diplômés” (l.3) peut très bien
être confronté à des difficultés scolaires.
De plus, on observe “des élèves d’origines populaires en réussites
scolaires” (l.6).
Ainsi, nous pouvons conclure qu' il ne faut ”pas considérer que tous les parents scolairement
dotés ont les mêmes pratiques, ni que tous les enfants issus de ces milieux connaissent la même socialisation”
(l.7,8).
L’égalité des chances est alors pleinement un outil qui permet de réduire les inégalités des chances, tout
comme la massification et la démocratisation scolaire.
En effet, la massification scolaire est un processus qui s’explique par le fait que l’accès aux études
secondaires ainsi que supérieures s’est ouvert progressivement à tous les jeunes de toutes classes sociales.
Effectivement, le nombre de lycéens et d’étudiants ainsi que la durée des études ont augmenté.
Il est vrai que
dans le passé, la durée du système scolaire était largement plus courte qu’actuellement.
Jusqu’en 1960, très
peu de jeunes poursuivaient leurs études au lycée et dans l’enseignement supérieur.
Il est alors possible que la
création des baccalauréats professionnels et technologiques ait permis la massification de l'enseignement
supérieur.
De plus, ce dernier a aussi connu une massification grâce à la création de BAC +2 tel que les BTS.
Par ailleurs, le taux de scolarisation a augmenté à travers les années car l’école s’est massifiée elle aussi, grâce
1
au fait que tous les enfants d’au moins trois ans soient scolarisés.
En effet, d’après le document 3, évoquant la
fréquentation des classes préparatoires d’après Muriel Darmon, nous constatons que “le nombre d’étudiants
inscrits en classes préparatoires ou dans les grandes écoles a quasiment doublé” (l.1,2) “les classes
préparatoires se sont multipliées” (l.1).
On remarque alors la massification scolaire avec l’exemple des classes
préparatoires car ces dernières ont ouvert leurs accès à tous les jeunes de toutes classes sociales.
Cependant,
les inégalités persistent mais la démocratisation scolaire rentre en compte.
Aussi, la démocratisation scolaire désigne une situation où l'accès à une filière ou un niveau de diplôme
donné ne dépend pas de l’origine sociale.
La démocratisation scolaire a pour conséquence l’affaiblissement du
lien entre le niveau d’études et l'origine sociale.
Il est vrai, qu’une part de plus en plus grande d’enfants
d’ouvriers et employés ayant le bac occupe une fonction de cadre à l'issue de leurs études.
Toutefois, la
démocratisation qualitative ne s’améliore pas vraiment.
En effet, d’après le document 4, présentant la part des
jeunes ayant un emploi de cadre, de professions intermédiaires ou d’indépendants en 2016 selon le diplôme et
l’origine sociale; nous pouvons observer que seulement 25% des enfants d’ouvrier ou d’employés sont sortis du
système scolaire avec un baccalauréat et sont maintenant cadres, indépendants ou travaillent dans les
professions intermédiaires.
Cela s’oppose au 33% d’ élèves, étant sortis du système scolaire à la suite du bac et
qui sont maintenant cadres, indépendants ou travaillent dans les professions intermédiaires; ces 33% étant
issus de parents cadres, indépendants ou qui travaillent dans les professions intermédiaires.
On remarque donc
un écart de 8 points entre les deux catégories d’enfants issues tous les deux de deux origines sociales
différentes.
Cette observation se confirme également pour les enfants d'ouvriers ayant fait des études
supérieures longues, ils sont 81% contre 88% concernant les enfants de cadres, d’indépendants ou de parents
qui travaillent dans les professions intermédiaires.
Ainsi, cela permet de mettre en évidence le fait que la part
de réussite entre les enfants d’ouvriers ou les enfants de cadre est minime.
Ainsi, l’école réduit l’inégalité de chances grâce à la présence et au développement important de l’égalité
des chances, ainsi que grâce à la massification et la démocratisation scolaire
Cependant, l’école ne réduit pas pleinement l’inégalité des chances, en effet, le capital culturel entre en jeu,
ainsi que le lieu d’apprentissage qui crée des inégalités entre les élèves, nous pouvons aussi observer, un
renforcement des inégalités filles/garçons causé par l'école.
Le capital culturel est d’après Pierre Bourdieu,
l’ensemble des ressources culturelles valorisables d’un
individu.
Pierre Bourdieu est un sociologue français du XX et XXIème siècle, il pense ainsi que le capital
culturel s’observe sous trois formes: à l’état incorporé c’est à dire à l’oral ou à l’écrit et donc le rapport à la
culture; à l’état objectif, soit l’ensemble des biens culturels possédé par l’individu; et à l’état institutionnalisé
soit les diplômes.
Ce capital culturel est alors transmis par la socialisation des parents vers les enfants, mais de
façon quasi inconsciente, dès le plus jeune âge.
En effet, la socialisation désigne le processus par lequel les
individus acquièrent les normes culturelles, les valeurs, les comportements et les compétences nécessaires
pour fonctionner efficacement dans une société donnée.
C'est un processus continu qui commence dès la
petite enfance et qui se poursuit tout au long de la vie.
Ainsi, plus le capital culturel des parents est important,
alors, celui des enfants le sera aussi; on peut ainsi qualifier le capital culturel d’héritage familial.
Cependant,
tous les parents n’ont pas la même quantité et....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- est ce que l'école est source d'inégalité de réussite scolaire
- dans quelle mesure les classes sociales sont-elles un outil pertinent dans l’analyse de la société ? dissertation
- SES / grand oral sur inégalité scolaire et égalité des chances scolaire / Bourdieu , Merle, Boudon
- dissertation : Dans quelle mesure le personnage du valet suscite-t-il le rire du spectateur ?
- Une mesure plus précise de l'inégalité : « l'indice de développement humain » (IDH) ?