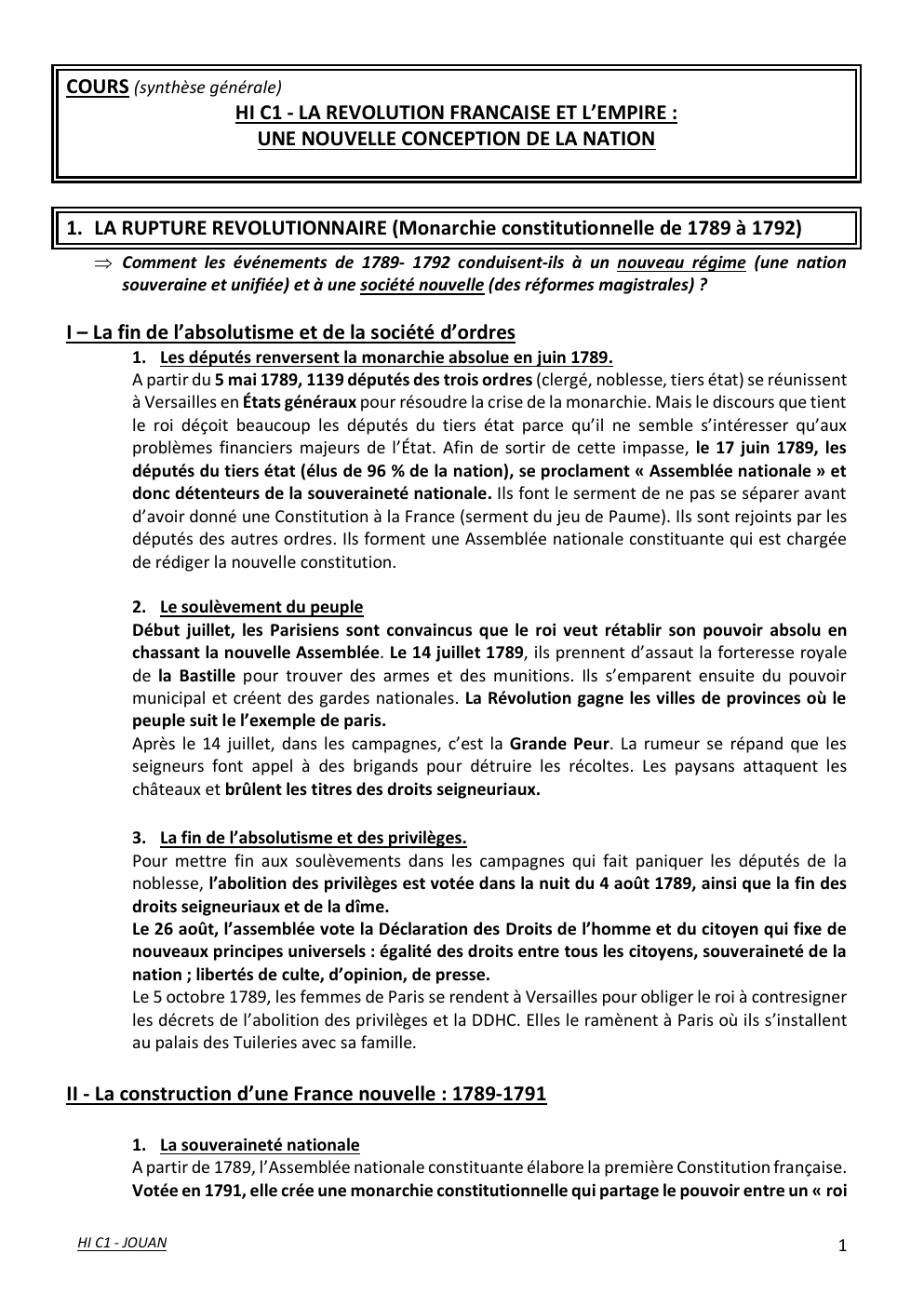COURS (synthèse générale) HI C1 - LA REVOLUTION FRANCAISE ET L’EMPIRE : UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA NATION
Publié le 08/02/2025
Extrait du document
«
COURS (synthèse générale)
HI C1 - LA REVOLUTION FRANCAISE ET L’EMPIRE :
UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA NATION
1.
LA RUPTURE REVOLUTIONNAIRE (Monarchie constitutionnelle de 1789 à 1792)
Þ Comment les événements de 1789- 1792 conduisent-ils à un nouveau régime (une nation
souveraine et unifiée) et à une société nouvelle (des réformes magistrales) ?
I – La fin de l’absolutisme et de la société d’ordres
1.
Les députés renversent la monarchie absolue en juin 1789.
A partir du 5 mai 1789, 1139 députés des trois ordres (clergé, noblesse, tiers état) se réunissent
à Versailles en États généraux pour résoudre la crise de la monarchie.
Mais le discours que tient
le roi déçoit beaucoup les députés du tiers état parce qu’il ne semble s’intéresser qu’aux
problèmes financiers majeurs de l’État.
Afin de sortir de cette impasse, le 17 juin 1789, les
députés du tiers état (élus de 96 % de la nation), se proclament « Assemblée nationale » et
donc détenteurs de la souveraineté nationale.
Ils font le serment de ne pas se séparer avant
d’avoir donné une Constitution à la France (serment du jeu de Paume).
Ils sont rejoints par les
députés des autres ordres.
Ils forment une Assemblée nationale constituante qui est chargée
de rédiger la nouvelle constitution.
2.
Le soulèvement du peuple
Début juillet, les Parisiens sont convaincus que le roi veut rétablir son pouvoir absolu en
chassant la nouvelle Assemblée.
Le 14 juillet 1789, ils prennent d’assaut la forteresse royale
de la Bastille pour trouver des armes et des munitions.
Ils s’emparent ensuite du pouvoir
municipal et créent des gardes nationales.
La Révolution gagne les villes de provinces où le
peuple suit le l’exemple de paris.
Après le 14 juillet, dans les campagnes, c’est la Grande Peur.
La rumeur se répand que les
seigneurs font appel à des brigands pour détruire les récoltes.
Les paysans attaquent les
châteaux et brûlent les titres des droits seigneuriaux.
3.
La fin de l’absolutisme et des privilèges.
Pour mettre fin aux soulèvements dans les campagnes qui fait paniquer les députés de la
noblesse, l’abolition des privilèges est votée dans la nuit du 4 août 1789, ainsi que la fin des
droits seigneuriaux et de la dîme.
Le 26 août, l’assemblée vote la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen qui fixe de
nouveaux principes universels : égalité des droits entre tous les citoyens, souveraineté de la
nation ; libertés de culte, d’opinion, de presse.
Le 5 octobre 1789, les femmes de Paris se rendent à Versailles pour obliger le roi à contresigner
les décrets de l’abolition des privilèges et la DDHC.
Elles le ramènent à Paris où ils s’installent
au palais des Tuileries avec sa famille.
II - La construction d’une France nouvelle : 1789-1791
1.
La souveraineté nationale
A partir de 1789, l’Assemblée nationale constituante élabore la première Constitution française.
Votée en 1791, elle crée une monarchie constitutionnelle qui partage le pouvoir entre un « roi
HI C1 - JOUAN
1
des Français » et une assemblée nationale élue.
Mais de nombreux députés se méfient du
peuple.
C’est pourquoi ils instaurent un suffrage censitaire qui privent les pauvres du droit de
vote.
Les libertés fondamentales sont reconnues : liberté de culte, liberté de presse, de réunion,
d’association.
De nombreux journaux font leur apparition, des clubs où on discute de politique
se forment, comme ceux des Jacobins ou des Cordeliers.
2.
La réorganisation de la France
Les privilèges de certaines provinces disparaissent.
L’organisation administrative est unifié :
l’Assemblée divise tout le territoire en départements, eux-mêmes divisés en districts, cantons
et communes.
Ils sont dirigés par des citoyens élus.
La justice est réformée avec des juges élus
et des jurys de citoyens pour juger des crimes.
Dans le domaine économique, les douanes intérieures sont supprimées ; l’Assemblée autorise
la liberté d’entreprise.
Pour résoudre les problèmes financiers de l’État, l’Assemblée confisque
et vend les biens du clergé puis réorganise l’Église en votant la Constitution civile du clergé en
1790 : prêtres et curés sont élus par les citoyens et reçoivent un salaire de l’État en tant que
fonctionnaires.
III - La fin de la monarchie
1.
La montée des oppositions
Mais le nouveau régime n’est pas accepté par tout le monde : dès 1789, des nobles émigrent
et espèrent que les souverains étrangers interviennent en France pour rétablir l’Ancien Régime.
En 1790, le pape condamne la Constitution civile du clergé ce qui conduit de nombreux prêtres
à la refuser : ce sont les prêtres réfractaires.
En juillet 1791, le roi cherche à quitter la France avec sa famille.
Il est reconnu à Varennes (en
Lorraine) et reconduit aux Tuileries.
Mais cette tentative de fuite lui fait perdre la confiance
des Parisiens.
Certains commencent alors à réclamer la République.
2.
La guerre affaiblit la monarchie
En avril 1792, l’Assemblée nationale déclare la guerre à l’Autriche : les armées autrichiennes
et prussiennes envahissent la France.
La patrie étant déclarée en danger, les fédérés viennent
défendre Paris.
Beaucoup de citoyens pensent que le roi est un traitre et ils l’accusent d’être responsable des
défaites.
Or le duc de Brunswick qui commande les troupes ennemies, menace Paris de
destruction le 25 juillet 1792 si les habitants maltraitent le roi.
Le manifeste de Brunswick
confirme les craintes du peuple de Paris ce qui met le feu aux poudres.
3.
La chute du roi en août 1792
Le 10 août 1792, les sans-culottes parisiens et les fédérés (gardes nationaux des villes de
province) prennent d’assaut le palais des Tuileries.
Sous la pression populaire, l’Assemblée
nationale fait emprisonner Louis XVI et sa famille à la prison du temple et annonce l’élection
d’une nouvelle Assemblée, la Convention, au suffrage universel masculin.
Le 20 septembre, la France révolutionnaire remporte sa première victoire à Valmy contre la
coalition des monarchies européennes.
Deux jours plus tard, le 22 septembre, la nouvelle
Convention proclame la République.
Sujet possible de question problématisée sur cette partie : comment l’Ancien Régime a-t-il été remplacé
par un nouvel ordre politique entre 1789 et 1791 ?
HI C1 - JOUAN
2
2.
LA NATION DECHIREE (République de 1792-1799)
Þ Comment s’expliquent les violences et l’instabilité politique durant cette période ?
I - La République divisée : 1792-1793
1.
Girondins et Montagnards : des frères ennemis
La Convention nationale est élue en septembre 1792 : elle comprend des groupes politiques
rivaux.
Les Girondins forment la droite de la nouvelle Assemblée : ils sont modérés et très
attachés aux principes de 1789, mails ils se méfient aussi du peuple ; ce sont eux qui exercent
le pouvoir au début de la République (chef : Brissot).
Les Montagnards siègent en haut des tribunes (d’où leur nom) : ils sont plus proches des sansculottes que les Girondins (parmi eux : Danton, Robespierre, Marat).
En bas de l’hémicycle, les députés de la Plaine : chacun des deux groupes a besoin de ces
députés pour obtenir la majorité à l’Assemblée.
2.
Le procès et l’exécution de Louis XVI
La Convention a en charge le sort du roi, accusé de trahison et de conspiration contre l’État.
Il
est légalement jugé (volonté des Girondins) et condamné à mort à une courte majorité.
Louis
XVI est guillotiné le 21 janvier 1793.
Le problème est que lors du procès, les Girondins se sont montrés indulgents par rapport à Louis
XVI, ce qui a renforcé la méfiance des sans-culottes parisiens à leur égard.
3.
La France envahie et déchirée
L’exécution du roi suscite une très vive émotion chez les souverains européens qui forment
une coalition armée contre la France.
En Vendée, les paysans refusent de rejoindre l’armée et
se soulèvent contre la République au nom du roi et de la religion.
A Paris, les sans-culottes veulent plus de mesures pour défendre la République : le 2 juin 1793,
ils obligent la Convention à faire arrêter 22 députés girondins dont Brissot et Roland.
Le pouvoir
tombe alors aux mains des Montagnards ; mais ce coup de force entraine la révolte des
départements qui restent fidèles aux Girondins (révolte fédéraliste).
II – La Terreur : 1793-1794
1.
La Terreur
Face aux dangers extérieurs (coalition) et intérieurs (révolte fédéraliste), la Convention,
dirigée par les Montagnards, désigne un Comité de Salut public.
Ses douze membres sont
chargés de gouverner : Robespierre met « la terreur à l’ordre du jour ».
Les mesures prises
sont radicales :
- La Convention décrète la levée en masse qui permet de recruter plus d’un million de
soldats en août 1793 (obligation miliaire pour tout homme célibataire de 18 à 25 ans).
- Elle vote en septembre la terrible loi des suspects qui permet d’arrêter toute personne
ennemie de la république ou suspectée de l’être.
Cette loi entraine de nombreuses
arrestations et des procès expéditifs devant le Tribunal révolutionnaire ; les suspects
sont souvent exécutés : prêtres réfractaires, Girondins, nobles.
- Elle mène aussi une politique de déchristianisation : le calendrier chrétien est remplacé
par un calendrier républicain qui débute le premier jour de la République.
Dans de
nombreuses villes, les Montagnards ferment les lieux de culte.
- Enfin,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Révolution française et l’empire : une nouvelle conception de la nation, dates et évènements
- Leçon 1 : La Révolution française et l’Empire : une nouvelle conception de la nation (1789-1814)
- La Révolution française et l’Empire : une nouvelle conception de la Nation
- CHAPITRE 3 – La difficile entrée dans l’âge démocratique : la Deuxième République et le Second Empire Cours 1. La Deuxième République (1848-1852) : entre espoirs et échecs (p. 92-93)
- Le code littéraire de chaque époque se base sur une conception esthétique que l'histoire et la culture d'une nation produisent. Cette conception esthétique se concrétise par la création de genres littéraires visant à donner des règles fixes à suivre et des contraintes à respecter. Cependant, les intellectuels ont souvent bouleversé ces genres en dissimulant des messages cachés. Si, d'une part, les genres représentent des codes narratifs, d'autre part, la langue a pu être utilisée com