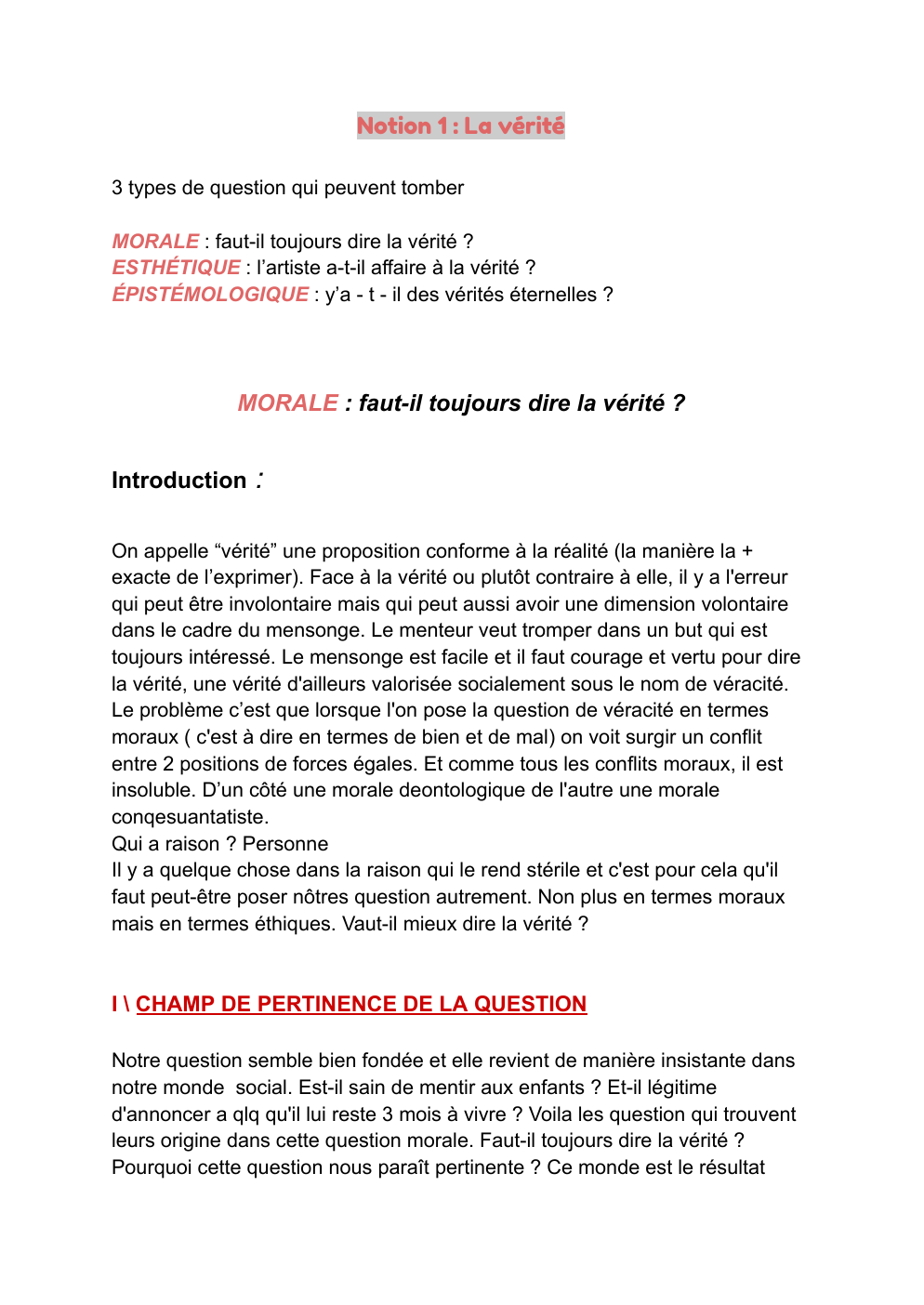COURS SUR LA VERITE
Publié le 29/03/2025
Extrait du document
«
Notion 1 : La vérité
3 types de question qui peuvent tomber
MORALE : faut-il toujours dire la vérité ?
ESTHÉTIQUE : l’artiste a-t-il affaire à la vérité ?
ÉPISTÉMOLOGIQUE : y’a - t - il des vérités éternelles ?
MORALE : faut-il toujours dire la vérité ?
Introduction
:
On appelle “vérité” une proposition conforme à la réalité (la manière la +
exacte de l’exprimer).
Face à la vérité ou plutôt contraire à elle, il y a l'erreur
qui peut être involontaire mais qui peut aussi avoir une dimension volontaire
dans le cadre du mensonge.
Le menteur veut tromper dans un but qui est
toujours intéressé.
Le mensonge est facile et il faut courage et vertu pour dire
la vérité, une vérité d'ailleurs valorisée socialement sous le nom de véracité.
Le problème c’est que lorsque l'on pose la question de véracité en termes
moraux ( c'est à dire en termes de bien et de mal) on voit surgir un conflit
entre 2 positions de forces égales.
Et comme tous les conflits moraux, il est
insoluble.
D’un côté une morale deontologique de l'autre une morale
conqesuantatiste.
Qui a raison ? Personne
Il y a quelque chose dans la raison qui le rend stérile et c'est pour cela qu'il
faut peut-être poser nôtres question autrement.
Non plus en termes moraux
mais en termes éthiques.
Vaut-il mieux dire la vérité ?
I \ CHAMP DE PERTINENCE DE LA QUESTION
Notre question semble bien fondée et elle revient de manière insistante dans
notre monde social.
Est-il sain de mentir aux enfants ? Et-il légitime
d'annoncer a qlq qu'il lui reste 3 mois à vivre ? Voila les question qui trouvent
leurs origine dans cette question morale.
Faut-il toujours dire la vérité ?
Pourquoi cette question nous paraît pertinente ? Ce monde est le résultat
d'une constitution qu'on appelle la jusés-christianime, avec une relecture des
textes de l'ancien testament.
Dans la Genèse, il y a un Dieu qui se proclame Dieu d'Israël, son nom est
YHVH (tétragramme).
Ce Dieu convoque Moïse en haut du mont Sinaï, et lui
transmet le décalogue (10 commandements.
L’an des commandements
prohibe le mense.
Voici le commandement :
“ Tu ne portera pas de faux témoignage”
On remarque que l’interdiction du mensonge n’est pas générale mais elle est
restreinte au domaine juridique ( c’est toujours le cas dans certaines
juridictions), mais par extensions, le christianisme finit par condamner tous
types de mensonges parce qu'il est assimilé à une volonté de fuir et faire du
mal.
Augustin dans ses confessions explique que le menteur et les pire
forme humaine qui soit puisque en travestissant la réalité, il combat et refuse
le monde que dieu a créé.
Dans d'autres cultures ses arguments n'ont aucune valeur.
Chez les
Grecques, il y a une fascination pour l’intelligence.
Il y a bien eu d'abord
l'intelligence théorique ( Theria : contemplation de Dieu).
Mais il y a aussi
évidemment ( intelligence pratique ( PRAXIS), l’un des noms qui reprend le
grecs pour le mot p pratique est METIS, la ruse.
Les Grecs vénèrent la ruse, ils la trouvent dans les animaux.
Et certains
grands hommes possèdent la ruse a un point artistique dans la réalité ou dans
la mythologie Alexandre a défait la ruse face à Danius.
Et le plus grand héro
grec se nomme Odysseos, Ulyme, il est “polymétis”, c'est l'homme aux
multiples ruses.
Il trompe, il ment et il a raison de le faire puisqu'il gagne.
On
voit donc bien que chez les grecs aime ce qui brille, ce qui est beau, le
clinquant d'où les mots de Nietzsche
“Les Grecs étaient superficielles”
Ils avaient compris la profondeur des apparences, le ruse, les illusions.
Et
c’est cela enfin qui explique la réussite des sophistes dans l'antiquité.
Les sophistes sont les inventeurs de la rhétorique c'est-à- dire de bien parler
donc le but de flatter.
C'est un usage stratégique du langage dans un monde
où il n'y a de vérité et où seul compte la victoire.
Ainsi la question n’a de sens
que dans un monde dans lequel domine l'idée de transcendance.,
d’immonance.
La sophistique (l’école qui enseigne à bien parler, à mentir avec
persuasion), a eu en Grèce une plus grande influence que la philosophie qui
est son adversaire.
On comprend donc que faire la vérité une question de moralité est une
question qui ne va pas de soi et qui n'a de sens que dans une civilisation qui a
un dieu transcendant (TRANSCENDANCE = caractère de ce qui est
supérieur et extérieur)
Le dieu de la bible et du coran est extérieur au monde et lui est superieur .
Dans une telle conception le coyan est en permanence juge non seulement
dans ses discours mais aussi ses intention , le contraire à la transcendance
est l'immanence ( caractère de ce qui est interieur, aucune extériorité)
Par exemple, la croyance hindoue au karma suppose une immanence.
Croire
en la transcendance, c'est poser des bases dans un monde moral cad qu'il y a
une stricte diff entre le bien et le mal.
Entrons dans un tel monde ( voyons s' il faut ou non dire la vérité et la dire
toujours)
II \ LE CONFLIT DE DEVOIRS
La morale comme la métaphysique est une fabrique de la dualité ( Bien / Mal).
La question de la vérité et du mensonge comporte elle-même une dualité que
nous allons exposer.
D’un côté une morale déontologique (repose sur les
principes qui n'admet aucune exception).
Kant en est le représentant le + célèbre.
Kant remarque que c’est sous la forme du devoir que l’action morale se
présente à nous.
Un devoir est ce qui prescrit la véracité d’une action considérée comme
bonne, il prend une forme un impératif.
En français, l'impératif se formule comme un “tu dois” ou “il faut”.
En Allemand
ou un anglais, il y a deux façons très différentes d'exprimer l'impératif.
Cette distinction est très importante pour Kant.
Parce que le devoir pour être accepté moral doit être accepté et voulu.
Quand j'obéis à un ordre parce c'est un ordre mon action n’est pas morale.
Comment savoir si mon action est morale ?
Kant nous explique qu’elle doit satisfaire à deux critères.
Doit êtres désintéressé : un mensonge n'est jamais désintéressé (
sauf cas pathologique : mythomane)
Critère d'universalisation : il faut que tout homme, en tous lieux , en
tout temps, puisse l'accomplir sans détruire le genre humain ou la
nature.
Le mensonge ne passe pas le test de l'universite, si tous les hommes
mentent, la société serait détruite.
Il n'y a PAS de mensonge moral.
Face à cette conception il y a une autre type de morale qu’on appelle
“conséquentialiste” et représentative du bon sens.
Voici son principe: ce sont les conséquences d’une action qui les rendent
morale ou pas.
Dans notre cas cette position est occupé par Benjamin Constant et qui
répond à Kant :
“ Avant de se demander s’il faut dire la vérité, encore faut-il savoir à qui on l’a
dit.”
C’est l'exemple du réfugié que donne Constant , faut-il livrer son nom à la
police si on sait quelle sort terrible lui est réservé ? Comment décider qui de
Kant ou Constant a raison ?
C’est tout le problème de la moralité nous y reviendrons.
Elle suscite un conflit de devoir comparable à celui qui oppose Antigone et
Créon et pour lequel il n'y a pas de solution.
Devant de telle conflit, le choix qu’on pourra faire sera toujours arbitraire et
pour l’instant il ne nous est pas possible de répondre à notre question.
C’est soit le signe qu’elle est insoluble soit qu’elle est mal posée.
III \ De la morale à l’éthique
Le verbe “falloir” dans ‘faut il dire la vérité” relève du registre de la morale
c'est-à- dire de la prétendue science du bien et du mal.
Le problème avec ces concepts c’est qu’ils se posent comme des absolus.
(séparer au sens de “sans relation à”).
Ce que cela veut dire ici c’est que ce qui est “bien ou mal” le serait toujours
hors de tout contexte.
Certaines actions seraient TOUJOURS bonnes ou mauvaises qu’importe qui
les fait, a qui ou pourquoi il les fait.
Est ce que ca existe une action toujours
bonne par exemple.
Pour l’illustrer on peut prendre l’exemple d’une minuscule séquence dessinée
par REISER dans “ la vie des bêtes “.
Séquence en 4 dessins :
●
●
●
●
Dessin 1 : un pauvre condamné subit la question lors de l’inquisition
Dessin 2 : on le dépose dans le désert inconscient
Dessin 3 : un moine passe par la et le voit
Dessin 4 : il se précipite vers lui, il le fait boire et le tue
Ce qu’on peut en déduire, c’est que c’est le contexte et lui seul qui détermine
la valeur moral d’une action et c’est pour cela que SPINOZA dans “l’ethique”
propose de remplacer les notions de bien (absolues) et de mal par bon et
mauvais (relatifs).
Le bon = ce qui augmente directement ma puissance d’agir ou....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA VERITE MEDICALECommentaires (2)Nous avons eu un problème d'enregistrement , il manque les quinze premières minutes de ce cours, nous vous prions de nousen excuser.
- Peut-on prédire les cours de la bourse a l'aide des mathematiques ?
- Cours: Histoire des institutions politiques
- Cours droit constitutionnel
- La politique monétaire (cours)