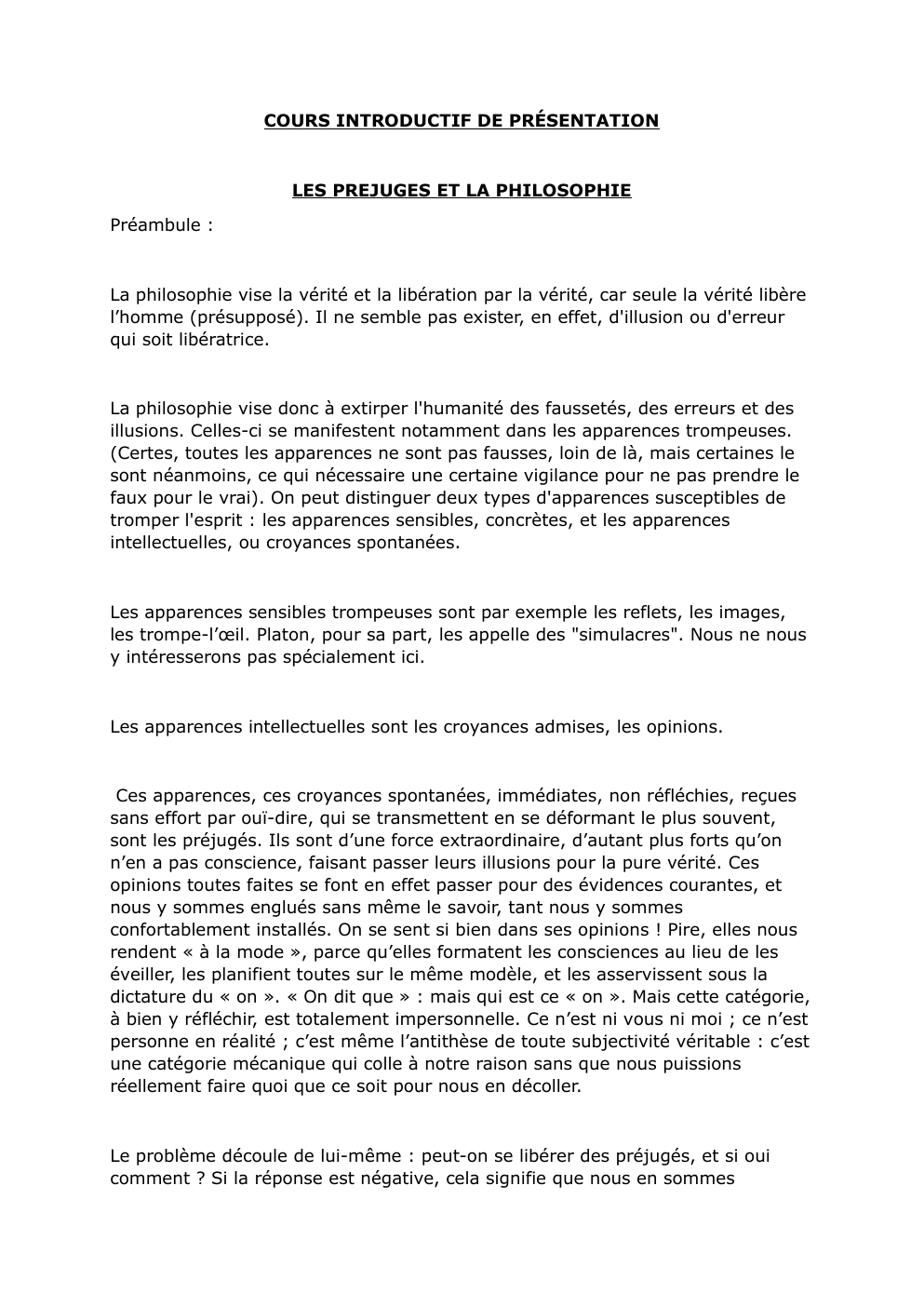COURS INTRODUCTIF DE PRÉSENTATION LES PREJUGES ET LA PHILOSOPHIE
Publié le 22/02/2025
Extrait du document
«
COURS INTRODUCTIF DE PRÉSENTATION
LES PREJUGES ET LA PHILOSOPHIE
Préambule :
La philosophie vise la vérité et la libération par la vérité, car seule la vérité libère
l’homme (présupposé).
Il ne semble pas exister, en effet, d'illusion ou d'erreur
qui soit libératrice.
La philosophie vise donc à extirper l'humanité des faussetés, des erreurs et des
illusions.
Celles-ci se manifestent notamment dans les apparences trompeuses.
(Certes, toutes les apparences ne sont pas fausses, loin de là, mais certaines le
sont néanmoins, ce qui nécessaire une certaine vigilance pour ne pas prendre le
faux pour le vrai).
On peut distinguer deux types d'apparences susceptibles de
tromper l'esprit : les apparences sensibles, concrètes, et les apparences
intellectuelles, ou croyances spontanées.
Les apparences sensibles trompeuses sont par exemple les reflets, les images,
les trompe-l’œil.
Platon, pour sa part, les appelle des "simulacres".
Nous ne nous
y intéresserons pas spécialement ici.
Les apparences intellectuelles sont les croyances admises, les opinions.
Ces apparences, ces croyances spontanées, immédiates, non réfléchies, reçues
sans effort par ouï-dire, qui se transmettent en se déformant le plus souvent,
sont les préjugés.
Ils sont d’une force extraordinaire, d’autant plus forts qu’on
n’en a pas conscience, faisant passer leurs illusions pour la pure vérité.
Ces
opinions toutes faites se font en effet passer pour des évidences courantes, et
nous y sommes englués sans même le savoir, tant nous y sommes
confortablement installés.
On se sent si bien dans ses opinions ! Pire, elles nous
rendent « à la mode », parce qu’elles formatent les consciences au lieu de les
éveiller, les planifient toutes sur le même modèle, et les asservissent sous la
dictature du « on ».
« On dit que » : mais qui est ce « on ».
Mais cette catégorie,
à bien y réfléchir, est totalement impersonnelle.
Ce n’est ni vous ni moi ; ce n’est
personne en réalité ; c’est même l’antithèse de toute subjectivité véritable : c’est
une catégorie mécanique qui colle à notre raison sans que nous puissions
réellement faire quoi que ce soit pour nous en décoller.
Le problème découle de lui-même : peut-on se libérer des préjugés, et si oui
comment ? Si la réponse est négative, cela signifie que nous en sommes
définitivement prisonniers, et que l’illusion triomphe à coup sûr contre toute
tentative de libération.
On voit bien ici que l’enjeu est de savoir si la philosophie
a une quelconque chance de libérer l’esprit humain de ces puissantes entraves.
I- Nature et causes du préjugé
1- Qu’est-ce qu’un préjugé ?
Avant tout, il faut savoir de quoi on parle, raison pour laquelle il faut sortir le
préjugé de sa cache pour le placer devant soi, à la lumière de la conscience, pour
le définir et essayer de comprendre ses causes.
Or, qu’est-ce qu’un préjugé ?
Etymologiquement parlant, c’est ce qui précède le jugement.
Définition : Le préjugé est un jugement précipité, une affirmation admise
d’emblée comme vraie, fondée sur des opinions mais non sur des arguments.
Les synonymes de préjugé sont : stéréotype, ouï-dire, a priori, lieu commun,
poncif, oukase, opinion en général.
Maintenant que nous savons de quoi nous parlons, il faut essayer de comprendre
pourquoi un préjugé apparaît en nous, en analysant ses différentes sources.
Il
faut savoir en effet que personne n’est véritablement sans préjugé, et surtout
pas ceux qui croient y échapper (les philosophes notamment).
2- Les causes des préjugés :
On peut trouver en effet au moins quatre causes différentes qui expliquent
l'apparition de préjugés en nous.
A) La société en général (éducation, presse, médias, influences sociales, religion,
politique, modes, spectacles, lectures, discussions, etc.)
C’est à l’évidence la source la plus commune des préjugés, qui orientent la façon
de comprendre les choses, et colore l’interprétation des questions que l’on se
pose.
Le mécanisme d'apparition est celui du mimétisme social, c'est-à-dire le fait
d'agir comme les autres pour s'intégrer socialement.
El suffit en effet (hélas) de
chercher à se démarquer trop pour être exclu d'un groupe social donné.
cf.
Texte n°1
II- Aucun remède.
Il y a d’abord l’éventualité sérieuse de n’y avoir aucun remède efficace, en
désespérant de sortir un jour des fausses apparences et des illusions, tant elles
sont fortement collées à la conscience.
C’est là l’attitude propre au scepticisme,
qui refuse l’idée d’une vérité accessible à l’esprit humain.
La devise de Pyrrhon,
le chef et le fondateur de l’école sceptique, était « pas plus vrai que faux ».
De
même, la question de Montaigne est « Que sais-je ? », pour bien mettre en
évidence qu’au fond toute connaissance n’est qu’une illusion.
Il pense qu’on ne
peut y échapper d’une part parce qu’on n’a pas le temps de les examiner, mais
surtout parce qu’elles reposent les unes sur les autres, qu’elles forment un
système qui, si on en détruit une partie, contraint à tout réviser, ce que
l’équilibre intellectuel de l’individu ne saurait supporter, tant cette démolition est
pénible à mener contre soi-même.
« Nos opinions se greffent les unes sur les autres.
La première sert de tige à la
seconde, la seconde à la tierce.
Nous échelons ainsi de degré en degré.
Et
advient de là que le plus haut monté a souvent plus d’honneur que de mérite ;
car il n’est qu’un grain sur les épaules du pénultième.
» Montaigne.
L’affaire....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Cours introductif à la philosophie
- LA CONSCIENCE (résumé de cours de philosophie)
- cours sur l'Etat (philosophie politique)
- Le Langage - Cours Complet Philosophie Terminale
- Cours Allegorie de la Caverne Philosophie