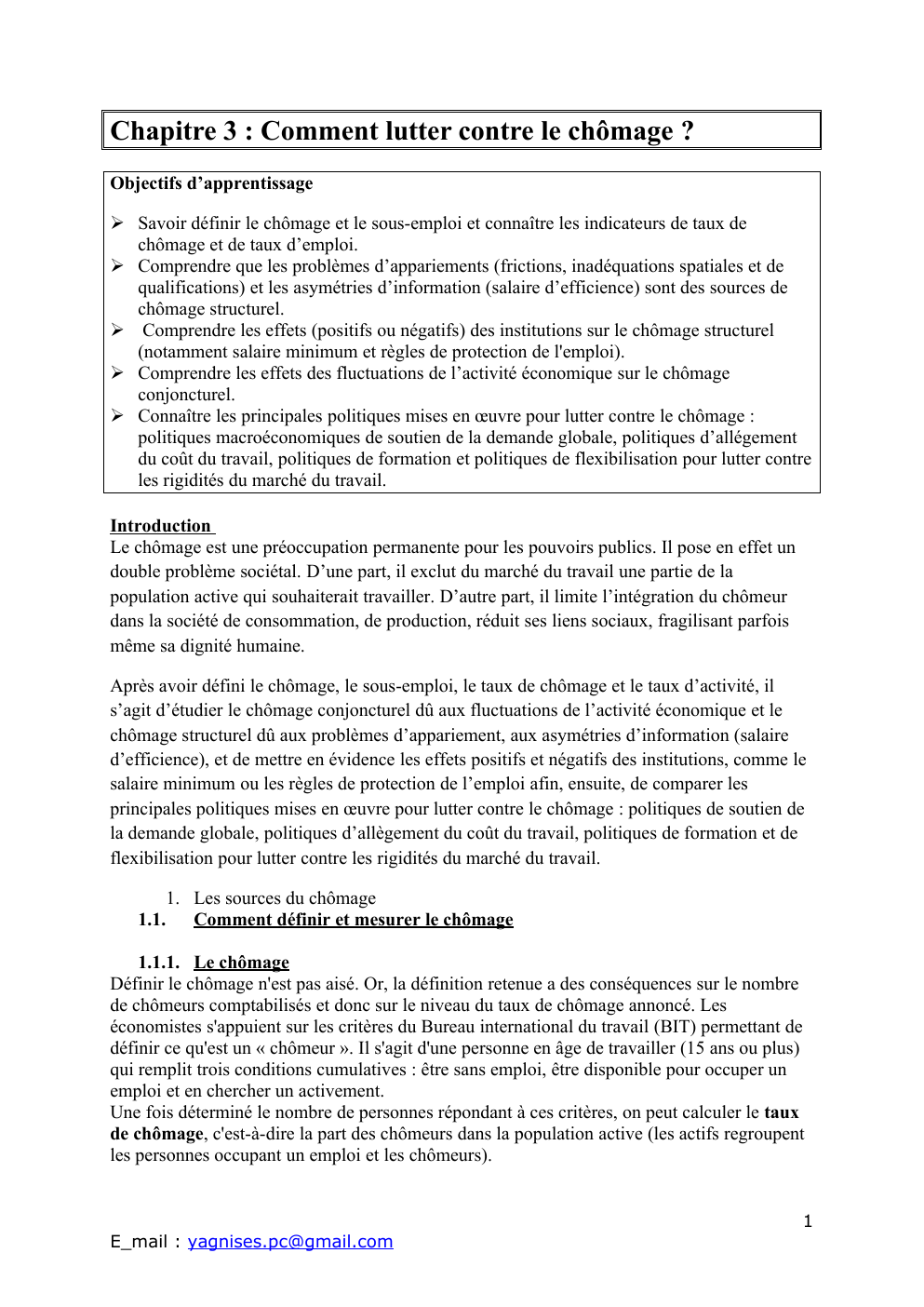Cours chômage terminale: Chapitre 3 : Comment lutter contre le chômage ?
Publié le 05/02/2025
Extrait du document
«
Chapitre 3 : Comment lutter contre le chômage ?
Objectifs d’apprentissage
Savoir définir le chômage et le sous-emploi et connaître les indicateurs de taux de
chômage et de taux d’emploi.
Comprendre que les problèmes d’appariements (frictions, inadéquations spatiales et de
qualifications) et les asymétries d’information (salaire d’efficience) sont des sources de
chômage structurel.
Comprendre les effets (positifs ou négatifs) des institutions sur le chômage structurel
(notamment salaire minimum et règles de protection de l'emploi).
Comprendre les effets des fluctuations de l’activité économique sur le chômage
conjoncturel.
Connaître les principales politiques mises en œuvre pour lutter contre le chômage :
politiques macroéconomiques de soutien de la demande globale, politiques d’allégement
du coût du travail, politiques de formation et politiques de flexibilisation pour lutter contre
les rigidités du marché du travail.
Introduction
Le chômage est une préoccupation permanente pour les pouvoirs publics.
Il pose en effet un
double problème sociétal.
D’une part, il exclut du marché du travail une partie de la
population active qui souhaiterait travailler.
D’autre part, il limite l’intégration du chômeur
dans la société de consommation, de production, réduit ses liens sociaux, fragilisant parfois
même sa dignité humaine.
Après avoir défini le chômage, le sous-emploi, le taux de chômage et le taux d’activité, il
s’agit d’étudier le chômage conjoncturel dû aux fluctuations de l’activité économique et le
chômage structurel dû aux problèmes d’appariement, aux asymétries d’information (salaire
d’efficience), et de mettre en évidence les effets positifs et négatifs des institutions, comme le
salaire minimum ou les règles de protection de l’emploi afin, ensuite, de comparer les
principales politiques mises en œuvre pour lutter contre le chômage : politiques de soutien de
la demande globale, politiques d’allègement du coût du travail, politiques de formation et de
flexibilisation pour lutter contre les rigidités du marché du travail.
1.
Les sources du chômage
1.1.
Comment définir et mesurer le chômage
1.1.1.
Le chômage
Définir le chômage n'est pas aisé.
Or, la définition retenue a des conséquences sur le nombre
de chômeurs comptabilisés et donc sur le niveau du taux de chômage annoncé.
Les
économistes s'appuient sur les critères du Bureau international du travail (BIT) permettant de
définir ce qu'est un « chômeur ».
Il s'agit d'une personne en âge de travailler (15 ans ou plus)
qui remplit trois conditions cumulatives : être sans emploi, être disponible pour occuper un
emploi et en chercher un activement.
Une fois déterminé le nombre de personnes répondant à ces critères, on peut calculer le taux
de chômage, c'est-à-dire la part des chômeurs dans la population active (les actifs regroupent
les personnes occupant un emploi et les chômeurs).
E_mail : [email protected]
1
taux de c h ô mage=
nombre de c h ô meurs
population active
Fin 2019, le taux de chômage au sens du BIT s'établissait à hauteur de 8,1 % de la population
active en France (hors Mayotte) et à 7,9 % en France métropolitaine, soit environ 2,4 millions
de personnes.
1.1.2.
Le sous-emploi
Il est également important de tenir compte du sous-emploi.
Selon l'Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE), il concerne les personnes actives occupées au
sens du BIT qui travaillent à temps partiel mais qui souhaiteraient travailler davantage.
Le
sous-emploi apparaît donc comme une sorte de « semi-chômage ».
Selon les chiffres de
l'INSEE, en 2018, il concerne près de 1 614 000 personnes, soit 6 % des personnes en emploi.
Le taux d'emploi est de plus en plus souvent utilisé pour mesurer la part des personnes qui
occupent un emploi dans le total des personnes en âge de travailler (entre 15 et 64 ans).
Il
permet de mettre en évidence la capacité des organisations productives à embaucher de la
main-d'œuvre potentielle, c'est-à-dire les personnes qui ont l'âge de travailler.
En 2018, la
France a un taux d'emploi (environ 65,8 %), parmi les plus faibles de l'Union européenne.
taux d ' emploi=
1.2.
'
nombre d actifsoccup é s
population en â≥de travailler
Les explications du chômage conjoncturel
Les fluctuations de l’activité économique peuvent avoir des effets sur le chômage
conjoncturel, c’est-à-dire à court terme.
En effet, ce type de chômage est le résultat des
mouvements à la hausse ou à la baisse de l’activité économique.
Il varie à la baisse si la
croissance est perçue comme durable par les entrepreneurs, ou à la hausse si la conjoncture est
déprimée ou les perspectives jugées inquiétantes.
Lors des phases de croissance forte, la
production augmente pour s’adapter à une demande globale attendue à la hausse par les
producteurs.
À productivité constante, il faut donc produire plus et utiliser davantage de
facteur travail pour suivre cette hausse de la production, ce qui crée des emplois et fait baisser
le chômage.
C’est ce qui s’est produit en France entre 2016 et 2018.
Dans le cas contraire,
lors des phases de ralentissement, les producteurs s’adaptent à une demande qu’ils attendent
en baisse, et vont donc produire en moins grande quantité, avec moins de facteur travail
mobilisé, ce qui détruit des emplois et fait augmenter le chômage.
C’est ce qui s’est produit en
France à partir de 2008 lors de la crise des subprimes.
Doc 1 page 76 hachette 2020 https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001277/lacrise-financiere-mondiale-et-ses-effets-sur-l-emploi.html
A l’image de la crise de 2008 (la grande récession), la hausse du chômage à partir de 2008
s’explique par le ralentissement de l’activité des entreprises qui font face à une demande de
biens et de services en baisse.
En effet, à cause de la crise immobilière américaine, les
banques du monde entier deviennent méfiantes et accordent moins de crédits.
Les agents
économiques (ménages et entreprises) voient leurs revenus diminuer et diminuent leurs
dépenses (consommation et investissement), ce qui diminue la production et l’emploi.
On
parle alors de chômage « conjoncturel » car les suppressions d’emplois sont liées à une
situation économique soudainement dégradée (fluctuations).
Les employeurs sont incités à
E_mail : [email protected]
2
réduire leur activité et à mobiliser moins de facteur travail pour réaliser une production en
baisse.
1.3.
Les causes du chômage structurel
Le chômage structurel, quant à lui, est un chômage chronique, durable et contre lequel il est
difficile d'agir.
Il a plusieurs causes.
1.3.1.
Des problèmes d’appariements
Tout d'abord, il s'explique par des problèmes d'appariements : l'offre de travail (les actifs) et
la demande de travail (qui émane des entreprises à la recherche de travailleurs) ne se
rencontrent pas.
Ces problèmes de matching peuvent résulter de :
L’inadéquation de qualifications
Les qualifications peuvent être aussi en cause : les inadéquations des qualifications requises et
celles dont disposent les candidats et des chômeurs sont sources de chômage structurel (les
mineurs, … les couturières avec des qualifications qui ne sont pas très demandées
actuellement en France …).
Un problème d’appariement apparaît lorsque l’employeur ne
trouve pas précisément le candidat aux compétences adéquates pour un poste, et réciproque.
Malgré l'importance du chômage en France, certains secteurs précis ne parviennent pas à
recruter : ingénieurs, personnels de maison, etc.) ;
L’inadéquation spatiale
La répartition des demandeurs et des offreurs d’emplois n’est pas égale dans toutes les
régions.
Les régions sont plus ou moins dynamiques du point de vue de la production et de la
création d’emplois.
Les chômeurs des Pyrénées-Orientales ne sont pas forcément en mesure
de chercher un emploi dans une autre région : si leur conjoint a déjà un emploi dans la région,
ou s’ils sont dans l’impossibilité de se déplacer, ils seront contraints de rester à chercher un
emploi sur place.
En outre, la recherche d’emploi à distance est souvent moins fructueuse car
la personne ne bénéficie pas de son réseau social de proximité pour amplifier ou appuyer sa
recherche.
Frictions
Les frictions sur ce marché, sont le temps nécessaire aux chômeurs, pour trouver un emploi et
aux recruteurs, pour pourvoir un poste (asymétries d’informations entre l’offre et la demande
notamment).
On peut constater que le chômage n’est pas un phénomène uniforme sur le
territoire français, ce qui permet d’introduire l’hypothèse de la faible mobilité de la maind’œuvre.
De nombreux emplois non pourvus, le sont dû fait de la localisation de l’employeur
et le futur salarié (diagonale des faibles densités, pôle de compétitivité …).
1.3.2.
Les asymétries d’information
Le chômage structurel peut également résulter des asymétries d'information inhérente à la
relation salariale (par exemple, l'employeur ne dispose pas d'une information parfaite sur les
capacités réelles du travailleur au moment de l'embauche).
Cela conduit souvent les
employeurs à mettre en place un salaire d'efficience, c'est-à-dire à payer les salariés à un
niveau plus élevé que le niveau de salaire d'équilibre afin de les inciter à l'effort et ainsi
réduire l'incertitude.
E_mail : [email protected]
3
1.3.3.
La rigidité du marché du travail
Sur le marché du travail, les institutions, c’est-à-dire les réglementations (notamment le
salaire minimum et les règles de protection de l’emploi), ont des effets positifs et négatifs sur
le chômage structurel, indépendamment de la conjoncture économique.
D’après le paradigme néoclassique standard (vu en 1ère), le marché du travail est un marché
comme les autres et ce sont aux mécanismes de marché....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Cours SES Terminale CHAPITRE 8 : L’école
- CHAPITRE 3 – La difficile entrée dans l’âge démocratique : la Deuxième République et le Second Empire Cours 1. La Deuxième République (1848-1852) : entre espoirs et échecs (p. 92-93)
- Quelques solutions pour lutter contre la pauvreté et le chômage ?
- Cours de philo sur la conscience - Chapitre 1 : Que-ce qu’un sujet ?
- Le Langage - Cours Complet Philosophie Terminale