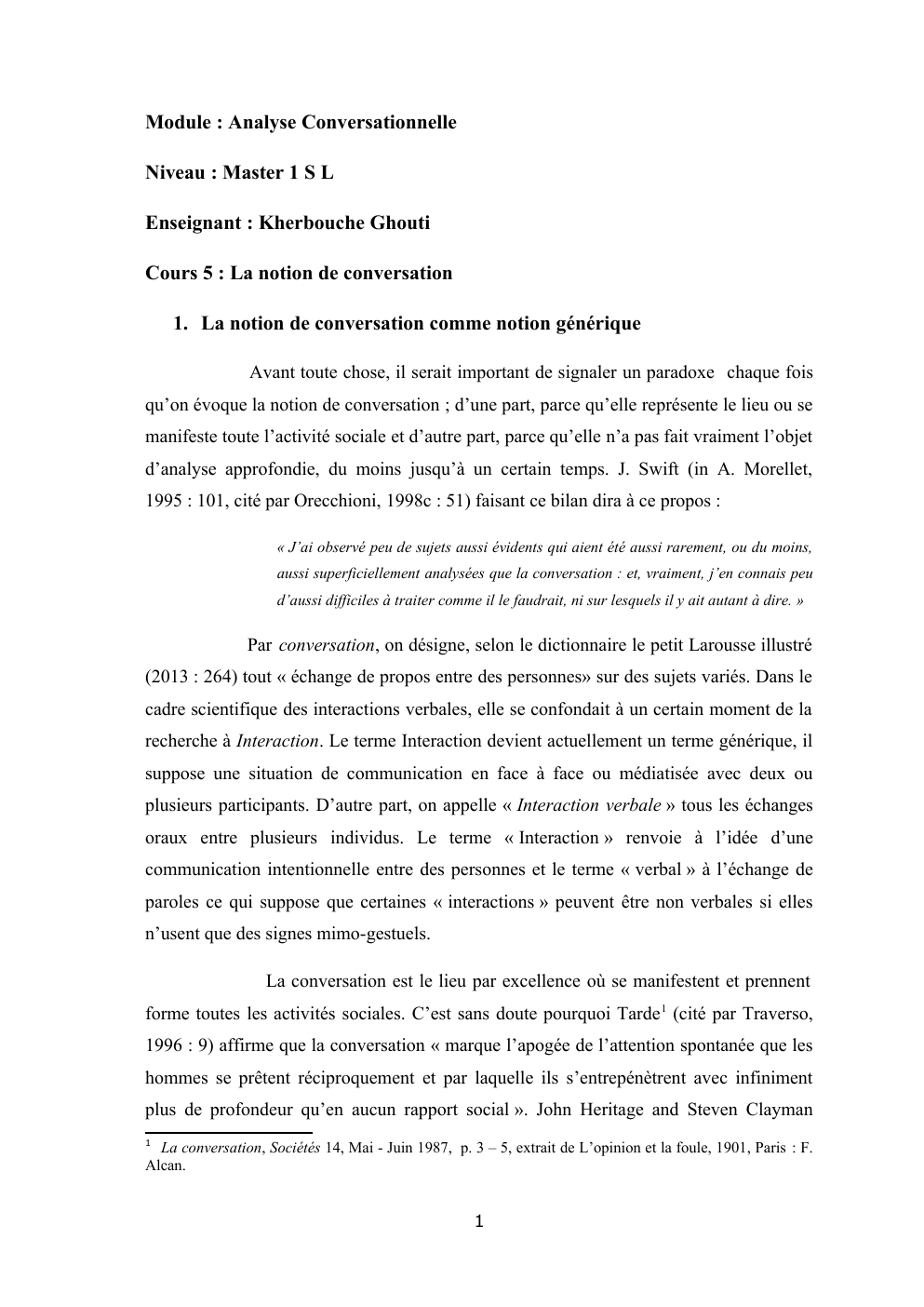Cours 5 : La notion de conversation
Publié le 16/11/2022
Extrait du document
«
Module : Analyse Conversationnelle
Niveau : Master 1 S L
Cours 5 : La notion de conversation
1.
La notion de conversation comme notion générique
Avant toute chose, il serait important de signaler un paradoxe chaque fois
qu’on évoque la notion de conversation ; d’une part, parce qu’elle représente le lieu ou se
manifeste toute l’activité sociale et d’autre part, parce qu’elle n’a pas fait vraiment l’objet
d’analyse approfondie, du moins jusqu’à un certain temps.
J.
Swift (in A.
Morellet,
1995 : 101, cité par Orecchioni, 1998c : 51) faisant ce bilan dira à ce propos :
« J’ai observé peu de sujets aussi évidents qui aient été aussi rarement, ou du moins,
aussi superficiellement analysées que la conversation : et, vraiment, j’en connais peu
d’aussi difficiles à traiter comme il le faudrait, ni sur lesquels il y ait autant à dire.
»
Par conversation, on désigne, selon le dictionnaire le petit Larousse illustré
(2013 : 264) tout « échange de propos entre des personnes» sur des sujets variés.
Dans le
cadre scientifique des interactions verbales, elle se confondait à un certain moment de la
recherche à Interaction.
Le terme Interaction devient actuellement un terme générique, il
suppose une situation de communication en face à face ou médiatisée avec deux ou
plusieurs participants.
D’autre part, on appelle « Interaction verbale » tous les échanges
oraux entre plusieurs individus.
Le terme « Interaction » renvoie à l’idée d’une
communication intentionnelle entre des personnes et le terme « verbal » à l’échange de
paroles ce qui suppose que certaines « interactions » peuvent être non verbales si elles
n’usent que des signes mimo-gestuels.
La conversation est le lieu par excellence où se manifestent et prennent
forme toutes les activités sociales.
C’est sans doute pourquoi Tarde 1 (cité par Traverso,
1996 : 9) affirme que la conversation « marque l’apogée de l’attention spontanée que les
hommes se prêtent réciproquement et par laquelle ils s’entrepénètrent avec infiniment
plus de profondeur qu’en aucun rapport social ».
John Heritage and Steven Clayman
1
La conversation, Sociétés 14, Mai - Juin 1987, p.
3 – 5, extrait de L’opinion et la foule, 1901, Paris : F.
Alcan.
1
(2010:12) confirment que parmi les principes basiques de la CA consiste à considérer la
conversation entre les membres d’une même société comme un domaine fondamental de
l’analyse et que la conversation ordinaire représente une ressource basique de l’extension
de la CA vers d’autres domaines non-conversationnels.
Selon Mondada (2001 :03), l’interaction sociale dans sa forme principale
qui est la conversation est « le lieu prototypique de l’usage des ressources linguistiques,
outre que de la construction de l’ordre social, des relations, des positions et des identités
catégorielles des participants ».
.
Par ailleurs, bien qu’il soit évident que le langage verbal, moyen essentiel
par lequel se réalise toute interlocution, ait par excellence la fonction de mettre en œuvre
la communication interpersonnelle dans les diverses situations de la vie quotidienne, il a
été pendant longtemps négligé par la linguistique de la première génération.
Jakobson, d’ailleurs, a été avec Bakhtine parmi les rares sinon les seuls
chercheurs qui avaient rappelé que l’interlocution constituait l’essence même de la
langue : « (…) la réalité à laquelle la linguistique à affaire, c’est l’interlocution.
(…) je
parle de la tendance à considérer le discours individuel comme la seule réalité.
Cependant, je l’ai déjà dit, tout discours individuel suppose un échange2.
» Jakobson
(1963 : 32)
En effet, la linguistique contemporaine, en particulier le courant
interactionniste, a bel et bien adopté cette nouvelle conception.
Elle s’est rendu compte
(la linguistique) que la conversation est, par excellence, le moyen de la sociabilité et de la
socialisation, et que, de ce fait, elle pourrait être le lieu privilégié de l’étude de
l’interaction sociale qui se réalise effectivement par le biais du langage verbal.
Considérée comme un type particulier d’interactions verbales, il n’est pas étonnant que la
conversation revête aujourd’hui une importance primordiale pour l’analyse du discoursen-interaction :
« L’analyse du discours-en-interaction privilégie tout naturellement les formes de
discours qui présentent le plus fort degré d’interactivité3, au premier rang desquelles
figurent les conversations, qui sont généralement considérées non seulement comme
2
3
Italiques ajoutés
Les conversations sont généralement admises comme présentant un fort degré d’interactivité en fonction
des critères suivants :
2
un type particulier d’interactions verbales, mais comme une sorte de prototype en la
matière.
» (Orecchioni, 2005 : 18).
Levinson 4 (cité par ibid., 2005 : 18) le montre si bien en affirmant que la
conversation est clairement le genre prototypique de l’usage du langage et la matrice
favorisant l’acquisition d’une langue : « Conversation is clearly the prototypical kind of
language use (…) and the matrix for language acquisition.
»
La désignation de l’analyse des formes de talk-in-interaction par
conversation analysis montre très bien le degré de privilège accordé à ce type
d’interactions sociales.
On va même, dans la CA, jusqu’à dire que les autres formes de
talk-in-interaction pourraient être considérées comme des transformations où des formes
dérivées de la conversation et doivent être étudiées comme telles.
Si l’on croit, cependant, Barthes et Berthet (1979 : 3, cité par Orecchioni,
ibid.
: 185) se situant à l’opposé de la CA, le caractère asymétrique et atypique de la
conversation dû à sa « mollesse formelle », pensent-ils, présente « un défi discret pour la
science ».
Ils refusent tout travail linguistique et systématique sur la conversation.
Cependant, Moeschler (1985 : 80) conteste ce genre d’argument en affirmant que malgré
la délicatesse de la transcription elle reste un exercice faisable et que les personnes
enregistrées peuvent très bien faire preuve de coopération une fois informées du but de
l’enregistrement.
Pour la CA la conversation est considérée comme un « mode prototypique »
duquel découlent toutes les autres formes d’interactions vu qu’elle serait, « l’activité
humaine la plus répandue » et de ce fait elle pourrait constituer un objet d’étude très
intéressant pour la linguistique renouvelée.
Ce privilège accordé à la conversation se réalisant essentiellement par les
moyens verbaux, selon Orecchioni (2005 : 19), est dû au fait qu’elle représente dans
toutes les sociétés sinon la plupart d’entre elles la forme la plus répandue « que peut
a)
La nature des participations mutuelles,
b) Le rythme de l’alternance des tours de parole,
c)
La répartition des prises de parole,
d) Le degré d’engagement des participants dans l’interaction.
4
Levinson (1983: 284).
3
pendre l’activité langagière ».
Elle est, pour Tarde (cité ibid), « le plus fidèle miroir de la
société ».
Pour Goffman (1973 a : 21) c’est « une sorte de système social en miniature ».
Analyser par exemple
un fait aussi banal que l’ouverture d’une conversation
téléphonique, pour Schegloff
(1986 :115) (cité par Orecchioni, 2005 : 19) « permet
d’appréhender l’essence même de l’ordre social.
»
La conversation la plus banale qu’elle obéirait à certaines règles
d’organisation selon Véronique Traverso (1996 : 11), « on n’entre pas en conversation
n’importe comment, on ne change pas de thème n’importe comment, on n’enchaîne pas
les répliques n’importe comment, on ne se sépare pas n’importe comment, etc.
»
2.
La notion de conversation comme type particulier d’interaction
verbale
La conversation comme type particulier d’interaction, telle la discussion, la transaction
ou la consultation par exemple possède certaines caractéristiques et peut être distinguée
par certains critères.
Caractéristiques
La conversation dans l’état actuel des connaissances scientifiques renvoie à
un type particulier d’interaction verbale.
C’est comme cela qu’on va la considérer,
désormais, dans la présente recherche.
C’est l’une des interactions à structure d’échange
où les participants ont la possibilité d’intervenir et donc de devenir énonciateur, comme
le signale R.Vion (2000 : 123).
Comme toutes les interactions verbales, elle suppose
aussi une situation de communication orale dans laquelle deux ou plusieurs participants
agissent, réagissent et interagissent mutuellement par le biais de propos échangés.
Cela signifie que toutes les interactions verbales ne sont pas des
conversations.
Ainsi, parmi les types d’interaction, on note par exemple, l’entretien, la
transaction commerciale, la discussion, la consultation, médicale, le débat, l’interview,
etc.
Cependant, il convient de signaler qu’on ne peut compter sur l’homogénéité d’un
seul type : il se peut que dans une consultation médicale, par exemple, on puisse trouver
une ou des séquences du type conversation ; c’est pour cela que Robert Vion prévoit,
pour résoudre ce problème, la notion de module.
5
Schegloff E.A.
1986, The routine as achievement » Human studies 9, 111-151.
4
Bref, la conversation est une interaction verbale ; elle partage avec les autres
interactions verbales les caractéristiques suivantes.
a) L’énoncé est co-construit; il est le résultat d’un effort conjoint de deux ou
plusieurs personnes qui doivent respecter les règles implicites.
Par exemple si
l’un produit un acte à valeur de compliment, on doit s’attendre à ce que l’autre
produit un acte à valeur de remerciement.
Une première salutation proprement
dite ou complémentaires implique une réponse à la salutation de la même nature,
ainsi,
6- D /kiʁakum ə si/ Rachid
Comment allez-vous ?
7- R ça va
8- D /saħa ftuʁkum/
Bon appétit
9- R / saħa ftuʁak/
Bon appétit
C’est une sous-séquence extraite de l’émission Franchise de nuit d’Alger chaîne
trois.
Il apparait clairement que son fonctionnement ne s’appuie pas seulement sur
un rapport de contigüité entre les interventions du même échange mais aussi entre
les échanges : un échange de salutation proprement dite est suivi d’un échange de
salutations complémentaires.
6- D /kiʁakum ə si / Rachid
I
Echange A
7- R ça va
R
salutation proprement dite
8- R /saħa ftuʁkum/
I
Echange B
9- D / saħa ftuʁak/
R
salutation complémentaire
b) L’énoncé dépend de l’influence mutuelle exercée par les interlocuteurs l’un sur
l’autre, c’est l’échafaudage fait d’actions et de réactions qui fait avancer et
5
oriente une interaction.
Si on prend par exemple le cas de quelqu’un qui salue
son interlocuteur par « ça va ? » (salutation complémentaire/question sur la
santé) la suite des échanges ne sera pas la même selon que sa question est
considérée comme une salutation complémentaire ou comme une....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La conscience (cours de la notion)
- Peut-on prédire les cours de la bourse a l'aide des mathematiques ?
- Cours: Histoire des institutions politiques
- Cours droit constitutionnel
- La politique monétaire (cours)