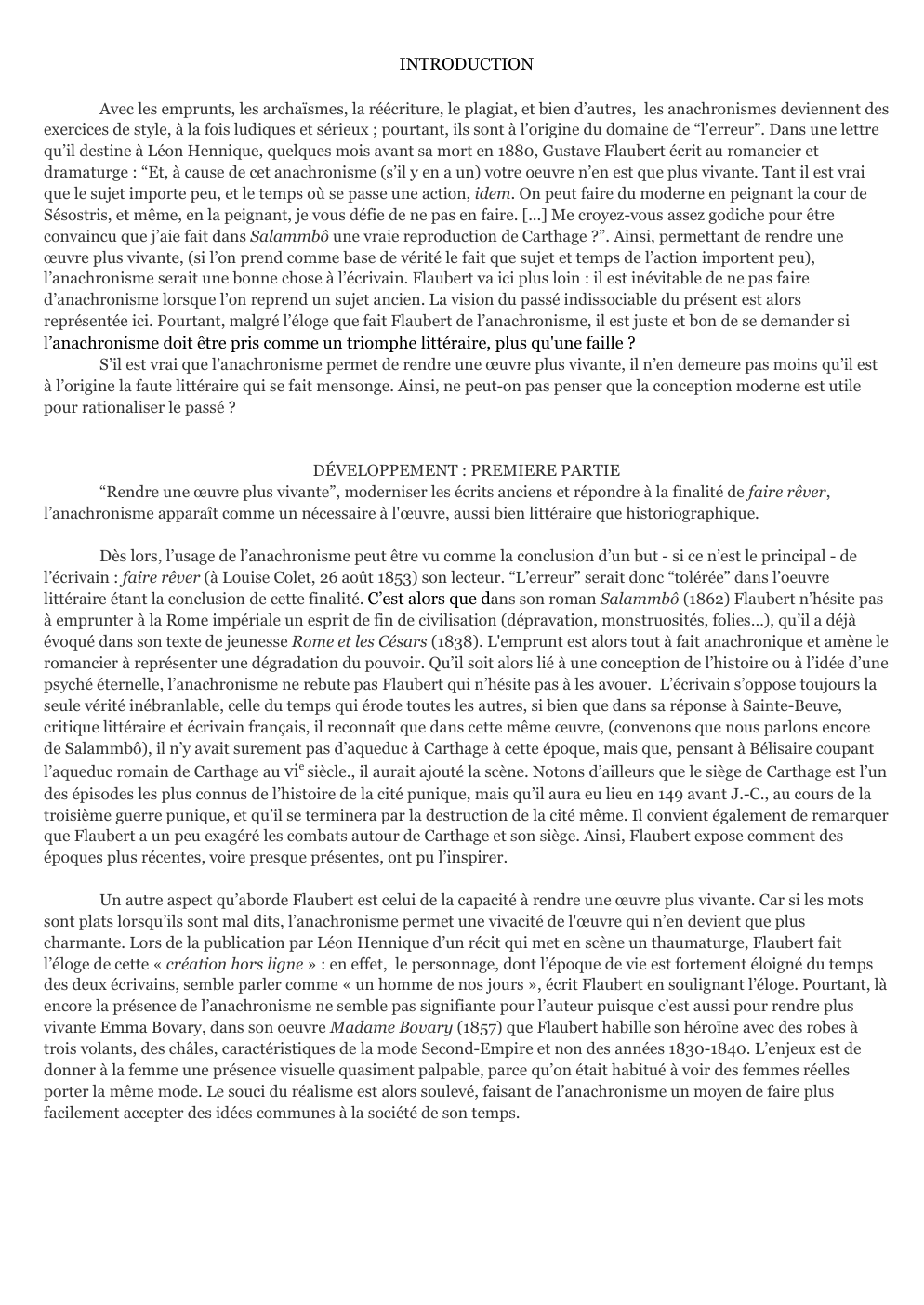Composition française sur une citation de Gustave Flaubert: l'anachronisme en littérature
Publié le 18/09/2022
Extrait du document
«
INTRODUCTION
Avec les emprunts, les archaïsmes, la réécriture, le plagiat, et bien d’autres, les anachronismes deviennent des
exercices de style, à la fois ludiques et sérieux ; pourtant, ils sont à l’origine du domaine de “l’erreur”.
Dans une lettre
qu’il destine à Léon Hennique, quelques mois avant sa mort en 1880, Gustave Flaubert écrit au romancier et
dramaturge : “Et, à cause de cet anachronisme (s’il y en a un) votre oeuvre n’en est que plus vivante.
Tant il est vrai
que le sujet importe peu, et le temps où se passe une action, idem.
On peut faire du moderne en peignant la cour de
Sésostris, et même, en la peignant, je vous défie de ne pas en faire.
[...] Me croyez-vous assez godiche pour être
convaincu que j’aie fait dans Salammbô une vraie reproduction de Carthage ?”.
Ainsi, permettant de rendre une
œuvre plus vivante, (si l’on prend comme base de vérité le fait que sujet et temps de l’action importent peu),
l’anachronisme serait une bonne chose à l’écrivain.
Flaubert va ici plus loin : il est inévitable de ne pas faire
d’anachronisme lorsque l’on reprend un sujet ancien.
La vision du passé indissociable du présent est alors
représentée ici.
Pourtant, malgré l’éloge que fait Flaubert de l’anachronisme, il est juste et bon de se demander si
l’anachronisme doit être pris comme un triomphe littéraire, plus qu'une faille ?
S’il est vrai que l’anachronisme permet de rendre une œuvre plus vivante, il n’en demeure pas moins qu’il est
à l’origine la faute littéraire qui se fait mensonge.
Ainsi, ne peut-on pas penser que la conception moderne est utile
pour rationaliser le passé ?
DÉVELOPPEMENT : PREMIERE PARTIE
“Rendre une œuvre plus vivante”, moderniser les écrits anciens et répondre à la finalité de faire rêver,
l’anachronisme apparaît comme un nécessaire à l'œuvre, aussi bien littéraire que historiographique.
Dès lors, l’usage de l’anachronisme peut être vu comme la conclusion d’un but - si ce n’est le principal - de
l’écrivain : faire rêver (à Louise Colet, 26 août 1853) son lecteur.
“L’erreur” serait donc “tolérée” dans l’oeuvre
littéraire étant la conclusion de cette finalité.
C’est alors que dans son roman Salammbô (1862) Flaubert n’hésite pas
à emprunter à la Rome impériale un esprit de fin de civilisation (dépravation, monstruosités, folies…), qu’il a déjà
évoqué dans son texte de jeunesse Rome et les Césars (1838).
L'emprunt est alors tout à fait anachronique et amène le
romancier à représenter une dégradation du pouvoir.
Qu’il soit alors lié à une conception de l’histoire ou à l’idée d’une
psyché éternelle, l’anachronisme ne rebute pas Flaubert qui n’hésite pas à les avouer.
L’écrivain s’oppose toujours la
seule vérité inébranlable, celle du temps qui érode toutes les autres, si bien que dans sa réponse à Sainte-Beuve,
critique littéraire et écrivain français, il reconnaît que dans cette même œuvre, (convenons que nous parlons encore
de Salammbô), il n’y avait surement pas d’aqueduc à Carthage à cette époque, mais que, pensant à Bélisaire coupant
l’aqueduc romain de Carthage au vie siècle., il aurait ajouté la scène.
Notons d’ailleurs que le siège de Carthage est l’un
des épisodes les plus connus de l’histoire de la cité punique, mais qu’il aura eu lieu en 149 avant J.-C., au cours de la
troisième guerre punique, et qu’il se terminera par la destruction de la cité même.
Il convient également de remarquer
que Flaubert a un peu exagéré les combats autour de Carthage et son siège.
Ainsi, Flaubert expose comment des
époques plus récentes, voire presque présentes, ont pu l’inspirer.
Un autre aspect qu’aborde Flaubert est celui de la capacité à rendre une œuvre plus vivante.
Car si les mots
sont plats lorsqu’ils sont mal dits, l’anachronisme permet une vivacité de l'œuvre qui n’en devient que plus
charmante.
Lors de la publication par Léon Hennique d’un récit qui met en scène un thaumaturge, Flaubert fait
l’éloge de cette « création hors ligne » : en effet, le personnage, dont l’époque de vie est fortement éloigné du temps
des deux écrivains, semble parler comme « un homme de nos jours », écrit Flaubert en soulignant l’éloge.
Pourtant, là
encore la présence de l’anachronisme ne semble pas signifiante pour l’auteur puisque c’est aussi pour rendre plus
vivante Emma Bovary, dans son oeuvre Madame Bovary (1857) que Flaubert habille son héroïne avec des robes à
trois volants, des châles, caractéristiques de la mode Second-Empire et non des années 1830-1840.
L’enjeux est de
donner à la femme une présence visuelle quasiment palpable, parce qu’on était habitué à voir des femmes réelles
porter la même mode.
Le souci du réalisme est alors soulevé, faisant de l’anachronisme un moyen de faire plus
facilement accepter des idées communes à la société de son temps.
Mais l’anachronisme semble également une fatalité à l’auteur qui cherche à reproduire une œuvre : l’écriture
du passé étant la porte ouverte à l’anachronisme.
Quand on lit l'histoire, on revoit globalement les mêmes grands
mouvements.
D’une époque à l’autre on retrouve la même férocité, par exemple.
Le temps avance et s’expand, et
pourtant, il y a de la répétition dans l’histoire.
Si nous repartons de l'œuvre Salammbô, l’on remarque que l’héroïne
du roman carthaginois, qui a peur de « se compromettre », est timorée comme une bourgeoise du 19e siècle.
Et si elle
est assez différente dans le roman, Flaubert avoue à Sainte-Beuve qu’il l’a conçue finalement comme une sainte
Thérèse, tandis que Sainte-Beuve estime qu’elle est « moins une sœur d’Annibal qu’une sœur de la vierge gauloise
Velléda, transposée, dépaysée, mais évidemment de la même famille sous son déguisement.
».
Flaubert y dénonce
l’illusion d’une objectivité à l’abri du temps, d’une écriture du passé qui pourrait être non datée et redevable aux
représentations de son époque.
L’on remarque que l’anachronisme de pensée est inévitable en tant que
représentation, aucun récit du passé ne peut échapper à une manière de voir qui a ses coordonnées dans un présent.
L’objectivité est devient un rêve illusoire, les choses étant toujours appréhendées par un regard.
Donc, l’anachronisme serait quelque chose de positif.
Pourtant, si sa première définition est de l’ordre de
l’erreur, il semble raisonnable de se questionner sur sa finalité dans les œuvres littéraires.
DEUXIÈME PARTIE :
Relevant de l’erreur, l’anachronisme incite au faux, voire au mensonge.
N’oubliant pas que la première définition que donne l'Académie Française de l’anachronisme est celle du
domaine de l’erreur, il semble juste de se demander s’il ne serait pas une porte ouverte à une perte de vérité.
Sa
présence dans les œuvres littéraires, étant tantôt volontaires, tantôt involontaires, soulève la question suivante : qui
dit vrai ? Véritable déconstruction de la chronologie, l’anachronisme - dans l’historiographie autant que dans la
littérature - semble causer une perte de véracité.
Et cet aspect est nettement plus visible dans le domaine de l'œuvre
historique, « chacun [étant] libre de regarder l’histoire à sa façon, puisque l’histoire n’est que la réflexion du présent
sur le passé » (Flaubert).
Roman inachevé de l’auteur, Bouvard et Pécuchet (1881) relate l’histoire de deux
promeneurs, des noms respectifs du titre de l'œuvre, qui se rencontrent par hasard sur un banc public et font
connaissance.
Ils s'aperçoivent qu'ils ont tous deux l'idée d'écrire leur nom dans leur chapeau : « Alors ils se
[considèrent].
».
Les deux hommes entreprennent l’idée folle de se procurer la meilleure histoire de France.
Néanmoins, les histoires de 1789 les laissent perplexes : il y a des divergences d’interprétation.
Ils espèrent alors
qu’en choisissant des périodes plus éloignées, ils trouveront plus d’impartialité.
Ils pensent qu’il faut « juger
impartialement » les événements, et ils éprouvent « le besoin de la vérité pour elle-même », se désolant des
contradictions des historiens qui ne s’entendent même pas sur l’établissement des faits.
Bouvard et Pécuchet
cherchent alors à lutter contre les anachronismes des auteurs “pièges à lecteurs”, si bien qu’ils en chassent les
moindres traces dans leur œuvre.
Ainsi, l’anachronisme peut être dû à une erreur, une ignorance ou une tradition.
Il est, dans tous les cas,
assimilé à une faute comme le fait ressortir Madame de Staël dans son livre De l’Allemagne, en 1810, voire à un péché
capital, ainsi que l’énonce Lucien Febvre près d’un siècle plus tard.
User avec volonté, dite “consciente”,
l’anachronisme apparaît donc comme une forme d'usurpation, de mensonge.
Tout au long de son œuvre, Queneau
revisite librement l’histoire : il défie les lois de la chronologie, corrige le temps, transpose les époques, travestit le
passé, joue avec le réel et l’imaginaire, etc.
Cet usage de l’anachronie le met dans une position principale dans l'œuvre,
moteur d’effets de brouillages.
De plus, étant très généralement usés - à tort ou à travers - lors de transcriptions
d’oeuvres anciennes, son usage incite à la fausseté des oeuvres qui, passant de plume en plume, de crayon en crayon,
ne cessent de subir des modifications, car si l’oeuvre ne peut se détacher de l’époque à laquelle elle est écrite, il n’en
demeure pas moins que de tels imprégnations du sujet par leur auteurs entraîne la modification de l’oeuvre originale.
C’est ainsi que, accouplé aux vers de Tristan Corbière, la chanson enfantine « Au clair de la lune » devient au terme de
nombreuses combinaisons : “Au cœur de la nuit la lumière est morte il n’est plus de jour il n’est plus de feu”,
(Raymond Queneau, « Souvenir », Le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Le superflu est le premier des besoins. » Gustave Flaubert, Correspondance. Commentez cette citation ?
- « Tous les romans où l'amour règne, à côté des Liaisons, semblent naïfs ou sommaires. On n'a jamais vu d'intrigues aussi férocement méditées, nouées et dénouées avec tant de maîtrise, précise le critique Kleber-Haedens dans « Une histoire de la littérature française ». Dans un développement organisé, vous commenterez cette citation en vous attachant notamment à comparer « Les Liaisons dangereuses » à d'autres célèbres romans d'amour.
- Littérature française du XVIIe
- Dans le Dictionnaire égoïste de la littérature française, Charles Dantzig affirme : « La poésie ne se trouve pas que dans les vers ». Vous direz si vous partagez son point de vue dans un développement argumenté, en vous appuyant sur les textes du corpus, sur ceux que vous avez étudiés en classe ou lus personnellement.
- Frédéric Moreau dans l'Éducation sentimentale de Gustave Flaubert